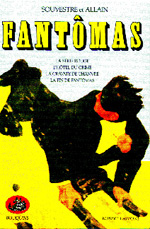
L’image de la Russie dans Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre
Philippe Ethuin
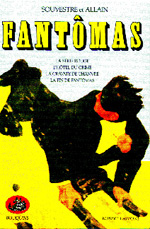
Retour au sommaire de cette maîtrise.
« Comble de la perversité intellectuelle ?
Transformer une lecture de consommation en une
lecture de dégustation. Ne pas oublier de façon générale
que toute consommation peut être source de dégustation. »[1]
La plupart des critiques adressées la littérature dite « populaire » portent peu ou prou sur son idéologie réelle ou supposée (nous n’avons d’ailleurs pas dérogé à la règle en consacrant un tiers de notre travail à cette question). Dès l’origine du genre, le politique s’est emparé du phénomène et a voulu le contrôler (par exemple avec la loi Rincey qui fixait un timbre à payer pour les journaux publiant des romans sous forme de feuilletons).
Le regard porté sur la littérature populaire se réduit souvent à de simples sondages empreints de préjugés dans l’immense production. Il en ressort quelques grands traits : « c’est toujours la même chose », les personnages et les décors sont caricaturaux, l’idéologie est conservatrice ou immorale (selon l’origine du regard) -en tout cas toujours dangereuse pour les lecteurs populaires,… Quelques stéréotypes pour condamner la stéréotypie de ces ouvrages… A l’étude, le traitement de l’Autre et de l’Ailleurs se révèle un peu plus complexe dans l’usage des stéréotypes par les auteurs, les ambiguïtés idéologiques ou les formes du jeu et de parodie des idées reçues. Ainsi la question de l’originalité comme signe de littérarité est souvent opposée à l’incessante répétition des mêmes thèmes et motifs dans le roman populaire. Sauf à plagier, répéter la Russie est récrire sans cesse le rêve de la Russie et cette réécriture modifie constamment les textes précédents.
La condamnation de la littérature populaire se fait généralement a priori, l’étude ne servant alors qu’à confirmer les préjugés par la recherche d’exemples significatifs :
L’accession massive des couches populaires à la lecture aurait pu remettre en question des classements fondés sur des oppositions désormais caduques ( lettrés vs incultes). En fait la vulgarisation de cette activité valorisante s’est accompagnée d’une redéfinition de la distinction culturelle. Lire n’est pas tout, encore faut-il bien lire (ce qui n’est pas à la portée de tous). Ainsi se pérennise la hiérarchie sociale du champ culturel…[2]
Dans les syntagmes « roman populaire » ou « littérature populaire », l’épithète « populaire » doit être lue dans son acception téléologique : c’est une littérature qui va vers le peuple et non qui vient du peuple[3]. Quand « roman populaire » est légitimé par le dictionnaire le phénomène social a en grande partie disparu remplacé par d’autres médias notamment cinématographique et radiophonique. Le lecteur du début du XXIe siècle se trouve ainsi face à un double exotisme : géographique et temporel. Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre invitent les lecteurs d’aujourd’hui à un voyage dans l’espace et dans le temps. Face à ces œuvre, il découvre trois aspects fortement imbriqués : le moule standardisé, la formation de stéréotypes et la culture de masse. Dans la description de la Russie qui lui est offerte apparaît le privilège accordé à l’étrangeté, au bizarre, à la singularité qui a pour objectif de flatter le goût du public pour l’exotisme.
En lisant ces œuvres, nous entrons dans la littérature d’évasion, dans un domaine autrefois fortement dévalorisé. Le récit d’imagination a longtemps été considéré comme un écrit de seconde zone. Les Anglo-saxons en distinguant le roman réaliste novel et le roman d’imagination romance possèdent deux grilles différentes permettant d’appréhender la littérature dans son ensemble et empêchant de discréditer a priori l’un ou l’autre. L’existence en français du seul mot « roman » prête à confusion.
Souvent disqualifiée pour son idéologie réelle ou supposée, décriée comme un poison (au choix clérical ou anticlérical, révolutionnaire ou conservateur,…), la littérature populaire pose la question de l’impact du livre sur le lecteur. Les lecteurs populaires étaient-ils sensibles à la dimension idéologique des œuvres ? On peut en douter. Ces lectures avaient essentiellement une visée divertissante. Il ne s’agissait pas pour les lecteurs de prendre au sérieux ce qui leur était raconté. De plus, la pratique de la lecture en milieu populaire n’est pas investie de la même exigence que dans les classes intellectuelles :
Considérant la lecture comme une distraction, et la pratiquant de manière distraite, les membres des classes populaires ne sont pas des victimes passives de leurs lectures, voués à toutes les manipulations ourdies par qui veut les asservir : une certaine forme d’inattention peut être un filtre des plus efficace.[4]
Les œuvres de notre corpus semblent placées sous le signe de l’ambiguïté. L’équivoque est double : idéologique et lectorale. Du côté de l’idéologie, on trouve une forme de disqualification idéologique de la Russie (et partant la glorification de la France) mais aussi un fond de critique de la France et de sa suffisance. L’écriture de la Russie passe souvent par un exotisme de pacotille et alimente le déjà-lu. L’utilisation des stéréotypes conduisant à la surdétermination de la Russie qui aboutit à sa déréalisation, pourrait apparaître comme une marque d’une littérature sans originalité mais nous avons montré dans notre dernière partie qu’il s’agit en fait du jeu d’une écriture consciente d’elle-même donc que ces œuvres portent les traces d’une littérarité.
Ces œuvres mettent en évidence l’existence permanente d’une ambivalence, et de la simultanéité de plusieurs niveaux de lecture possibles. Elles amènent à renoncer à toute idée de stabilité de ce qui est défini comme littérature ou littérature populaire. Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre apparaissent comme des œuvres qui défient les classements car elles mènent un travail de remise en cause systématique des représentations de l’autre, des valeurs idéologiques traditionnelles, de l’esprit de sérieux, et des catégories littéraires.
Vue d’aujourd’hui, l’image de la Russie dans les œuvres se révèle très largement « déréalisante ». Les lectures selon des schèmes « réalistes » tombent à plat. Dans la description du pays des tsars, on ne trouve nulle trace d’une quelconque tentative d’épuisement d’un lieu russe. Les auteurs se placent du côté de la fantasmagorie, des faux-semblant, où la réalité seconde menace toujours la première. L’idéologie est souvent désuète car beaucoup de ses enjeux sont dépassés. L’exotisme est dans nos œuvres une peinture de l’autre (une représentation, une mise en scène) ; il s’oppose au cosmopolitisme qui est l’ouverture aux influences venues de l’étranger.
On peut donc voir dans la transcription de l'image de la Russie un témoignage d'époque à la fois sur le pays du tsar mais aussi sur la France. Est-ce tout ? Y-a-t-il d'autres raisons de lire ces oeuvres encore aujourd'hui ? Oui certainement sinon pourquoi seraient-elles encore éditées ? Plaisir de lecture avant, plaisir de se prendre au jeu des auteurs, plaisir de la connivence entre auteurs et lecteurs.
En choisissant le monde « réel » (en fait fortement médiatisé) comme référent premier, ces œuvres posent au lecteur les questions du jeu entre réalité et fiction. Comment les qualifier ? réalisme fictionnel, fictionnalité de la réalité, fictionnalisation de la réalité ?
Le pacte de lecture est redoublé : il repose sur l’acceptation par le lecteur de la fictionnalité du roman et de la mise en fiction d’une actualité « réelle » (l’actualité devenant romanesque). Cette actualité romanesque est prise comme référence par l’aventure racontée. Il s’agit d’un mode de captation du lecteur reposant sur une lecture doublement contrainte : accepter la fictionnalité et le cadre de référence fictionnalisé donné. Tout tourne autour du triptyque : vraisemblance, ressemblance, dissemblance par rapport au vaste corpus du roman populaire.
La question de la conformité au « réel » est récurrente dans les études sur l’image de l’Autre. Beaucoup concluent à l’inadéquation entre l’univers de la fiction mettant en scène l’Autre et le monde réel. Mais cette conclusion n’est pas suffisante et ce n’est certainement pas en elle que se manifeste l’intérêt d’une étude de l’image de l’Etranger. La littérature médiatise des connaissances et crée son propre univers référentiel : Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre n’ont pas de visée anthropologique quand ils décrivent la Russie. Les romans ne sont donc pas des reproductions du « réel ». L’analyse de l’image de la Russie à travers le prisme de « cette machine infernale apte à fracasser l’illusion de réalité et l’esprit vériste, simplement en les poussant jusqu’à l’absurde et en les caricaturant[5] » que constitue la littérature populaire nous a permis de montrer la construction d’une russité de l’imaginaire. Elle fut peut être un moyen d’accéder à la modernité
Pour les auteurs il s’agit d’être fidèle à la réalité première de la perception et non à la construction intellectuelle qui la prive de son étrangeté. Apparaît la difficulté de dire la réalité et le lecteur se trouve face à la justesse de la voix narrative et de la voie narrative. Tout semble possible dans ces œuvres à la fois ouvertes et closes entre référence au « réel » et emprunt au jeu :
Nous retrouvons deux esthétiques qui, à notre sens, en ce XIXe siècle et en début du XXe, se dresseraient l’une en face de l’autre. D’une part une esthétique réaliste qui penserait l’apparence comme révélatrice de l’être, et qui, dans la lignée positiviste et scientiste, se caractériserait par son esprit de sérieux, voire son dogmatisme et son didactisme (le narrateur y est souvent incarné par un technicien ou un savant). D’autre part une esthétique carnavalesque de la mascarade qui poserait la scission de l’être et du paraître, et nous ferait assister au poudroiement des apparences devenues autonomes. Cette esthétique carnavalesque correspond plus spécialement à la littérature dite populaire.[6]
N’est-ce pas en faire trop dire aux textes que de leur faire affirmer une dimension littéraire ?
Quoi qu’il [l’auteur] ait voulu dire, il a écrit ce qu’il a écrit. Une fois publié, un texte est comme un appareil dont chacun peut se servir à sa guise et selon ses moyens : il n’est pas sûr que le constructeur en use mieux qu’un autre.[7]
Ces œuvres disent beaucoup plus sur la civilisation qui se met en scène que sur la Russie. Produits commerciaux, Rouletabille chez le tsar et la Cravate de chanvre posent comme condition de leur réussite le fait de combler l’horizon d’attente du lecteur, dans une sorte de symbiose entre l’imagination des auteurs et les désirs des lecteurs. En ce sens le roman populaire a un rôle de révélateur : révélation à la fois d’une poésie populaire et d’un imaginaire collectif. C’est ainsi que les séries des Fantômas ou des Aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille ont pu susciter l’enthousiasme des surréalistes.
La représentation symbolique de la Russie lui donne une dimension théâtrale et poétique. Mais sous des dehors de pur divertissement, la littérature populaire se révèle plus profondément réceptacle de l’imaginaire collectif.
Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre témoignent de leur époque de production par les stéréotypes employés, l’idéologie présente dans les œuvres et les procédés d’acclimatation de l’autre. Le lecteur se repaît d’un exotisme à bon marché. La réutilisation de tous les préjugés sur la Russie permet de conforter les idées reçues de la majorité des lecteurs à la fois sur le pays des tsars et sur la France. Ce n’est pas le moindre intérêt de la littérature dite populaire que de permettre au lecteur d’accéder aux représentations d’une époque :
[…] loin d’être une sous-littérature qui se vend, s’achète, se consomme et se jette après utilisation, la littérature populaire apparaît au contraire comme un observateur privilégié des mentalités et des représentations collectives, comme le lieu où s’inscrivent les mutations de la société, où s’articulent notre histoire et notre imaginaire.[8]
Retour au sommaire de cette maîtrise.
[1] Jean-Claude Vareille, Le Roman populaire français, op. cit., p 302.
[2] Anne-Marie Thiesse, op. cit., p 58.
[3] D’ailleurs l’expression même « roman populaire » est une création publicitaire de l’éditeur Barda au milieu du XIXe siècle.
[4] Anne-Marie Thiesse, op. cit., p 55.
[5] Jean-Claude Vareille, Le Roman populaire français, op. cit., p 177.
[6] Jean-Claude Vareille, L’Homme masqué…, op. cit., p 161.
[7] Paul Valéry, Au sujet du Cimetière marin, Œuvres, Gallimard, 1957, t 1, p 1507.
[8] Hélène Millot, « Avant-propos », Ecrits et expressions et populaires, CIEREC, Travaux XCV, Publications de l’Université de Saint-Etienne, Saint-Etienne, 1998, p 9.