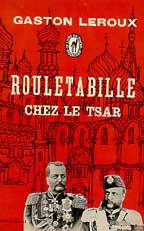
Philippe Ethuin
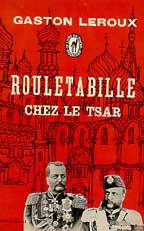
1. Des stéréotypes à la théâtralisation
3. Des éléments de littérarité dans les deux œuvres
Retour au sommaire de cette maîtrise.
La représentation de la Russie dans les œuvres doit autant à l’imaginaire des auteurs qu’à un vaste intertexte hétéroclite : romans français, russes, écrits journalistiques, le tout plus ou moins contemporain. Les auteurs réinvestissent un matériau qui est mis à leur disposition par l’imaginaire collectif et jouent avec les stéréotypes nationaux.
L’appui idéologique sur les stéréotypes peut se révéler périlleux, comme nous avons tenté de le montrer dans notre deuxième partie. L’utilisation de thèmes de la russité récurrents dans tout le roman populaire de la seconde moitié du XIXe et le début du XXe siècle procède de la volonté d’être « lisible » par le plus grand nombre mais aussi d’un jeu sur les représentations collectives (à la manière des compositeurs qui jouent sur des motifs musicaux pour les renouveler sans cesse).
1. Des stéréotypes à la théâtralisation
Les auteurs usent et abusent de tous les stéréotypes, poncifs, clichés[1],... pour caractériser la Russie, les exemples que nous avons mis en évidence dans la première partie le montrent clairement. Cela conduit à une chaîne de conséquences : l’usage de stéréotypes amène à une surdétermination. Mises en avant si fortement , les caractéristiques de la Russie rendent la russité des œuvres peu « crédible ». Le pays des tsars et leurs habitants sont déréalisés (conséquence de l'usage abusif des stéréotypes et de la surdétermination). Tout ne plus être lu que comme « décor », les intrigues, les personnages et les lieux,… tout dans Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre est placé sous le signe de la théâtralisation.
1.1. Surdétermination de la russité de l’espace et des personnages
Dans la construction du décor de leur œuvre, il s’agit avant tout pour les auteurs de russifier le Russe. Cela passe par l’utilisation d’un réseau lexical serré autour du simple mot « russe » (comme nom ou adjectif, il apparaît à 55 reprises dans Rouletabille chez le tsar) qui est rarement remplacé par une périphrase. Plus encore, la russification du Russe passe par l’emploi de nombre de stéréotypes, de ces images figées de la Russie dans l’imaginaire collectif français. Tout est mis « à la mode russe » (expression employée dans CC, p 543) et les personnages russes agissent « à la russe » (expression employée dans RCT, p 291). Dans le discours tenu sur l’autre, ce dernier a peu de place : par rapport au cadre de référence – le cadre de référence français, considéré comme étant celui de la normalité – le Russe ne peut être qu’inférieur car différent, a-normal. La russité est déterminée par les divers éléments, que nous avons relevés dans notre première partie, qui sont censés la caractériser : tout est néanmoins marqué par une forte axiologie. Dans les œuvres populaires les couples France/Russie, enquêteurs français/policiers russes,… doivent reposer sur de pures oppositions. Cette recherche de la pureté oppositionnelle conduit à poser des contrastes le plus souvent violents entre les deux parties de l’axe référentiel autour duquel se bâtissent les décors et les personnages : tout doit être simple et dans l’économie des œuvres, le stéréotype permet de simplifier la perception du monde.
Pourtant la saturation des stéréotypes à l’œuvre dans notre corpus surdétermine plus la Russie qu’elle ne la détermine. Le stéréotype est une idée toute faite, non remise en cause, banale et réductrice; simpliste, le stéréotype n’admet pas la nuance et donne un caractère général (LA « russité ») aux assertions présentes dans les œuvres.
Ainsi, les auteurs recourent massivement à la généralisation pour caractériser ce qui est russe. Rouletabille reconnaît, dans le train qui le conduit en Russie, le nihiliste chargé de l'exécuter grâce aux lunettes que l'assassin en puissance porte :
« D'abord, il avait des lunettes. Tous les nihilistes portent des lunettes en voyage ».( RCT, p 22, c’est nous qui soulignons)
C’est bien connu…
Rien ne semble pouvoir échapper aux généralisations dans les œuvres de notre corpus : le climat…
Le ciel, à cet instant s’était brusquement recouvert. Il commençait à tomber une de ces neiges serrées et dure dont les averses sont coutumières à Saint-Pétersbourg (CC, p 791, c’est nous qui soulignons)
… les vêtements…
« Il [ Rouletabille] est là ! fait Ermolaï à voix basse.
Ermolaï, au besoin, aurait pu se taire, car la générale eût été renseignée sur la présence d'un étranger dans le petit salon par l' attitude d' un individu au paletot marron, bordé de faux astrakan comme on voit à tous les paletots de la police russe (ce qui fait reconnaître les agents secrets à première vue). (RCT, p 13-14)
… l’architecture russe…
L’homme ouvrit les deux fenêtres intérieures, car il y toujours des doubles fenêtres aux maisons russes. (CC, p 547)
… ou encore l’urbanisme :
Dépassant la dernière voiture, et quittant la perspective de Nicolas, l’étrangère s’engagea dans une nouvelle rue large comme sont toutes les rues de Saint-Pétersbourg, déserte encore, car toutes les rues sont désertes à pareille heure et à pareil temps. (CC, p 556)
La généralisation est convoquée en tant que moyen de lecture du « réel » russe. Dans le même temps il s’agit pour nos auteurs d’étonner le lecteur car la préoccupation essentielle dans la caractérisation de la Russie est exotique et réside dans la recherche du typique. Ce qui compte c’est l’apparence, ce qui apparaît comme russe, à la surface de la russité : la Russie « réelle », pourtant connue par Gaston Leroux après les séjours qu’il y a fait, passe au second plan. Les auteurs mettent en scène ce qui est amusant, curieux, typique, pittoresque en un mot : bizarre. Le pittoresque russe mis en scène est l’insistance sur quelques motifs dont le but est d’apporter au lecteur un dépaysement. Le répertoire des motifs conduit à des stéréotypes déréalisant et stigmatisant le pays des tsars. La Russie n’est qu’un simple décor et les Russes des éléments du décor (avec tous les archaïsmes possibles et une forme d’a-temporalité).
La Russie n’est pas singulière mais typique. Partant, elle ne peut être pas interprétée. Les Français plaquent une identité « russe » unique sur les habitants du pays des tsar. Certes, on trouve des affirmations sur la diversité des peuples de Russie chez Souvestre et Allain mais avec une globalisation des caractères, mœurs et comportements présentés comme russes. Les particularités s’effacent derrière le caractéristique.
Nous sommes face à une sorte de surenchère distinctive : tout ce qui distingue la Russie de la France est exploité et mis en avant, d’où l’insistance sur le pittoresque :
[…] le cocher déjà excitait ses chevaux, trois robustes bêtes attelées côte à côte, et surplombés par les arceaux de la sonnette, qui font partie du pittoresque harnachement russe. (CC, p 557, c’est nous qui soulignons)
Ainsi surgit un paradoxal « exotisme familier » au lecteur. L’écriture de la Russie telle qu’elle apparaît dans les œuvres de notre corpus se fonde sur des schémas préétablis : elle répond à une demande du stéréotype et comble l’espérance d’un retour du même, du déjà-lu.
L’écriture de la Russie dans les deux œuvres se révèle bien être une forme d’écriture exotique :
On réservera le qualificatif d’« exotique » à la représentation des hommes et des sociétés qui n’appartiennent pas à l’Europe, et qui constituent par là son altérité.[2]
La question qui se pose est la suivante : la Russie est-elle européenne ? Assurément non pour les auteurs qui la relèguent aux confins de la civilisation européenne, au mieux à ses marges, au pire en dehors de l’Europe, en lien avec l’Orient et de tous les défauts et tares que ce dernier se voit imprimer par la civilisation dominante. Dans le régime d’oppositions qui se révèle dans les œuvres de notre corpus, l’opposition Russie/France rejoint l’opposition Orient/Occident.
1.2 La déréalisation
L’articulation entre généralisation et surdétermination de la russité conduit à une simplification du réel qui a en partie pour origine le caractère même des œuvres. Les schèmes interprétatifs de la réalité russe ne sont développés que sommairement pour ne pas entraver l’intrigue. Ils doivent être facilement lisibles et le refus de présenter la complexité de la Russie au niveau géographique, social, humain, politique, etc., permet de ne pas heurter le lecteur dans son travail de déchiffrement du texte. En re-présentant la Russie telle que le lecteur la connaît déjà, les auteurs vont au plus efficace, tout doit être évidemment russe, comme si cette Russie des œuvres coulait de source. A partir de là, la recherche de l’apparence des choses limite la connaissance de la Russie à sa surface :
[Les romans populaires] n’offrent qu’un décor qui s’affiche comme tel. Maisons, rues, couloirs d’hôtels n’ont souvent pas d’épaisseur : mince pellicule de faux-semblants, plans découpés et assemblés comme dans un diorama, leur seule réalité réside dans leur surface, sur laquelle des scènes rapides paraissent être projetées.[3]
Le miroitement de la surface dépasse le seul décor pour contaminer tous les aspects de la réalité russe que nous donnent à lire les œuvres. A partir de cette seule surface s’élabore une représentation systématique, simplificatrice et généralisatrice, d’où la « spectacularisation » de la Russie dans les deux œuvres. Le schéma qui consiste à valoriser la différence la plus spectaculaire et à la traiter sur le mode de l'incongruité plaisante ou inquiétante domine largement : est ainsi incongrue l’habitude de donner le pourboire avant d’obtenir le service, est inquiétante la menace constante de l’attentat. Dès lors la Russie peut être facilement stigmatisée ou folklorisée et la réalité russe se dissout dans des images, des clichés, des stéréotypes. A force d’étayer la représentation du pays des tsars sur des idées reçues, des lieux communs, des stéréotypes et des préjugés, les auteurs masquent derrière les soutènements de l’écriture la vérité de la Russie. L’archétype de la russité qui apparaît à la lecture est fortement architecturé par l’ensemble des évidences « doxiques ». La surdétermination sape de fait la vérité de représentation. La Russie est de ce fait « mé-connue ». Nous sommes ici en plein processus de déréalisation et de réification de la Russie dans des stéréotypes nationaux et culturels. Divers motifs incontournables (ré)apparaissent de manière obsessionnelle et la Russie se limite à ce répertoire de motifs :
Comme les références qu’elle [la paralittérature] s’accorde sont le plus souvent de seconde ou de tierce main, il est nécessaire que le hors-texte soit déjà un langage, un réservoir dans lequel puise l’auteur à la recherche d’une quantité relative réduite d’éléments informés, constants, un réservoir en lequel repose un sens dégagé des vicissitudes de l’Histoire, et cet effacement de l’histoire répond à l’isolement topographique de bien des séries.[4]
Ce processus d’exploitation d’un répertoire de motifs engendre une réduction de l'objet à l’état de catalogue de stéréotypes parfois obsessionnels et d’idées reçues. Le savoir de la France sur la Russie est la Russie. La « spectacularisation » de la Russie, l’insistance sur le bizarre, autant d’éléments qui nous montrent que nous sommes entre la fantaisie exotique et le réalisme de l’étrange. Nous sommes loin d’une tentative de restituer la Russie dans sa réalité.
La déréalisation conduit à la construction d’univers de l’imaginaire dans lesquels les auteurs (ré)investissent tous les stéréotypes, poncifs, clichés et lieux communs.
Un passage particulièrement marquant du roman de Leroux est celui de la promenade de Trébassof à l’invitation de Rouletabille. Une certaine poésie du lieu se révèle sous la plume de Leroux. Dans l’économie propre au genre du roman policier, il pourrait s’agir du calme annonciateur de tempête. Pourtant la description semble répondre à d’autres impératifs que celui de l’avancée de l’intrigue. Cette aimable bergerie fait coexister dans le roman la poésie et la menace de la violence. La description de la Russie oscille entre violence, coercition, imaginaire et irréalité poétique.
De même l’isolement quasi complet de la datcha dans Rouletabille chez le tsar et de la résidence de Gattchina dans La Cravate de chanvre participent à la déréalisation de la Russie : les lieux de l’action ont pour « caractéristique la plus évidente […] la séparation d’avec l’univers socio-historique dans la contemporanéité duquel ils se situent pourtant très clairement »[5]. La réalité est condamnée à s’effacer :
Comme si le fonctionnement même de l’intrigue policière dépendait de l’isolement de son cadre spatial, tout comme il implique l’effacement de la dimension historique de sa temporalité
[…]
Aussi bien, l’intrigue policière devrait logiquement se dérouler dans un cadre spatial relativement restreint […] cadre dont le texte soulignerait par conséquent les limites, la clôture, bref : la sécession d’avec l’univers environnant.[6]
L’histoire entre en conflit avec l’Histoire. Les références à l’actualité, contemporaine du moment de l’écriture, servent à ancrer les œuvres dans une réalité connue par les lecteurs pourtant « la référence historique ne semble généralement surgir dans ces récits que pour être dés-historicisée[7] ». Il n’existe dès lors qu’un vague arrière-plan historiquement vérifiable qui cristallise tous les fantasmes projetés par la France sur la Russie.
La déréalisation de la Russie semble aussi le résultat du statut du personnage de roman populaire qui induit un traitement particulier de l’espace :
A l’inverse de ce qui se passe dans le roman d’analyse, le personnage [de roman populaire] ne s’inscrit pas dans une durée, il n’a aucune profondeur. Il est unidimensionnel et ne connaît d’autre catégorie que l’espace.
D’où la multiplication des espaces qui compense l’absence du temps, la pluralité des paysages et de déguisements qui compense l’absence de profondeur et de devenir.
[…]
Les paysages sont des décors, des lieux qui n’existent que pour servir de cadre aux exploits des héros. Seul le présent compte et le ponctuel. L’espace est éclatement de toiles de fond […].[8]
A force de stéréotypes, les auteurs construisent l’arrière-fond géographique et humaine de leur roman. La Russie est présentée par les œuvres comme réaliste grâce au réinvestissement de l’ensemble des « connaissances » de la doxa, paradoxalement la solidité de l’édifice référentiel est sapée et la toile de fond se déchire pour montrer le vide. A force d’être trop re-connue, un doute s’installe sur la réalité de la Russie des œuvres et sur les écarts entre le pays des tsars de la fiction et le pays « réel ». Dans cette Russie déréalisée et largement dés-historicisée, les personnages évoluent sur une scène factice, fruit d’un exotisme de pacotille.
1.3 La théâtralisation ou la Russie comme décor
Les auteurs délimitent un objet comme « russe », ils donnent à voir ce qu’est la Russie, il ne s’agit dès lors que d’une re-présentation, une image figée dans les différents tropes utilisés – et attendue par les lecteurs. La Russie, ses monuments et ses habitants sont réifiés ; ils sont réduits au rang de décor dans lequel viennent se mouvoir des personnages français.
Ce phénomène tire, en partie, son origine des conditions d’écriture particulières auxquelles sont soumis les auteurs :
« Les conditions de l’écriture (ou plus, exactement : de la dictée) de chacun des épisodes de Fantômas sont d’abord définies par la position de leurs auteurs, et, ensuite, par la hâte à laquelle les délais de parution les contraignent. Il ne faudrait jamais perdre de vue que Fantômas est un ouvrage de bout en bout « parlé », ce qui, tout ensemble, justifie et explique ce « style déplorable » dont parlait, avec humour, Max Jacob. C’est qu’il n’y a plus de « style » justement, mais une sorte de coulée verbale, étonnamment pressée, qui s’inscrit entre la rêverie et le réel. Ce n’est pas assez dire : les auteurs sont des journalistes, et, par cela même, leur mémoire est dressée à retenir ce qu’il y a « dans l’air », de sensationnel. Le réel qui se perçoit dans Fantômas est, avec naturel, généralement exceptionnel. Il semble que les auteurs ne retiennent que les convulsions de la société, mais non son état normal. Ils sont fascinés par tout ce qui transgresse l’état du quotidien : la machinerie industrielle de la « Belle Epoque », chemin de fer, métropolitain, courses cyclistes et automobiles ; l’architecture nouvelle, qui découvre le fer comme matériau ; souvenirs vivaces des crimes anarchistes, saisis, maintenus dans le légendaire dans laquelle, on le sait, nombre d’intellectuels ne ménagent pas leur sympathie (Laurent Tailhade, Francis Vielé-Griffin, etc.) ; naufrages fabuleux, catastrophes urbaines, injustices, couvertes par l’Ordre moral… Fantômas se situe assez clairement dans cette hantise d’une vie intensément « moderne ». Le réel, dès lors, cède le pas à une mythologie du réel. Il n’est plus déchiffré, perçu, compris dans son déroulement constant ; mais, au contraire, le voilà démasqué (tout autant qu’obscurci) par un réseau discontinu de significations insolites, brutales, en quelque façon : monstrueuses. Bref, c’est le « réel » de la Presse à sensation. » [9]
Aussi retiennent-ils de la Russie ce qu’elle a de plus sensationnel, de plus étrange, de plus radicalement différent d’avec la France : de plus spectaculaire pour le lecteur. C’est une Russie mythique qui surgit de l’écriture de Souvestre et Allain et elle est, par bien des côtés, « monstrueuse », une Russie grand-guignolesque ; sanglante et burlesque. Dans le processus de monstration, les auteurs « spectacularisent » la Russie en rendant théâtraux différents éléments.
Ainsi les auteurs théâtralisent-ils l'espace :
On approchait de « la pointe » . Jusque-là la promenade avait été d'une grande douceur champêtre, entre les petites prairies traversées de frais ruisseaux sur lesquels on avait jeté des ponts enfantins, à l'ombre des bois de dix arbres aux pieds desquels l'herbe, nouvellement coupée, embaumait. On avait contourné des étangs, joujoux grands comme des glaces sur lesquels il semblait qu'un peintre de théâtre eût dessiné le cœur vert des nénuphars. Paysannerie adorable qui semble avoir été créée aux siècles anciens pour l'amusement d'une reine et conservée, peignée, nettoyée pieusement de siècle en siècle, pour le charme éternel de l'heure, aux rives du golfe de Finlande. (RCT, p 108)[10]
L’homme façonne un paysage tel un décorateur de théâtre. Il s’agit ici d’un décor d’aimable bergerie minutieusement conservé. Ceux qui s’y meuvent se déplacent sur une scène étant tour à tour acteurs et spectateurs :
Dans les voitures, des têtes se retournaient ; le général, se rendant compte de l'émotion produite par sa présence, pria Matrena Pétrovna de pousser son fauteuil dans une allée adjacente, derrière un rideau d'arbres où il pouvait jouir du spectacle en toute sérénité. (RCT, p 110)[11]
L’analogie entre le paysage et le théâtre apparaît fortement, Trébassof se postant derrière un rideau d’arbres pour mieux profiter du spectacle. C’est à un véritable spectacle de la Russie que nous invitent les auteurs.
Tout ceci est donc faux, de la fausseté d’une représentation théâtrale. L’intrigue n’échappe pas à cette théâtralisation générale qui englobe la Russie :
- Je dis, continua le général, que j'en ai assez de cette comédie et que, puisque M Koupriane n'a pas su arrêter ces gens-là, et que, de leur côté, ils ne veulent pas se décider à faire leur besogne , je vais aller moi-même les mettre à la porte de chez moi ! (RCT, p 336-337)[12]
La menace qui pèse sur Trébassof, l’ensemble de cette histoire et des rebondissements sont assimilés à une vaste comédie (mot que Leroux met lui-même en italique pour mieux le souligner). Même les moments les plus tragiques se déroulent comme au théâtre :
Et, tout à coup[13], Rouletabille monta sur l'escabeau fatal. On crut qu'il était enfin décidé à mettre fin à cette comédie et à mourir convenablement ; mais il n'était monté là-dessus que pour prononcer un discours [...] (RCT, p 393) [14]
La mort de Rouletabille marquerait la fin de ses aventures, de cette comédie, l’attitude même du reporter est celle du comédien qui monte en scène, scène certes inconfortable puisqu’il s’agit de l’escabeau du condamné à la pendaison, et s’apprête à déclamer une forte tirade.
Le vocabulaire du théâtre imprègne fortement les deux œuvres. Dans La Cravate de chanvre, les personnages français revêtent deux voire trois ou quatre identités : Fantômas/Boris Prokoff, Hélène/Olga, Fandor/Alexis/Vassili, Juve/M. Pol/Roger Darmont/le cocher Nick. Pour assurer la de leur nouvelle identité, ils se maquillent :
[…] arrivé devant sa table de toilette, [Fandor sous le masque d’Alexis] trempait une serviette dans l’eau et s’en frottait vigoureusement le visage.
la serviette se tachait alors de couleurs de toutes sortes : du rouge, du bleu, du noir, une pâte épaisse la maculait. ceci prouvait tout simplement qu’Alexis devait être maquillé.
Le doute n’était d’ailleurs même pas permis quelques instants plus tard, car ce même Alexis avait alors arraché complètement une perruque qu’il portait jusqu’alors, et dépouillé les moustaches postiches qui avaient réussi à le rendre méconnaissable. (CC, p 581)
Les artifices théâtraux permettent le jeu dramatique et la progression de l’intrigue :
Jérôme Fandor avait si bien fait l’acteur, si bien tenu l’emploi de gourde, comme il se le disait à lui-même, que le bureau l’envoya le lendemain chez Prokoff [occuper la fonction de domestique]. (CC, p 584)
En usant du vocabulaire technique du théâtre, les auteurs exhibent la théâtralité de leurs œuvres ; ce ne sont pas des romans dans la lignée réaliste ou naturaliste mais des livres où règne en maître l’imaginaire des auteurs, tout est fait de stuc et de carton-pâte : « par l’étalage non déguisé […] du vocabulaire dramatique, la série étale son artificialité et comme les conditions de sa propre production. Elle ne prétend pas réaliste, elle se donne comme invention, et, du coup, les maléfices même de l’imaginaire sont désamorcés puisqu’ils ne peuvent agir que s’ils sont pris au premier degré. Il existe une hygiène du faux et du faux-semblant. »[15]
Pour mieux souligner encore cette dimension théâtrale de leurs œuvres les auteurs donnent au lieu même du spectacle une place importante. Juve se produit comme orateur au théâtre du palais impérial dont la scène, le foyer, les galeries et les coulisses nous sont décrits (CC, p 689 à 697). Quant à Rouletabille, il assiste à un spectacle à Krestowski :
L’établissement de Krestowski, qui s’élève dans les Iles comme celui de l’Aquarium, n’est ni un théâtre, ni un music-hall, ni un café-concert, ni une foire, ni un restaurant, ni un jardin public : il est tout cela à la fois et à plusieurs exemplaires. Théâtre d’été, théâtre d’hiver, scènes de plein air, salles de spectacle, montagnes russes, exercices variés, divertissements en tous genres, promenades fleuries, cafés, restaurants, cabinets particuliers, tout a été réuni là de ce qui peut amuser, charmer, entraîner aux plus folles orgies, et faire attendre l’aurore avec patience aux malheureux qui ne peuvent goûter le sommeil qu’à la troisième ou quatrième heure du jour. (RCT, p 198-199)
Vertigineuse mise en abyme du spectacle dans le spectacle : ne s’agit-il pas d’une invitation à prendre les œuvres comme des divertissements, des passe-temps, du domaine du théâtre baroque, ouvertes à de multiples possibilités spectaculaires ?
« Dans ces conditions, le théâtre ne constituerait, à tout prendre, que la matérialisation ou l’extériorisation des conditions de l’imaginaire ou de la production fantasmatique »[16]
Dans ces jeux d’artifices éclatent la dimension ludique des romans, le but n’est pas la représentation réaliste mais la représentation théâtrale, tout se trouve donc dramatisé, exagéré, rendu extraordinaire jusqu’à l’outrance : « Tout et tous sont donc en représentation. Il n’y a pas de « réel » ; mais seulement une scène, une illusion comique perpétuelle et diaboliquement agencée. »[17]
L’accumulation des stéréotypes, des images attendues de la Russie contrarie l’illusion référentielle et par là même la réduit voire la détruit en la dénonçant pour ce qu’elle est : une illusion :
Car, en définitive, pas question de retrouver le réel solide sous nos yeux ou nos pas, pas possible de repérer un point fixe ; tout vacille et échappe à la prise. Nous sommes bien dans le domaine de l’hallucination. Le lecteur, pris dans un labyrinthe de glaces, cherche en vain une origine autre que fantasque/fantasmatique, canularesque/obsessionnelle. Cette écriture sans source autre que purement onirique et/ou scripturale s’appelle justement la Littérature. Le référent vériste s’éloigne.[18]
Cet éloignement du référent vériste ne conduit pas à un échec mais au surgissement de l’imaginaire car tout le décor et l’intrigue sont théâtralisés, le lecteur est en plein simulacre de la réalité russe mais jamais face à la Russie « réelle » :
Pour l’acteur […] la représentation théâtrale est un simulacre. Il se grime, il s’habille, il joue, il récite. Mais, lorsque le rideau tombe, les lumières éteintes, il est rendu au réel. La séparation des deux univers demeure absolue.[19]
La Russie des œuvres est une pure représentation. C’est à une lecture d’une Russie poétique que nous invitent les auteurs. Francis Lacassin, dans une lettre fictive adressée à Gaston Leroux, remercie l’auteur de son refus du référent réaliste :
« Et vous, vous avez compris que la littérature populaire doit assumer sa fonction onirique sans l’excuser ou la justifier. Sans tenter de rendre l’imaginaire crédible et vraisemblable. Au lieu d’excuser son intrusion dans la réalité, vous avez aboli les frontières qui protégeaient la réalité, vous avez même nié son existence »[20]
La Russie livrée à la lecture est avant tout fantasmée et abstraite. Toute la société russe est faite de chausse-trappes et de machinations. Tout cela explique que ces œuvres aient pu séduire les surréalistes friands de littérature onirique car les auteurs, s’ils ne négligent pas l’ancrage référentiel, présentent un espace russe en partie reconstruit par l’imaginaire, ce qui peut dérouter le lecteur de romans « réalistes ». Ils font ainsi le lien avec un imaginaire qui tient une place extrêmement importante depuis longtemps dans la culture populaire (on peut par exemple penser aux contes populaires).
La Russie semble ce lieu épuré de nombreuses références. Certains voient dans le roman populaire un parent éloigné de ce qu’est l’écriture moderne, et citent Raymond Roussel. Les lieux de la Russie ressemblent en effet au Locus Solus rousselien : ils sont épurés et, dans le même temps gardent une impression de réalité.
Dans ces deux romans, Gaston Leroux, Pierre Souvestre et Marcel Allain étalent complaisamment les codes sociaux qui permettent la reconnaissance de la Russie : ce sont les stéréotypes. Le pays des tsars décrit dans les œuvres n’a pas pour référent le « réel » mais l’ensemble des écrits, fictifs ou non, qui alimentent l’imaginaire collectif de leur époque. Dans ces textes extrêmement codés (code du roman populaire, code du roman policier, code de l’idéologie dominante), tout est mouvant. Tout est « jeu » aux sens mécanique et ludique du terme.
Les œuvres de notre corpus n’ont pas la pesanteur didactique de celles d’un Jules Verne – dont les descriptions sentent souvent la fiche - ni la lourdeur moralisatrice d’un Xavier de Montépin. A la lecture de Rouletabille chez le tsar et de La Cravate de chanvre toute une dimension ludique apparaît. Il ne peut s’agir uniquement d’un effet de lecture, qui serait le résultat d’une prise au second degré d’une sous littérature. Avant la Première Guerre Mondiale, le roman populaire connaît un second âge d’or (après celui du feuilleton des années 1830-1850), parvenu à une sorte de maturité et de conscience de lui-même, il condense des thèmes, réutilise tous les stéréotypes sans cesse ressassés après soixante-dix ans d’histoire et n’hésite plus à parodier et même s’auto-parodier : il quitte complètement le domaine du sérieux pour rejoindre massivement ceux du jeu et de la dérision.
2.1 Le jeu avec les stéréotypes
Indéniablement les médiations culturelles, sociales et idéologiques orientent le regard de l’écrivain, le précèdent et le déterminent parfois. Il existe un véritable conditionnement de la parole de l’écrivain par la doxa. Dans ce cadre, le stéréotype peut être défini comme un système collectif de préjugés. auquel n’échappent pas les auteurs. Ainsi est acclimatée l’étrangeté de la Russie grâce à des représentations et des objets connus :
[…] le roman populaire est le lieu de sédimentation de stéréotypes accumulés au cours des âges et fondus en un matériau presque homogène.[21]
Pourtant, nos auteurs usent aussi du paradoxe. On trouve ici une dimension ludique : il existe un jeu des stéréotypes mais aussi avec les stéréotypes de la part de Leroux et Souvestre-Allain.
2.1.1. Le jeu avec les images mentales collectives des Français
Tous les stéréotypes sur la Russie sont présents, nous l’avons vu, dans les œuvres que ce soit l’hiver russe, la Sibérie, les nihilistes ou l’« âme slave » et figent les Russes en quelques traits grossiers. Ces préjugés traversent une bonne partie de la littérature française (populaire ou non) au cours des siècles. Ils ne sont pas « neufs » et surtout pas propres à la fiction. Les lecteurs les partagent en grande partie[22] :
Le propre du stéréotype est d’être intériorisé par les membres d’une collectivité, comme s’ils l’avaient eux-mêmes produit. En d’autres termes, l’espace social n’est pas seulement un espace de réception, mais également de diffusion.[23]
Pour plaire au lecteur, les auteurs populaires doivent être accessibles, le stéréotype se trouve être le moyen le plus économique pour créer de la lisibilité.
La description de la Russie étant appuyée sur tant de stéréotypes – tous les stéréotypes de la russité ? – le pays des tsars et les Russes présents dans les œuvres ne sont pas connus mais re-connus par les lecteurs. Dans cette perspective, les clichés, poncifs, lieux communs et stéréotypes qui organisent la description de la Russie en
réduisant les mondes lointains par schématisation et généralisation [...] permettent la création, ou plutôt la fabrication, d'un monde à la fois dépaysant et connu, reposant sur le principe d'une distance mimée, artificielle, qui renvoie à une série familière de conventions.[24]
L'exotisme se construit donc autour de référents que le lecteur comprend comme russes. Ces référents sont de différentes natures. Certains sont a-textuels, c'est à dire non spécifiques au texte, mais directement issus du monde réel : la « vraie » Russie. D'autres sont textuels, construits par le texte (la maison de Boris Prokoff ou la Datcha du général Trébassof). Enfin le lecteur investit ses savoirs pragmatiques directs et médiatisés, ainsi par exemple toute une masse mouvante que Genette nomme intertextualité. L'ensemble des savoirs du lecteur est vaste - et difficile à saisir car il dépend de chacun - et recouvre ce que Greimas appelle « l'univers référentiel du savoir du destinataire » [25] Ces savoirs ont une extension générique très forte : ils peuvent provenir de textes romanesques, littéraires mais aussi journalistiques et de toute autre forme d'écriture et encore de l'expérience personnelle, des conversations ce qui rend l'analyse de ce domaine extrêmement complexe car très dépendante du vécu de chaque lecteur.
Schéma de la construction de l'espace de l'exotisme russe:
|
Texte |
Référents |
Exemples |
Résultat |
|
|
a-textuels
|
Les « vraies » Russie, Sibérie, le « vrai » palais impérial |
|
|
Voix auctoriale et narrative |
textuels |
Les différents lieux de l'action |
Construction de l'univers diégétique et de son sens |
|
|
lectoriaux |
les « savoirs » du lecteur |
|
Aussi sommes-nous en droit de nous demander si Gaston Leroux, Pierre Souvestre et Marcel Allain ne représentent pas le savoir commun des Français de l'époque. Dans un manuel scolaire de 1920 on peut par exemple lire ceci à propos de la Sibérie :
Pendant longtemps la Sibérie ne fut qu'une terre de châtiment, un vaste bagne où furent déportés les exilés politiques et les condamnés de droit commun.[26]
Quant au tsar il est présenté ainsi dans ce même ouvrage :
Nicolas II était un prince honnête comme Louis XVI, mais comme lui d'une grande faiblesse de caractère.[27]
Sa politique est qualifiée de
réaction aveugle ne [pouvant] aboutir qu'à une nouvelle explosion révolutionnaire.[28]
Un autre manuel scolaire de 1907, à l’usage des classes de quatrième, décrit ainsi la société russe :
En haut de l’échelle sociale se trouve une aristocratie très brillante, très civilisée. En bas, il n’existe qu’une masse profondément ignorante, superstitieuse, arriérée. […] La misère est grande dans les campagnes russes : peu de viande en général, rien que du pain noir et de la morue sèche ; l’ivrognerie est un mal presque universel. Quant au fatalisme du paysan russe, il est proverbial : « Ne nous inquiétons pas, répète-t-il ; il ne nous arrivera pas de mal, si c’est la volonté de Dieu. » La superstition n’est pas moins forte ; des révoltes terribles ont ensanglanté la Russie pour des prescriptions sans importance, comme le port de la barbe, l’usage du tabac, le droit de sucrer son thé. Cette demi-barbarie du peuple russe a pu faire dire qu’il n’avait qu’un vernis de civilisation plaqué sur un fond primitif de sauvagerie. Toutefois, de l’aveu de ceux qui l’ont fréquenté, le fond primitif du paysan russe est une bonté profonde et naïve.[29]
Sommes nous si loin de ce que décrivent Pierre Souvestre, Marcel Allain et Gaston Leroux? Il faut bien évidemment être très prudent sur la question du « fond de vérité » tant la représentation scolaire de la Russie semble elle aussi stéréotypée. La Sibérie a bien entendu été un lieu de relégation et d’exil, la misère des campagnes russes est grande, les soubresauts révolutionnaires au début du XXe siècle sont nombreux, nul ne le conteste, mais d’autres aspects qui pourraient infirmer ces jugements négatifs sont totalement gommés : il semble que le lecteur soit face à un « rejet a priori qui se cherche des justifications en mobilisant tous les stéréotypes disponibles[30] ». Or ces stéréotypes sont dépassés. Les nihilistes ne constituent plus vraiment la principale forme d’opposition à l’autocratique tsar. La flamme révolutionnaire est portée, depuis 1905 au moins, par de nouvelles forces politiques socialistes et communistes.
L’image de la Russie que donnent à lire les œuvres de notre corpus est donc datée, même pour les lecteurs contemporains de la première publication. L’autocratie russe est déjà minée de l’intérieur notamment après la défaite face au Japon et les troubles révolutionnaires qui l’ont accompagnée. Les stéréotypes participent d’un imaginaire collectif qui se trouve, comme souvent, en décalage avec l’actualité :
[les stéréotypes] grave[nt] une image stable à l’intention de la collectivité qui s’en empare. D’où la récurrence de ces stéréotypes issus du passé, et dans lesquels nous observons une image de nous-mêmes décalée de notre apparence présente […].[31]
2.1.2. Le recours systématique aux stéréotypes et leur bouleversement
Cette accumulation de stéréotypes dans Rouletabille chez le tsar et dans La Cravate de chanvre nous paraît suspecte ; en effet « jouer avec le cliché, c’est l’exhiber dans sa nature de cliché et le faire ressortir encore davantage, bien loin de l’abolir.[32] »
Il semble bien qu’il s’agisse dès lors d’une activité de création basée sur des éléments préexistants. Les auteurs usent des stéréotypes. Ils les usent même jusqu’à la corde. En les utilisant et en les usant jusqu’à leurs dernières limites, Leroux, Souvestre et Allain dévoilent leur nature de stéréotypes. En les usant, les auteurs révèlent leurs ficelles de création. La systématisation de l’utilisation de tous les stéréotypes attachés à la Russie conduit à la formation d’un catalogue, une sorte de dictionnaire des idées reçues.
Nous sommes face à un étrange phénomène d’énonciation – dénonciation du stéréotype :
Le cliché reste cliché, mais, au même instant parce qu’exhibé comme cliché, il est dénonciation de sa propre nature ( au double sens de révélation/dévoilement et de condamnation/distanciation ironique et caustique).[33]
Utiliser le motif « nihiliste » dans toute sa dimension de stéréotype (de jeunes étudiants exaltés, porteurs de bombes, chimistes à leurs heures, adeptes du secret et des lieux étranges,…) c’est justement révéler le topos qu’il constitue, l’utiliser c’est le dévoiler. En même temps c’est le condamner comme stéréotype. Toute nouvelle utilisation est forcément reçue comme du déjà-lu ; enfin c’est créer un effet de distanciation. Oui les auteurs utilisent des stéréotypes attendus mais ils n’en sont pas dupes et ces clichés permettent de jouer sur l’ironie, la parodie, voire l’auto-parodie. C’est aussi jouer avec les savoirs du lecteur. Quand il pense à la Russie, certaines images s’imposent, fruits d’un imaginaire collectif que le lecteur projette sur le signifiant « Russie ». Il semble donc nécessaire de renverser les perspectives : les auteurs ne réduisent pas simplement la Russie à des stéréotypes mais utilisent des représentations archétypales communes telles qu’elles sont présentes dans l’imaginaire collectif des récepteurs. La mise en avant des stéréotypes peut se révéler être au final une dénonciation ludique. En énonçant le stéréotype, les auteurs le dénoncent comme tel.
2.1.3. L’influence de la littérature russe :
L’influence de la littérature russe sur la construction de la Russie dans les œuvres de Leroux et Souvestre-Allain est difficile à mesurer. Peu d’éléments permettent d’affirmer qu’ils ont lu les auteurs russes, rien ne permet non plus de l’infirmer et quelques indices nous portent à croire que cette dernière hypothèse n’est nullement à écarter. Possédant une solide éducation, fréquentant les milieux artistiques, s’étant essayé à la « littérature littéraire », informés, de par leur métier de journaliste, de l’actualité culturelle, les auteurs ne nous semble pouvoir ignorer la culture russe. Dostoïevski, Gogol, Tolstoï, Tchékhov,… ont été traduits en français. C’est aussi en partie de la littérature russe, par une lecture directe – ce qui semble certain pour Leroux –, par ouï-dire, par les critiques littéraires parues dans les journaux, que nos auteurs populaires se font une idée de la Russie et qu’ils la retranscrivent dans leurs œuvres.
Divers éléments, parfois épars certes, plaident en faveur d’une influence de la littérature russe sur nos auteurs. Dans les thèmes abordés tout d’abord. Le fatalisme russe maintes fois souligné dans les œuvres doit certainement provenir en partie de la doctrine tolstoïenne de la non-résistance au mal, issue du traité moral Le Royaume de Dieu est en nous paru en 1893 en Russie. Dans l’article intitulé La Douma publié par Le Matin le 12 mai 1906, Gaston Leroux décrit ainsi la doctrine philosophique des tolstoïstes :
Il faut donc se rapprocher de la nature et, sans combattre le mal, mais aussi sans l’aider, atteindre la paix et la vérité, uniquement par la force de la charité et le perfectionnement moral de soi-même. Résistance passive et évangélique au mal, d’où il résultera nécessairement l’établissement du bien.[34]
La terrible répression russe est illustrée par Dostoïevski dans Souvenirs de la maison des morts (1860-1861) qui comprend des pages insoutenables sur les affreuses punitions dont étaient victimes les forçats en Sibérie. Dans cette œuvre est aussi décrite la « chaîne » des forçats et les fers. Souvenirs de la maison des morts se clôt d’ailleurs par la libération des fers d’Alexandre Pétrovitch Goriantchikov, le narrateur, qui rappelle la mise aux fers de Jérôme Fandor. Dostoïevski fait porter sa critique sociale sur le bagne et sur les raisons qui ont conduit des « malheureux » à devenir des criminels.
Les mots utilisés pour désigner la réalité russe sont parfois les mêmes : les auteurs de La Cravate de chanvre utilisent le terme « malheureux » pour parler des forçats russes. La critique du bagne russe est très forte dans La Cravate de chanvre et est une marque de l’arbitraire dans les deux œuvres.
Enfin, l’image que crée la littérature russe de la réalité russe semble réutilisée dans les œuvres de notre corpus. Les descriptions des paysages enneigés dans La Cravate de chanvre et Rouletabille chez le tsar rappellent celles des auteurs russes, par exemple ce passage extrait la nouvelle de Tolstoï intitulée Maître et serviteur :
Le traîneau s’ébranla en grinçant légèrement des patins, et le robuste étalon s’engagea sur la route couverte d’une couche de neige durcie. […]
Le village de Kresty, où demeurait Vassili Andréitchk, ne comptait que six maisons. Dès qu’ils eurent dépassé la dernière isba, celle du forgeron, ils remarquèrent aussitôt que le vent était bien plus fort qu’ils ne se l’imaginaient. On ne voyait presque plus la route.
Les traces des patins étaient aussitôt recouvertes par la neige que chassait le vent, et l’on ne pouvait distinguer la route que parce qu’elle était plus élevée que la plaine qu’elle traversait.[35]
2.2. La connivence avec le lecteur
Dans cette littérature dont la dimension ludique semble affirmée, les auteurs jouent avec le lecteur : ils lui offrent la possibilité de reconnaître certains éléments du déjà-lu dans un vaste intertexte dont l’extension générique peut être infinie : les séries Rouletabille et Fantômas, grands auteurs « classiques » ou « populaires », articles de journaux,… La « réalité » se trouve elle aussi mise en scène par les œuvres comme autant de clins d’œil et de signes de connivence avec le lecteur. Enfin, la connivence culturelle est garantie par une intertextualité foisonnante.
2.2.1. Jeu de la reconnaissance
Dans cet univers ludique, le jeu de la reconnaissance peut être interne aux séries (le lecteur reconnaît un personnage avant même qu’il ne soit nommé), ou externe. Dans ce second cas deux possibilités existent : la reconnaissance du déjà-là – s’appuyant sur le savoir encyclopédique du lecteur - et celle du déjà-lu – reposant sur l’intertextualité.
Dans sa fonction de gestion de la lecture (entre rappel de ce que le lecteur doit connaître et appel à ce qu’il va découvrir), le portrait de Fantômas reprend le topos du faux inconnu : le lecteur sera surpris s’il n’a pas reconnu le Génie du crime, s’il l’a reconnu il se pensera malin et sera satisfait.
Malgré lui, il [Juve] croyait voir surgir devant ses prunelles une vision fantastique.
C’était celle d’un colosse, d’un géant, d’un personnage à la fois légendaire et surhumain !
Il s’agissait d’un homme correctement vêtu d’un habit noir, coiffé d’un chapeau haut de forme, ganté de blanc.
Cet homme portait sur le visage un loup noir, masque symbolique de ses procédés mystérieux, de ses agissements ténébreux, de sa criminelle et néfaste royauté !
Cet homme, ce colosse immense, semblait dominer la ville, l’enjamber d’un seul pas. L’un de ses pieds crevait la toiture des maisons, son autre jambe disparaissait à l’infini de l’horizon !
Génial et monstrueux, le personnage dominait tout Paris, le tenait à sa merci sous la menace de son poignard !
Il passait !…
Il semait le malheur, la mort, la ruine, et il riait de tous ces deuils !
Il était le maître, le maître de tous, le maître de tout ! (CC, p 596)
Le portrait du génie du mal fait par le narrateur en utilisant la focalisation interne centrée sur Juve est, en fait, la description de l’illustration du premier volume des aventures de Fantômas. L’image portée par le texte est déjà connue des lecteurs – et certainement même de certains de ceux qui ont vu le massif matraquage publicitaire qui accompagna la publication du premier Fantômas.
L’arrivée de Rouletabille participe aussi de ce topos du faux inconnu. Tous les indices de sa présence sont clairs : c’est un « jeune étranger » (RCT, p 9) qui arrive, il ne se laisse pas fouiller : « Excusez-moi, barinia, mais le jeune étranger, lorsque j'ai voulu le fouiller, m'a envoyé un solide coup de pied dans le ventre. » (RCT, p 9) et possède un solide sens de la répartie : « - Lui as-tu dit que tout le monde était fouillé avant d'entrer dans la propriété, que c'était l'ordre, et que ma mère elle-même s'y soumettait ? - Je lui ai dit tout cela, barinia, et je lui ai parlé de la mère de madame. - Qu'est-ce qu'il t'a répondu ? - Qu'il n'était pas la mère de madame. Il était comme enragé. » (RCT, p 9) Le lecteur retrouve ensuite toutes les caractéristiques physiques de Rouletabille :
[…] voilà que l'empereur lui envoyait, comme suprême ressource, ce jeune étranger... Joseph Rouletabille, reporter...
... Mais c'était un gamin ! Elle considérait, sans comprendre, cette bonne jeune tête ronde, aux yeux clairs et-dès le premier abord- extraordinairement naïfs, des yeux d'enfant. (Il est vrai que dans le moment le regard de Rouletabille ne semble point d'une profondeur de pensée surhumaine, car, laissé en face de la table des zakouskis dressée dans le petit salon, le jeune homme paraît uniquement occupé à dévorer, à la cuiller, ce qui reste de caviar dans les pots.) Matrena remarquait la fraîcheur rose des joues, l'absence de duvet au menton, pas un poil de barbe... la chevelure rebelle avec des volutes sur le front... ah ! Le front... le front, par exemple, était curieux. Oui, c'était, ma foi, un curieux front avec des bosses qui roulaient au-dessus de l' arcade sourcilière profonde pendant que la bouche s'occupait... s'occupait... on eût dit que Rouletabille n'avait pas mangé depuis huit jours. (RCT, p 15-16)
Dans le jeu de la lecture sérielle, la re-connaissance du personnage principal est une constante. Elle marque la connivence entre l’auteur et le lecteur : quelques indices livrés par le scripteur permettent au lecteur de reconnaître immédiatement le personnage.
Le jeu de la reconnaissance peut aussi être externe dans le cadre d’une intertextualité avec laquelle jouent les auteurs.
Dans les premières pages de La Cravate de chanvre plusieurs paragraphes débutent par il neigeait. Une double reconnaissance est offerte au lecteur : le poème « L’Expiation » de Victor Hugo et/ou le début de Rocambole Ponson du Terrail.
Victor Hugo est l’écrivain « populaire » le plus célèbre et plus lu, notamment sur les bancs de l’école primaire :
Victor Hugo est […] le seul écrivain à avoir été véritablement présenté comme tel à l’école primaire dont il est (était) le « classique » par excellence, les instituteurs donnant non seulement ses poésies comme textes de récitation mais faisant aussi parfois des récits résumant Les Misérables.[36]
Quant au Rocambole de Ponson du Terrail, il s’agit d’un « classique » du roman populaire maintes fois rééditées, lu dans toutes les classes de la société, imité, récrit par d’autres auteurs,…
Utiliser par allusion, clin d’œil ou visée parodique des références à Hugo et aux « grands ancêtres » du roman populaire, c’est mettre le lecteur en situation de déjà-lu car le jeu ne fonctionne que s’il y a face au premier joueur (l’auteur) un autre joueur fictif ou non (le lecteur) :
Les jeux ne trouvent généralement leur plénitude qu’au moment où ils suscitent une résonance complice. […] La plupart d’entre eux, en effet, apparaissent demande et réponse, défi et riposte, provocation et contagion, effervescence ou tension partagée. Ils ont besoin de présences attentives et sympathiques.[37]
2.2.2. Jeu d’échos réalité / fiction
Dans un monde construit par les fictions qui se présente comme « réaliste », un moyen économique de faire fonctionner l’illusion référentielle est de puiser dans l’actualité des éléments validant la réalité des récits donnés à lire. Certains événements fictifs se trouvent comparés à des événements historiques :
Toutefois, de ce que les bombes vivantes avaient explosé séparément, l'effet de destruction s'était trouvé amoindri, et s'il y eut beaucoup de blessés comme il arriva lors de l'attentat de la datcha Stolypine, au moins il n'y eut point de morts, en dehors des deux nihilistes dont on ne retrouva que quelques lambeaux. (RCT, p 341)
Dans Rouletabille chez le tsar, les personnages russes se repaissent des histoires de kouliganes, « ces bandits des rues » [38]. Elles alimentent la conversation mondaine :
« Il y a des kouliganes que l'on devrait inventer s'ils n'existaient pas. L'un d'eux arrête une jeune fille devant la gare de Varsovie. La jeune fille, effrayée, lui tend immédiatement son porte-monnaie, dans lequel il y avait deux roubles cinquante. Le kouligane prend tout : « Mon dieu ! s'écrie la jeune fille, je ne vais plus pouvoir prendre mon train ! - Combien vous faut-il ? demanda le kouligane. « Soixante kopecks ! – Soixante kopecks? Que ne le disiez-vous !... » Et le bandit, gardant les deux roubles, rend la pièce de cinquante kopecks à la tremblante enfant et y ajoute une pièce de dix kopecks de sa poche.
- Il m'est arrivé, à moi, plus beau que ça, il y a deux hivers, à Moscou, dit la belle Onoto. Je sortais de la patinoire et je fus abordée par un kouligane : « donne-moi vingt kopecks, dit le kouligane. » j'étais tellement effrayée que je ne parvenais pas à ouvrir mon sac à main : « plus vite » , dit-il. Enfin, je lui donne ses vingt kopecks. « maintenant, m'a-t-il fait, embrasse ma main ! » et il a fallu que je lui embrasse la main, car dans l'autre il avait son couteau.
- Oh ! Ils sont forts avec leur couteau ! dit Thadée. C'est en sortant du Gastini-Dvor que j'ai été arrêté par un kouligane qui me mit sous le nez un magnifique couteau de cuisine. « Il est à vous pour un rouble cinquante ! » vous pensez si je lui ai acheté tout de suite ! Et j'ai fait une très bonne affaire. Il valait au moins trois roubles. A votre santé, belle Onoto ! (RCT, p 226-227)
Les histoires de kouliganes ne sont pas inconnues des lecteurs du Matin, Lors de son séjour en Russie pour le journal, Gaston Leroux les a rapportées : le 12 janvier 1906 paraît un article intitulé Minutes de Russie[39]. Le reporter Leroux y rapporte une anecdote :
Hier, derrière l’église de Karsan, un kouligane vient à moi et tire, de sous sa peau de mouton, un magnifique couteau de cuisine, dont il me fait admirer et la pointe et le fil. « Il est à vous, dit-il, pour un rouble cinquante ! » Je le lui ai acheté tout de suite. Tu parles !…[40]
Dans Rouletabille chez le tsar, cette histoire – que Leroux dit avoir réellement vécue - est racontée par un personnage fictif, l’auteur Leroux y ajoute une touche d’humour – la très bonne affaire faite par Thadée. Les autres méfaits des kouliganes ont eux aussi été réutilisés, tous sont issus de ce même article : les lieux ont légèrement changé ; l’histoire du généreux kouligane se déroulait dans l’article devant la gare de Tsarkoïe-Selo, celle du kouligane qui exiger un baise-main sur la Moïka à Saint-Pétersbourg. Malgré ces légers déplacements, il s’agit d’un exemple typique de réinvestissement d’écrits journalistiques dans une œuvre de fiction.
A la plainte qu’il est difficile de trouver une arme dans Saint-Pétersbourg, un hôte des Trebassof raconte anecdote suivante :
- Il y en a encore chez mon serrurier. La preuve en est que, hier, dans la petite Kaniouche, mon serrurier, qui a nom Schmidt, est entré chez l' épicier du coin et a proposé un revolver au patron. Il lui a sorti un browning : « une arme de toute sûreté, a-t-il dit, qui ne rate jamais son homme et dont le fonctionnement est des plus faciles ». Ayant prononcé ces mots, le serrurier Schmidt a fait fonctionner son revolver et a logé une balle dans le ventre de l'épicier. L'épicier en est mort, mais pas avant d'avoir acheté le revolver. « vous avez raison, a-t-il dit au serrurier. C'est une arme terrible ! » Et là-dessus il expira. (RCT, p 227-228)
Cette histoire a été rapportée par Leroux dans L’Agonie de la Russie blanche (p 220-221). L’expérience en Russie de Gaston Leroux est donc réutilisée dans l’œuvre et pimentée d’humour noir. Ces histoires ont été télégraphiées le 5 janvier 1906 par Leroux à son journal et été publiées par Le Matin le 12 janvier 1906. L’utilité du télégraphe pour les journalistes est d’ailleurs rapportée dans Rouletabille chez le tsar :
Ces sortes de gens - les journalistes - vont, viennent, arrivent quand on ne les attend pas et quittent la société -même la meilleure - sans prévenir personne. En France, c'est ce qu'on appelle « filer à l'anglaise ». A ce qu'il paraît que c'est tout à fait poli. Enfin, ce petit est peut-être au télégraphe. Un journaliste doit compter, dans tous les instants de sa vie, avec le télégraphe. (RCT, p 58-59)
Gaston Leroux apporte à Rouletabille des éléments de réalité investis dans la fiction, devenus éléments fictifs ils sont rendus vraisemblables par leurs références au réel. Dans cette circularité réel-fiction-fiction-réel, le lecteur est pris de vertige : comment démêler le vrai du faux ? Chez les auteurs polygraphes, les différents domaines qu’ils touchent sont rarement étanches. Comme le souligne Alfu, cette pratique – l’utilisation de reportages dans l’écriture romanesque - est habituelle chez Leroux :
Les divers séjours qu’il effectue en Russie, tout d’abord pour accompagner les voyages officiels des présidents de la République, Félix Faure et Emile Loubet, puis comme correspondant du Matin à Saint-Pétersbourg, servent bien sûr de base aux deux romans qu’il situe dans ce pays : Rouletabille chez le tsar, dont des scènes entières sont recopiées sur d’authentiques pages de reportage, et Les Ténébreuses, qui doit un peu plus à ses lectures mais que Le Matin présente comme un « roman-reportage ». L’expédition qu’il entreprend à Bakou où il est témoin de massacres et de l’incendie des puits de pétrole, alimentera la seconde partie de Pouloulou, roman inédit jusqu’en 1990.[41]
Leroux n’hésite pas à se mettre lui même en scène dans Rouletabille chez le tsar, renforçant la confusion entre fiction et réalité :
C’était la nuit du 1er janvier russe... à souper... une réunion de toute beauté... toute la capitale. Là, au fond, la musique, à minuit juste, venait de commencer le bodje tsara krani, pour l'inauguration de la joyeuse année russe, et tout le monde s'était levé, comme de juste, et écoutait en silence, comme il faut, loyalement... eh bien, à cette table... il y avait avec sa famille un jeune étudiant très bien, très correct, en uniforme... ce malheureux jeune étudiant, qui s'était levé, comme tout le monde, pour écouter le bodje tsara krani, mit, par mégarde, son genou sur une chaise. Alors, vraiment, la position n'était plus déjà correcte : mais ce n'était pas une raison pour le tuer, n'est-ce pas ? Certainement non ! Eh bien, une brute en habit, un monsieur très chic a pris dans sa poche un revolver et l'a déchargé sur l'étudiant, à bout portant... vous pensez quel scandale, l'étudiant était mort ! ... il y avait là, à côté, des journalistes de Paris qui n'en revenaient pas, ma parole ! M Gaston Leroux, tenez, était à cette table, quel scandale !... (RCT, p365)
Cette incursion de l’auteur dans le récit nous semble avoir deux fonctions :
1) une fonction testimoniale, la présence du journaliste Leroux atteste de la véracité de l’événement si extraordinaire soit il,
2) une fonction de connivence avec le lecteur, Leroux s’amuse à se mettre en scène dans le décor de sa fiction. Comme Alfred Hitchcock qui apparaît fugitivement dans ses films, Leroux signe de sa présence le récit.
Dans Rouletabille chez le tsar les notes infrapaginales ne sont pas signées, déceler là une confusion absolue entre l’auteur et le narrateur serait abusive. En fait le journaliste G. Leroux « vient nourrir la mise en scène de l’écriture romanesque[42] » de l’écrivain Gaston L. Les points d’interrogation dans certaines notes infrapaginales semblent marquer la présence auctoriale et révéler un jeu du JE entre l’auteur (qui a vécu en Russie) et le narrateur (qui raconte une certaine Russie).
On trouve enfin la mention de personnages français réels dans le récit :
On chante, on s'amuse, on parle de Paris, et surtout l'on boit. Si la petite fête se termine parfois un peu brutalement, c'est encore le champagne ami et allié qui en est cause ; mais le plus souvent l' orgie garde un caractère bon enfant où certainement les sociétés de tempérance auraient fort à faire, mais où M le sénateur Bérenger ne trouverait point toujours son compte. (RCT, p 199)
Les personnages russes « réels » comme le tsar par exemple, présent dans les deux œuvres, servent de points d’ancrage avec le monde référentiel. De même, les auteurs établissent des ponts entre réel et fiction dans leur roman. Dans Rouletabille chez le tsar les informateurs de la police font indifféremment partie du réel et du monde fictif :
C’était déjà beaucoup que je l’eusse prévenu des bombes vivantes. Elles m’ont été « annoncées » par le même indicateur qui nous a fait prendre les deux bombes vivantes (des femmes s’il vous plaît) qui se rendaient au tribunal militaire de Cronstadt, après la rébellion de la flotte. (RCT, p 316, c’est Gounsovski qui parle ici)
Avec les jeux d’écho multiples entre la réalité et la création, la fiction entre en concurrence avec l’histoire :
Le phénomène est particulièrement évident dans les ouvrages policiers classiques où les références historiques semblent jouer un rôle important. Car justement, pour que la vérité s’y fasse jour, il faut généralement que la nature spécifiquement historique de tel ou tel élément soit escamotée, ou du moins problématisée.[43]
Pourtant ces références historiques sont nécessairement limitées et sans conséquences sur l’Histoire « réelle » : en cas d’interférences trop grandes avec la « grande Histoire », les auteurs verseraient dans l’uchronie, la politique-fiction,… trahiraient en somme le contrat implicite passé avec le lecteur. La fiction rattrape toujours le semblant de réalité donné par les auteurs.
2.2.3. L’intertextualité
Les auteurs, de par leur éducation, connaissent nombre d’œuvres. Ils n’hésitent pas à réutiliser une partie d’entre elles. Les œuvres de notre corpus se trouvent emplies d’une intertextualité abondante. L’aveu de cette utilisation intervient dans Rouletabille chez le tsar . Au cours d’une conversation à propos du chef de l’okrana (police politique) Athanase affirme :
Il faut qu'un chef de l'okrana soit bien avec tout le monde, avec tout le monde et son père, comme dit le joyeux La Fontaine (on connaît ses auteurs), s'il tient à son poste sur cette terre ! Vous m'avez compris, s'il vous plaît ! Ah ! Ah ! énorme rire d'Athanase enchanté de son esprit bien français […] ( RCT p 206)
Dans ce mélange entre voix narrative et voix du personnage, on discerne Gaston Leroux assurant connaître ses auteurs. Indéniablement nos auteurs connaissent leurs auteurs et jouent sur la connaissance/reconnaissance du lecteur :
Derrière le cliquetis des clichés entrechoqués et la multitude des personnages et des situations évoqués par l’écrivain hâtif, le lettré se révèle souvent. C’est son aptitude à suggérer toutes les variétés de style dans son absence de style apparent, pour les adapter à la mitraillade incessante de scènes d’une mobilité cinématographique, qui amène fatalement le lecteur à les animer avec ses réactions personnelles, mais aussi grâce au recours inconscient à un non moins ample éventail de réminiscences puisées chez les auteurs les plus divers, à commencer par ceux que l’on a pu côtoyer dans les livres de lecture de l’Ecole primaire.[44]
Le caractère intertextuel des œuvres s’inscrit dans les textes eux-mêmes par de constants appels à d’autres textes :
Le bagne russe ! la mine pestilentielle d’où l’on extrait le cuivre !
Jérôme Fandor en avait lu des descriptions. Il savait quel enfer cela représentait. Il se figurait déjà les boyaux étroits et tortueux dans lesquels les mineurs doivent descendre au risque de leur vie. Il n’ignorait pas qu’une mitrailleuse était placée à chaque bout de ces boyaux. Il connaissait la rigueur de la consigne : qu’un seul des mineurs d’une galerie eût la folie d’un instant de révolte, et l’une des mitrailleuses crachait immédiatement la mitraille, prenant en flanc des rangs entiers de condamnés, les couchant, blessés à mort, sur le sol détrempé ! ( CC p 658)
La lecture des récits journalistiques sur le bagne fige l’image du bagne russe dans l’imaginaire : Fandor en a lu des descriptions à partir desquelles il peut se figur[er] des images, partant il enrichit son savoir encyclopédique : il n’ignorait pas et connaissait. La mobilisation des savoirs du lecteur Fandor permet à l’actant Fandor de mesurer les dangers et les risques auxquels sa condamnation le confronte. Le récit journalistique est réinvesti dans l’œuvre : il atteste de la véracité de la fiction que le lecteur a sous les yeux.
L’intertextualité se développe aussi de manière interne aux séries. Quand Fandor cherche un moyen d’arrêter un train, il fait appel à sa mémoire, qui est aussi la mémoire du lecteur :
L’intrépide journaliste se souvenait à ce moment qu’une fois déjà il avait cherché comment arrêter un train rapide. Il était alors en compagnie de Bouzille et il poursuivait Fantômas. ( CC p 672)
Cette tentative se déroulait dans Le Bouquet tragique, l’épisode XXIII de la série des Fantômas. L’intertextualité s’inscrit donc dans les textes.
L’intertextualité interne s’explique par le fait que La Cravate de chanvre et Rouletabille chez le tsar sont parties intégrantes de séries fondées sur la réutilisations de composantes identiques: réapparition des mêmes protagonistes (Fantômas, Juve, Fandor, Hélène d'une part, Rouletabille d'autre part), fonctions déterminées attribuées à chacun d'eux (Fantômas est le Génie du crime, Juve est à sa poursuite aidé par Fandor, Hélène veut vivre son amour avec Fandor, ne le peut pas et doit constamment souffrir psychologiquement et physiquement, Rouletabille résout les énigmes les plus compliquées), constantes stylistiques – l’emploi de l’italique - , techniques spécifiques d'agencement des épisodes ( un épisode se termine dans le volume suivant qui s'ouvre sur la présentation d'un milieu, sans cesse différent pour Fantômas, un mystère non-élucidé est présenté à Rouletabille). Autant d'éléments institués comme marques génériques mais qui assurant la lisibilité des récits pris séparément, « jouent le rôle d'indices puisqu'ils signent leur appartenance à une série. »[45]
La série Rouletabille s'affirme et ne s'affine que progressivement, de sorte que la série est constituée d'un ensemble de traits distinctifs (certaines expressions propres au reporter « en prenant sa raison par le bon bout », le rapport à la mère – la dame en noir au parfum si prégnant,...) que le lecteur peut appréhender facilement. C'est une série en construction alors que Fantômas est une série finissante avec La Cravate de chanvre comme avant-dernier épisode.
Une intertextualité externe aux œuvres apparaît à la lecture. Nous ne reviendrons pas sur l’importance des auteurs russes[46]. Sans prétendre à l’exhaustivité[47], notons Jarry, Leroux, Verne à titre d’exemples.
– Sire, affirma Boris Porkoff, j’ai pu, grâce à la bienveillance de Votre Majesté, faire pendre cette semaine soixante-dix-huit nihilistes des plus dangereux. Quarante-deux autres se trouvent en ce moment sous les verrous, ils seront exécutés avant peu. Je crois Votre Majesté en parfaite sécurité. (CC, p 574)
L’énormité du nombre de pendus détruit le sérieux de l’affirmation. Le texte se situe quelque part du côté de la farce cruelle, farce soulignée par l’expression grâce à la bienveillance de Votre Majesté. Ici comment ne pas songer à Ubu en lisant le portrait que nous donnent les auteurs de La Cravate de chanvre de Nicolas II au cours du dialogue avec Boris Prokoff au sujet de l’étui d’or ? Nicolas II apparaît comme un personnage ridicule, marchant de long en large, évitant « de passer devant les fenêtres, […] de frôler les meubles, louvoyant pour ne point se risquer sous un lustre et courir le danger, pourtant fort hypothétique, d’un écrasement sous les cristaux énormes » (CC p 575) « qui suait, en vérité, de peur » (CC, p 574), faisant espionner tout le monde. A l’affirmation de son chef de la police qu’il peut être tranquille car aucune tentative d’attentat ne se prépare contre son impériale personne ou contre lui-même, Nicolas II objecte :
– Ah ! fit-il d’une voix sourde, je devine la vérité, Prokoff. Vous avez été absent deux jours, soi-disant, c’est un mensonge… Je suis certain…
– Votre Majesté me fait-elle espionner ? Sire, demanda Prokoff.
Mais à ces mots le tsar se relevait vivement.
– Non, non, je n’ai pas de contre-police, jurait-il. J’ai toute confiance en vous… ne croyez pas cela, Boris Prokoff !… Il ne faut pas croire cela… Je me fie à vous, et à vous seul ! ( CC p 575)
Pourtant dès que Nicolas II congédie Boris Prokoff, il fait appel à deux colosses (CC p 576) :
C’étaient deux serviteurs dévoués, deux brutes amenés du Caucase et dont nul ne savait à la cour les fonctions. Ils paraissaient et disparaissaient, quelquefois il semblait que le tsar éprouvait à leur égard un véritable sentiment de frayeur.
Les deux colosses à peine devant lui, le tsar ordonna :
– Boris Prokoff vient de sortir d’ici, suivez-le, épiez-le, je veux savoir où il va. Vite ! partez !
Les deux agents, déjà, s’éloignaient. Alors, Nicolas II parut plus inquiet encore.
– Mon Dieu ! murmurait-il, si j’étais seulement certain que ces deux imbéciles ne trahissent pas ! Je les emploie à espionner ma police, mais eux, par qui pourrais-je les faire espionner.
Et, pensif, Nicolas II se reprit à marcher de long en large, frémissant au moindre bruit… (CC, p 576)
Et ce jugement de Fantômas alias Prokoff :
Il pensait à son maître, et il jugeait le tsar.
« Un pauvre homme, un imbécile, un poltron […] ( CC p 576)
Le passage à la trappe d’un nombre incroyable de nihilistes, la crainte perpétuelle, la lâcheté, la poltronnerie, tout cela sent le personnage ubuesque. La pièce Ubu roi d’Alfred Jarry a été jouée en 1896 pour la première fois avec diverses reprises notamment en janvier février 1898 aux Pantins. Les journalistes Souvestre et Allain qui aimaient tant s’amuser ont pu apprécier cette œuvre.
Par ailleurs, certains éléments de La Cravate de chanvre semblent directement issus de Rouletabille chez le tsar. Notons une onomastique approchante pour certains personnages Marfa Berena (CC) ressemble étrangement Matrena (RCT), que Féodor Fédorovicth (un des agents de Prokoff) a comme prénom et nom les deux prénoms du le général Trébassof ou encore que Natacha est le nom de code utilisé par les nihilistes lors d’une réunion secrète (CC, p 750). L'appareil intertitulaire est, à une occasion, équivalent : les titres des chapitres mettant en scène le procès instruit par les nihilistes sont les mêmes dans Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre : Devant le tribunal révolutionnaire (CC, p 633, RCT, p 377). Le jugement sur l’impénétrabilité des Russes se retrouve lui aussi d’une œuvre à l’autre :
« Avec ces Russes, hommes ou femmes, se disait Fantômas, on ne peut jamais savoir exactement le fond de leur pensée ! » (CC, p 731)
En vérité on ne soupçonne jamais la tempête ou l’amour qui couve dans le cœur slave[…]. ( RCT, p 56)
Il semble bien que La Cravate de chanvre entre dans un système de citations de Rouletabille chez le tsar. On peut y voir un plagiat par anticipation pour reprendre l’expression de l’OULIPO.
Certaines expressions passent même d’un texte à l’autre dans l’immense corpus du roman populaire. Par exemple : « Ordre du tsar ! » prononcé par Juve pour justifier l’expulsion de Roger Darmont (CC, p 686) se trouve dans Rouletabille chez le tsar :
Rouletabille se livra à un chambard qui réveilla tout l'hôtel. Les voyageurs, craignant encore « un scandale », restèrent enfermés dans leur chambre. Mais M le directeur descendit, tremblant, aux nouvelles. Quand il sut « de quoi il retournait » , il voulut faire le malin, mais Rouletabille, qui avait vu jouer Michel Strogoff, lui lança un « service du tsar » qui le rendit immédiatement docile comme un mouton. (RCT, p 402-403)
Ainsi pouvons-nous suivre la réutilisation de l’expression « Ordre du tsar ! » du roman de Jules Verne (en situation d’hypotexte), à son adaptation théâtrale puis à un ouvrage du Capitaine Danrit Ordre du tsar[48] publié en 1905 ensuite à Rouletabille chez le tsar et enfin à La Cravate de chanvre. L’empreinte vernienne se retrouve aussi dans l’onomastique : le prénom de la domestique de Boris Prokoff - Marfa - est également le prénom de la mère du courrier du tsar dans Michel Strogoff et le vieux Riga a pour nom celui de la ville dont est originaire le père de Nadia, compagne de Michel.
Cette intertextualité foisonnante est-elle une marque de la paresse des auteurs ? Nous ne le croyons pas. Certes, reprendre divers éléments permet d’écrire vite, très vite même. Mais, selon nous, cela ne disqualifie pas les œuvres. La notion de plagiat n'est, en effet, opératoire que dans une esthétique de l'originalité. Les auteurs opèrent des sélections dans le réel et traitent les éléments sélectionnés comme des motifs. L’hiver russe, la Sibérie, l’autocratie, les nihilistes, l’âme slave forment un stock dans lequel ils puisent et sont susceptibles de multiples variations.
Le roman populaire, que certains critiques décrivent d'ailleurs comme un seul et infini texte, donne au lecteur ce qu'il veut lire. La mise en scène de lieux communs (c’est-à-dire simplement : disponibles, à la disposition de tous les écrivains ) [49] – communs dans l’imaginaire français – est nécessaire à la lisibilité d’œuvres produites pour le plus grand nombre et pas seulement résultat d’une désinvolture et d’une indispensable rapidité d’écriture . Les auteurs puisent donc dans un réservoir existant :
[…] si désinvolture et rapidité il y a, elles ne peuvent s’enraciner que dans des bases solides : un stock de motifs ou de personnages préétablis, une batterie de schèmes narratifs – motifs et schèmes que les romanciers populaires ont toute licence pour répéter, moduler et/ou combiner. [50]
2.3. Sur l’importance du jeu :
Soyez bon joueur, Fantômas (CC, p 600)
Pour les auteurs, il ne s’agit pas seulement de copie servile, de plagiat, d’utilisation abusive et paresseuse de lieux communs. Ce qui est en jeu est bien plus sérieux que cela. La réalité est une donnée du jeu. Elle en ordonne certains aspects. Mais au-dessus du principe de réalité se trouve le principe de plaisir. Il s’agit de distraire, et de se distraire pour les auteurs qui n’ont jamais caché cet aspect dans la construction de leur œuvre. Tous les moyens sont bons. Partant, la réalité ne peut alors que prendre du jeu : le décalage avec la réalité fait partie du jeu littéraire ; la réalité est donnée comme pleine de sens cachés et il n’est pas innocent, à notre sens, que la littérature policière joue sur l’illusion de la réalité. Plusieurs niveaux de lecture sont alors possibles : une lecture « primaire », qui s’attache essentiellement à la résolution de l’énigme dans Rouletabille chez le tsar et à la poursuite du terrible bandit dans La Cravate de chanvre, et une lecture « seconde » qui s’intéresse aux jeux de langage à l’œuvre dans les textes.
L’univers référentiel est saisi de vertige. Ce qui pourrait sembler n’être qu’erreurs, exagération, généralisation, stéréotypes, n’est en fait que le résultat de la création d’une Russie seconde avec laquelle on peut jouer à loisir. Dans cette perspective, la déréalisation n’est pas un échec du réalisme mais une nécessité du jeu. Le lud(d)isme[51] c’est aussi la casse de son outil de travail !
En s’abstrayant de la Russie réelle, les auteurs n’en gardent que ce qui semble le plus immédiatement russe à la majorité des lecteurs pour permettre une entrée facile dans le jeu auquel les œuvres participent et en même temps invitent. Roger Caillois[52] appelle le jeu reposant sur la mise en scène d’une illusion et d’un univers qui lui est propre la minicry. Dans la classification des jeux qu’il propose, Roger Caillois nous donne cette définition de la minicry :
Minicry : tout jeu suppose l’acceptation temporaire, sinon d’une illusion (encore que ce dernier mot ne signifie pas autre chose qu’entrée en jeu : in-lusio), du moins d’un univers clos, conventionnel, et, à certains égards, fictif.[53]
Tout d’abord, l’univers est doublement clos dans Rouletabille chez le tsar et dans La Cravate de chanvre : clôture matérielle dans les limites des pages du livre, univers clos par nécessité générique comme nous l’avons montré dans notre première partie[54]. Ensuite l’univers est conventionnel : convention de lecture sur lequel repose le pacte de lecture et respect des conventions de ce qui peut et doit montrer la russité au plus grand nombre possible de lecteurs. Enfin, univers, à certains égards fictifs, l’intrigue et les personnages sont fictifs, et la Russie est largement imaginée par les auteurs, reconstruite sur des bases documentaires plus ou moins solides. La récréation des lecteurs et des auteurs passe par la re-création ludique et enjouée de la Russie :
A l’exception d’une seule, la minicry présente toutes les caractéristiques du jeu : liberté, convention, suspension du réel, espace et temps délimités. Toutefois la soumission continue à des règles impératives et précises ne s’y laisse pas constater. On l’a vu : la dissimulation de la réalité, la simulation d’une réalité seconde en tiennent lieu. La minicry est invention incessante. La règle du jeu est unique : elle consiste pour l’acteur à fasciner le spectateur, en évitant qu’une faute conduise celui-ci à refuser l’illusion ; elle consiste pour le spectateur à se prêter à l’illusion sans récuser de prime abord le décor, le masque, l’artifice auquel on l’invite à ajouter foi, pour un temps donné, comme un réel plus réel que le réel.[55]
La littérature populaire s’ancre profondément dans le jeu et surtout le plus sérieux des jeux : le Carnaval. Rouletabille est sans cesse confronté aux masques dont se parent les différents protagonistes. Le sommet de la mascarade est atteint dans La Cravate de chanvre dans laquelle on assiste à un renversement complet, où l’envers devient l’endroit avec l’usurpation d’identité de Fantômas qui prend la place du chef de la police.
Jean-Claude Vareille avance que cette dimension carnavalesque est une des caractéristiques fondamentales du roman populaire :
En d’autres termes, et pour reprendre la terminologie de Bakhtine, le Carnaval, parce que ne supposant pas d’être au-delà de l’apparence, refusant le règne d’une Vérité et d’une Hiérarchie immuable, mettant en scène des formes et des énergies en continuelle mutation, serait essentiellement dialogique et plurivoque. Ce que serait aussi un certain roman populaire, et une de ses grandes provinces, le roman policier.[56]
3. Des éléments de littérarité dans les deux œuvres
S’il est un reproche fréquent fait à la littérature populaire c’est son manque de littérarité. Il semble bien qu’il existe un « contrat de lecture » spécifique entre le producteur de l’œuvre et son consommateur. Mais ce contrat paralittéraire n’est pas la seule marque de fabrique des romans de notre corpus. Le jeu est important, nous l’avons souligné à de multiples reprises. Il s’appuie sur un mode particulier d’écriture : arrivé au terme d’une évolution (le roman populaire existe depuis près d’un siècle et à force de ressassement, il se pose souvent comme parodique) et avant une rupture historique (après la Première guerre mondiale, plus rien n’est comme avant dans le domaine de la littérature populaire), les romans de notre corpus paraissent une sorte d’acmé jubilatoire. Tout un ensemble de techniques narratives et descriptives est réinvesti, tout un savoir populaire est mis en scène. Sur cette scène, le langage s’alimente de langage : indice d’une certaine littérarité ?
3.1. Le contrat de lecture
La littérature populaire a pour objet d'être lue par le peuple. Jean Claude Vareille, dans L’Homme masqué, le Justicier et le détective, propose une définition du roman populaire :
Nous entendons par romans « populaires » ceux qui se sont adressés ou ouverts à de nouvelles couches de lecteurs, les ouvrages , dès les années 1830, on appelait « romans de la portière » ou « pour femmes de chambre », étant entendu que toutes les formes de transition sont possibles.[57]
Le roman populaire se définit par rapport au lectorat supposé, c'est le projet auctorial et éditorial de vendre à un public donné qui engendre la classification dans le domaine « roman populaire ». Le contrat du côté de l’auteur et de l’éditeur suppose donc la plus grande lisibilité possible pour séduire le plus grand nombre de lecteurs. Les aventures de Rouletabille et de Fantômas se déroulant en Russie les auteurs vont donner allègrement de la Russie au lecteur : du bizarre, de l’exotique, du surprenant mais surtout du conventionnel, car, si les œuvres ne doivent pas dire une Russie identique, elles doivent en dire une semblable à ce qu’en connaît le lecteur. Le semblable crée la vraisemblance. :
Au début de ce siècle [le vingtième], le développement, parallèlement aux feuilletons de presse, des grandes collections populaires à 65 centimes suppose […] la plus large adhésion du public et une fidélité à toute épreuve. Or, pour que l’affaire soit rentable, pour que ces conditions soient réunies, il faut à l’acheteur une garantie de suivi de la nature et de la qualité du produit. Autrement dit le lecteur potentiel veut être sûr de trouver dans le livre ce qu’il y cherche (= ce qu’il a déjà trouvé).[58]
Le contrat de lecture de la paralittérature, de ce fait, repose sur la satisfaction de l'attente du lecteur-client :
« [...] Le lecteur, lorsqu'il commence le récit, a conclu, avec l'auteur, un accord tacite qui lui assure la conformité de l'ouvrage par rapport à la série qu'il a choisie: il doit être sûr de trouver ce qu'il va y chercher, il a acheté un roman en sachant ce qu'il attendait, en étant convaincu que ce roman tiendrait ses promesses. [...] Par un nouvel usage de la convenientia médiévale, la convenance, le livre promet une conformité presque totale avec l'attente du lecteur. »[59]
La mise en scène du personnage de Rouletabille annonce un récit d'énigme policière : dès l'incipit le jeune reporter est présenté au lecteur comme l'envoyé chargé de résoudre le mystère des attentats sur la personne du général Trébassof et d'en démasquer le(s) coupable(s). Ouvrir un ouvrage de la série Fantômas est la promesse de trouver des crimes sanglants, odieux et, finalement, grand-guignolesques : La Cravate de chanvre s'ouvre sur une scène dans laquelle le Maître de l'effroi tue le chef de la police tsariste et fait disparaître son corps dans un poêle, corps dont la combustion et ses états successifs nous sont contés en détail.
La surprise ne tient donc pas au ressort principal de la diégèse non plus à la structure de l'œuvre, Rouletabille enquête, doute et finit par triompher ; Fantômas commet ses forfaits, est poursuivi par Juve et Fandor et parvient à leur échapper, mais au traitement particulier des événements dans ces épisodes précis.
De plus, la multiplicité des péripéties des héros de Pierre Souvestre et Marcel Allain et l’introduction dans le cycle de Rouletabille de rebondissements qui doivent plus à l’action qu’à la réflexion (comme l'enlèvement du reporter par les nihilistes) entraînent un glissement, renforcé encore par l'exotisme du cadre spatial, vers le roman d'aventures. Le déplacement spatial de l'intrigue en Russie apporte aux récits la première caractéristique du roman d'aventures : l'exotisme. Les descriptions de la Russie correspondent à une certaine réalité géographique, l'ancrage spatio-temporel, même s'il peut parfois paraître léger voire tenant plus du fantasme que de la « vraie réalité », est réel. Cet exotisme participe de la tentative de séduction du lecteur.
Enfin du roman populaire du XIXe siècle, les œuvres de notre corpus conservent l'aspect familial (Rouletabille pense souvent à sa mère retrouvée, lui écrit même, Fandor et Hélène, jeunes mariés, sont séparés, Juve reste une sorte d'instance paternelle de substitution pour Fandor,...), le nombre important de péripéties, la mise ne scène de combats épiques, le « quasi-halètement narratif » pour certaines séquences, ce que Daniel Couégnas appelle « la fébrilité de la diégèse »[60], le débridement de l'imaginaire-roi.
Du fait de la teneur du contrat, le lecteur trouve ce qu'il est venu chercher, les livres sont en conformité avec l'attente lectorale. La Russie attendue par le lecteur doit être conventionnelle pour qu’elle soit satisfaisante : dans l’esthétique de la répétition, rien ne doit aller à l’encontre de la convention, de la doxa… Convention du décor, convention de la saison, convention de la géographie, convention de l’idéologie, convention née de l’empilement textuel des stéréotypes. La convention est un contrat passé entre le producteur du texte et son consommateur. Le producteur s’engage à combler le désir de russité du lecteur : l’hiver, la Sibérie, le tsar, la police tsariste, les nihilistes… Que tout soit à la mode russe. Autant d'indices qui classeraient voire parqueraient les éléments de notre corpus du côté de la paralittérature. Et pourtant…
3.2. Les phénomènes de distanciation
Les œuvres, classées dans le domaine du roman populaire, ont, au moment de leur publication, une cible commerciale particulière, qui d’ailleurs n’est pas très populaire :
[…] il se développe entre 1900 et 1914 un ensemble, encore très minoritaire, de romans quelques peu différents [de la production sentimentale destinée aux femmes du peuple]; ceux-là s’adressent plus particulièrement au public masculin, et notamment aux hommes et adolescents de la petite bourgeoisie urbaine. Ces romans paraissent en feuilletons dans des quotidiens ou des revues lus plus fréquemment dans ce groupe social (Le Journal, Le Matin, L’Auto, Le Vélo, par exemple). Ils sont aussi publiés en librairie par les éditeurs populaires, comme Fayard. […] Souvestre et Allain, créateurs de Fantômas, débutèrent dans L’Auto et Le Vélo ; la série qui fit leur fortune parut directement en volume chez Fayard ; quant à Gaston Leroux, spécialiste des affaires criminelles, il publia ses romans principalement dans Le Matin, Je sais tout et L’Illustration.[61]
Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre s’adressent donc à un public qui possède un capital culturel : nombre d’hommes ont fréquenté les bancs scolaires, la petite bourgeoisie urbaine est consommatrice de journaux et aspire à une ascension sociale possible grâce à l’acquisition d’une culture classique. Les éléments de son capital culturel peuvent rendre sensible le public au procès de distanciation inscrit dans les textes car la distanciation n’est pas seulement le fruit d’une posture particulière de lecture, elle est programmée par le texte :
[…] toutes les lectures au second degré sont possibles, le public intellectuel éprouvant d’autant plus de plaisir à pratiquer la distanciation à l’égard de ce texte populaire qu’il ignore que cette distanciation est déjà inscrite dans la pratique de l’auteur. Fantômas est poétique, comme Arsène Lupin est élégant, parce que leurs auteurs, s’adressant à un public quelque peu réticent à la lecture du feuilleton sentimental commun, reprennent la formule du roman populaire tout en éliminant les « scories » qui, justement, le caractérisent.[62]
Aussi la pratique de la mise à distance concerne tout particulièrement les stéréotypes du roman populaire : larmoyant, moralisme, psychologie stéréotypée.
Pendant ou après la production de leur œuvre populaire, les auteurs ont cherché à donner une justification de leur livre par le divertissement et le dilettantisme : ainsi Marcel Allain…
[Marcel Allain] prend significativement ses distances à l’égard d’une œuvre romanesque qui lui a permis de bâtir une fortune considérable, réinvestie partiellement en biens culturels. […] Petit-fils d’un professeur de lettres à l’université, l’ancien élève de Janson-de-Sailly justifie ainsi, en la présentant comme tournée vers le divertissement, une carrière tout entière fondée sur le journalisme de fait divers et le roman de série…[63]
… Tout comme Gaston Leroux…
[…] c’est Gaston Leroux qui sut le mieux réinterpréter sa carrière selon l’aristocratique modèle du divertissement aventureux.[64]
… Ces justifications par l’amusement semblent mettre en évidence des enjeux sociaux et/ou de sociabilité :
[…] ces grands bourgeois sont aussi les plus capables de limiter leur déclassement en intégrant leur production dans un parcours reconstitué sur le modèle du dilettantisme élégant et noble.[65]
Cette justification par le dilettantisme et le divertissement ne nous semble pas suffisante. La frustration de ne pas être reconnu dans les hautes sphères de la République des Lettres permet la création d’objets littéraires atypiques, y compris dans la description de la Russie.
Par de multiples procédés, les auteurs prennent du recul sur leur œuvre, les mettant à distance : ce peut être par l’humour, par la démesure et la parodie.
3.2.1. L’humour
Les distanciations dans les œuvres tiennent à l’humour des personnages (premier étage de la distanciation dans un roman « policier » qui semble viser à l’esprit de sérieux) et à l’humour des auteurs (second étage qui (d)énonce le caractère ludique de ces deux œuvres).
Les personnages font preuve d’un humour à toute épreuve même dans les instants les plus dramatiques. Attendant le jour de sa pendaison :
Jérôme Fandor, une fois résigné à son sort, retrouvait son beau calme.
– Il était dit, grommelait-il simplement, que je finirais d’une vilaine façon ! En Espagne, déjà, j’avais été condamné au garrot ; ici je suis destiné à la potence. C’est un peu moins bien, car en somme, avec le garrot, on est assis, tandis qu’avec la potence, on est debout. (CC, p 615)
Et dans ces œuvres l’humour n’est pas seulement la politesse du désespoir. Le général Trébassof n’hésite pas à conduire une leçon de politique en ironisant sur la constitution. Les personnages russes dans Rouletabille chez le tsar font preuve d’un esprit que certains précieux du XVIIe siècle n’auraient pas renié. Jérôme Fandor n’est jamais non plus avare d’un bon mot : pour exprimer son étonnement d’avoir reconnu sous l’identité de Boris Prokoff le Génie du mal, Fandor monologue :
‑ Ah ! nom de Dieu de nom de Dieu ! grognait Jérôme Fandor. Ça c’est plus fort que de marcher sur un éléphant sans s’en apercevoir… C’est plus ahurissant que de pêcher la lune dans un filet à crevettes… C’est moins vraisemblable que de trouver à Paris un sergent de ville qui ne soit pas complètement idiot !… Vrai, je n’en reviens pas !… (CC, p 584)
Les personnages restent pourtant des êtres de papiers même s’ils sont à certains égards des porte-parole des auteurs. Ces déclarations amusantes sont, et c’est le plus intéressant, relayées par l’instance narrative et les auteurs.
Ils s’attachent ainsi à dire le ridicule des personnages, par exemple dans ce court dialogue entre Nicolas II et la grande duchesse à propos de son âge :
- Bonjour, Iékatérina ! fit-il. Vous êtes particulièrement jolie ce soir, et je vous félicite de rester éternellement jeune.
- Votre Majesté, fit la duchesse, est vraiment trop indulgente, et je suis heureuse d’avoir su lui plaire. Toutefois, je n’ai pas encore beaucoup à souffrir l’outrage des ans, n’ayant pas encore atteint la trentaine. (CC p 690)
Le moins que l’on puisse dire c’est que le compliment du tsar tombe passablement à plat !
Les lieux ne sont pas épargnés par l’humour ; ainsi quand Rouletabille se rend dans « une petite rue : Aptiekarski-pereoulok » le lecteur apprend que « Cette ruelle des pharmaciens n’en possédait aucun […] » ( RCT, p 296)
Le sérieux de l’intrigue se trouve remis en cause :
Les édredons, tous les édredons de la famille royale ont disparu hier matin (1) [accompagné de cette note :] (1) historique ( RCT, p 367)
Si Gaston Leroux accompagne la mention de la disparition de « tous les édredons de la famille royale » d’une note « historique », quel crédit de sérieux accorder au reste à un récit qui lui aussi se dit historique y compris par les notes infra-paginales, quel crédit accorder aux autres notes historiques comme celle de l’attentat contre Witte, premier ministre de Russie ? Tout est mis sur le même plan l’anecdote comme l’histoire, la vraie. Les frontières deviennent floues. Les récits journalistiques véritablement publiés sous la signature de Gaston Leroux se trouvent intégrés dans le roman, Leroux se met en scène dans Rouletabille chez le tsar : tout concourt à saper le sérieux par l’utilisation de l’humour dont se reconnaît friand l’auteur.
3.2.2. La démesure
Les scènes tragiques qui émaillent les deux œuvres peuvent virer rapidement de l’humour au grand-guignol :
Rouletabille et Natacha ne firent que tremper leurs lèvres dans la vodka , mais Féodor et Matrena burent leur eau-de-vie à la russe, d' un seul coup, haut le coude, la vidant à fond et en envoyant carrément le contenu au fond de la gorge. Ils n'avaient point plutôt accompli ce geste que le général poussait un juron formidable et s'essayait à rejeter ce qu'il venait d'avaler de si bon cœur. De son côté, Matrena crachait aussi, regardant avec épouvante le général.
‑ Qu’est-ce qu'il y a ? Qu' est-ce qu'on a mis dans la vodka ? s'écria Féodor.
‑ Qu’est-ce qu’on a mis dans la vodka ? répétait Matrena Pétrovna d'une voix sourde et les yeux hors de la tête.
Les deux jeunes gens s'étaient précipités sur les deux malheureux. Le masque de Féodor prenait un air d’atroce souffrance.
‑ Nous sommes empoisonnés ! ... s'écria le général, entre deux hoquets... je brûle !
Prête à devenir folle, Natacha avait pris la tête de son père dans ses mains ; elle lui criait :
‑ Vomis, papa ! Vomis ! ...
‑ Il faut envoyer chercher un vomitif, clama Rouletabille, qui soutenait le général, lequel lui avait glissé dans les bras...
Matrena Pétrovna, dont on entendait les efforts rauques, se jeta au bas du kiosque, traversa le jardin en courant comme si elle avait le feu à ses jupes, bondit dans la véranda... pendant ce temps, le général parvenait à se soulager, grâce à Rouletabille qui lui avait enfoncé une cuiller dans la bouche.
Natacha ne savait plus que gémir : « mon Dieu ! ... mon Dieu ! ... mon Dieu !… » Féodor Féodorovitch se tenait les entrailles, en répétant : « je brûle, je brûle ! ... » la scène était effroyablement tragique et burlesque à la fois. Pour ajouter à ce burlesque, la montre du général se mit à sonner huit heures dans sa poche. (RCT, p 291-293)
Le sérieux de l’empoisonnement est remis en cause par sa narration : on se croirait dans une comédie de Molière où l’on crie, se poursuit, avec un comique de geste fortement présent et plus encore dans ce genre théâtral – le Grand Guignol – qui fleurissait à la Belle Epoque. Nous y voyons une distanciation de l’auteur face au texte. Le roman policier archaïque de la Belle Epoque sous ses allures sévères et rigoureuses n’est qu’une vaste farce et rien ne semble pouvoir échapper à l’entreprise de sape systématique de l’esprit de sérieux.
Le glorieux aîné Michel Strogoff n’est pas épargné par ce travail de remise en cause du sérieux. Ainsi la description de la Russie dans La Cravate de chanvre semble fortement inspirée par celle faite par Jules Verne au début de Michel Strogoff comme le montre la confrontation des deux extraits suivants :
|
Extrait de Michel Strogoff |
Extrait de La Cravate de chanvre |
|
En effet, ce vaste empire, qui compte douze millions de kilomètres carrés, ne peut avoir l’homogénéité des Etats de l’Europe occidentale. Entre les divers peuples qui le composent, il existe forcément plus que des nuances. Le territoire russe, en Europe, en Asie, en Amérique, s’étend du quinzième degré de longitude est au cent trente-troisième degré de longitude ouest, soit un développement de près de deux-cents degrés., et du trente-huitième parallèle sud au quatre-vingt-unième degré nord, soit quarante-trois degrés. On y compte plus de soixante-dix millions d’habitants. On y parle trente langues différentes. La race slave y domine sans doute, mais elle comprend, avec les Russes, des Polonais, des Lithuaniens, des Courlandais. Que l’on y ajoute les Finnois, les Estoniens, les Lapons, les Tchérémisses, les Tchouvaches, les Permiaks, les Allemands, les Grecs, les Tartares, les tribus caucasiennes, les hordes mongoles, kalmoukes, samoyèdes, kamtschadales, aléoutes, et l’on comprendra que l’unité d’un aussi vaste Etat ait été difficile à maintenir, et qu’elle n’ait pu être que l’œuvre du temps, aidée par la sagesse des gouvernements. (Michel Strogoff, LDP, p 51) |
La Russie, immense Etat, pourrait être comparé à quelque cuve gigantesque où bouillonneraient et écumeraient les ferments les plus divers. Il y a, en Russie, de véritables castes, et ces castes sont ennemies. La noblesse est haïe par le peuple. L'ouvrier des villes est haï par l'ouvrier des champs. Le Sibérien se révolte contre l'Ouralien, et les Mandchouriens eux-mêmes s'accordent mal avec les Polonais. Il y a mieux ou pis. Si les différents peuples rangés sous l'étiquette générale de Russes sont ainsi soulevés les uns contre les autres par des haines de races, si les différences de fortune ont créé de véritables castes rivales et ennemies, il ne faut pas davantage oublier qu'il y a, en Russie, de formidables partis politiques, et qu'en plus de ces partis politiques avoués, on compte des sociétés secrètes qui groupent, sous leur bannière, de formidables contingents. Par dessus ces éléments de discorde, enfin, plane le nihilisme. (CC p 571) |
Le vaste empire, qui compte douze millions de kilomètres carrés du roman vernien devient un immense empire : les auteurs de La Cravate de chanvre gomment toute référence « mesurée » (ici ni superficie, ni précision géographique). C’est la première dé-mesure. L’importance de son extension territoriale explique selon Jules Verne que l’empire des tsars ne puisse avoir l’homogénéité des Etats de l’Europe occidentale et qu’entre les divers peuples qui le composent, il existe forcément plus que des nuances. Il s’agit d’explications qui peuvent sembler raisonnablement admissibles, avec une volonté didactique manifeste. Au contraire dans La Cravate de chanvre les auteurs comparent la Russie à quelque cuve gigantesque où bouillonneraient et écumeraient les ferments les plus divers : nouvelles démesures ; démesure de la cuve gigantesque et de la multiplicité des ferments. La vérité de l’empire russe semble beaucoup plus insaisissable tant les facteurs sont nombreux. Si Verne insiste sur la diversité des peuples à travers le nombre de langues parlées et la citation de nombre des composantes ethniques, Souvestre et Allain soulignent les oppositions entre eux : les différents peuples rangés sous l'étiquette générale de Russes sont ainsi soulevés les uns contre les autres par des haines de races. Ils reprennent un des topoï de la littérature populaire marquée par une axiologie très forte : il y a, en Russie, de véritables castes, et ces castes sont ennemies. Quant à Michel Strogoff une explication didactique est encore donnée sur l’unité de la Russie : l’on comprendra que l’unité d’un aussi vaste Etat ait été difficile à maintenir, et qu’elle n’ait pu être que l’œuvre du temps, aidée par la sagesse des gouvernements ; certes l’unité est difficile mais l’œuvre du temps et la sagesse des gouvernements la rendent possible. Rien de tout cela dans La Cravate de chanvre : la démesure règne, la Russie est en plein bouillonnement, rongée par des sociétés secrètes (autre topos du roman populaire), et par des discordes qui semblent incurables. Tout dans la description de la Russie par Verne manifeste une volonté didactique (Michel Strogoff a été publié chez Hetzel dans la collection éducation) et se veut explicative, fournissant nombre de détails sur les peuples, les dimensions ou la localisation de la Russie. Dans La Cravate de chanvre, la description, qui semble reprendre le plan de celle de Verne, est placée sous le signe de la démesure : démesure de l’extension territoriale (qui se limite à immense), démesure des oppositions (de véritables haines), démesure de la décomposition qui ronge l’empire des tsars (formidables partis), démesure enfin de l’écriture qui se fait presque baroque usant de comparaisons audacieuses et d’hyperboles, et qui connaît bien peu l’art de la nuance.
3.2.3. La dimension parodique
Ainsi, si l’univers russe de Michel Strogoff est bel et bien présent dans les deux œuvres de notre corpus, il est surtout réutilisé, réécrit, pastiché et finalement parodié.
L’ostentation radicale de la russité devient ridicule : ce n’est plus l’image de la Russie mais la parodie de l’image de la Russie que les romans populaires véhiculent et en premier lieu celle transmise par Jules Verne, maintes fois imité, copié voire recopié par différents auteurs populaires. Leroux, Souvestre et Allain qui capitalisent l’ensemble de l’héritage du roman feuilleton et de la littérature populaire depuis 1830, ne sont pas en reste et font de forts clins d’œil à Michel Strogoff (dans le cas de Rouletabille chez le tsar) ou le pillent allègrement pour le réécrire (pour La Cravate de chanvre). Cette réécriture acquiert, aux yeux des lecteurs qui connaissent l’œuvre originale, une dimension hautement parodique :
|
Extraits de Michel Strogoff |
Extrait de La Cravate de chanvre |
|
[…] trois chevaux de poste étaient attelés au tarentass. […] Voici comment le postillon, l’iemschik, les avait attelés : l’un, le plus grand, était maintenu entre deux longs brancards qui portaient à leur extrémité antérieur un cerceau, appelé « douga », chargé de houppes et de sonnettes ; les deux autres étaient simplement attachés par des cordes aux marchepieds du tarentass. (Michel Strogoff, LDP, p 111)
[...] La façon dont l’iemschik maintenait l’allure de son attelage eût été certainement remarquée de tous autres voyageurs qui, n’étant ni Russes ni Sibériens, n’eussent pas été habitués à ces façons d’agir. En effet, le cheval de brancard, régulateur de la marche, un peu plus grand que ses congénères, gardait imperturbablement, et quelles que fussent les pentes de la route, un trot très allongé, mais d’une régularité parfaite. Les deux autres chevaux ne semblaient connaître d’autre allure que le galop et se démenaient avec mille fantaisies fort amusantes. L’iemschik, d’ailleurs, ne le frappait pas. Tout au plus les stimulait-il par les mousquetades éclatantes de son fouet. Mais que d’épithètes il leur prodiguait, lorsqu’ils se conduisaient en bêtes dociles et consciencieuses, sans compter les noms de saints dont il les affublait ! La ficelle qui lui servait de guides n’aurait eu aucune action sur des animaux à demi emportés, mais, « napravo », à droite, « na lévo », à gauche, - ces mots, prononcés d’une voix gutturale, faisaient meilleur effet que bride ou bridon. Et que d’aimables interpellations suivant la circonstance ! « Allez, mes colombes ! répétait l’iemschik. Allez, gentilles hirondelles ! Volez, mes petits pigeons ! Hardi, mon cousin de gauche ! Pousse, mon petit père de droite ! » (Michel Strogoff, LDP, p 113) |
[…] le cocher déjà excitait ses chevaux, trois robustes bêtes attelées côte à côte, et surplombées par les arceaux de la sonnette, qui font partie du pittoresque harnachement russe… - Allez, mes hirondelles ! Courez, mes oiseaux des steppes ! Vite, vite, mes gazelles légères ! C’est pour la Russie que l’on travaille, il faut se hâter pour la cause. Tout cela était curieux, et pourtant l’étrangère demeurait toujours impassible. Comme l’allure du traîneau, cependant, s’accélérait bientôt, comme le véhicule glissait à une vitesse vertigineuse sur la neige, les trois chevaux marchant à des allures bizarres, celui du milieu galopait alors que les deux autres trottaient continuellement, l’étrangère se prit à monologuer tout haut. (CC, p 557)
|
Dans l’extrait de La Cravate de chanvre, le texte de Michel Strogoff se trouve, en quelque sorte, condensé. Tous les mots russes disparaissent renforçant la lisibilité de l’œuvre. Ainsi le mot russe iemschik se transforme en le très français « cocher » dans le texte de Souvestre et Allain, le cerceau, appelé « douga », chargé de houppes et de sonnettes redevient un simple arceau à sonnette si typiquement russe, les allures différentes des chevaux clairement expliquées par Verne se transforment en une bizarrerie de plus : condensation de la russité de l’équipage et de son originalité (l’harnachement), condensation de l’allure des chevaux, condensation des interpellations de cocher. Plagiat ? Non pas. Déplacement, remodelage, réécriture ludique d’un classique de la littérature populaire lu par des millions de lecteurs, jeu intertextuel et surtout parodie jubilatoire de la part de Souvestre et Allain.
Cette citation indirecte semble découler du « mode ironique d’écriture »[66] pratiqué par nos auteurs. Pour Philippe Hamon, dans L’ironie littéraire, essai sur les formes d’écriture oblique :
On peut […] faire l’hypothèse que tout texte écrit ironique est la « mention » ou l’« écho » d’un texte antérieur, qu’en l’absence de présence effective et désambiguïsante d’un contexte réel présent au moment de l’énonciation ( un texte littéraire, rappelons encore, est un texte différé, un « carrefour d’absences »), le texte ironique devra passer par la référence explicite à un contexte de substitution. Le ou les textes cités ou mentionnés formeront ce contexte de substitution, l’acte de citer servant donc de signal d’alerte pour le lecteur. Le « corpus » (littéraire) remplacera le « corps » avec ses gestes, ses mimiques et ses intonations, du parleur absent. Ce corpus de substitution devra avoir pour caractéristiques d’être doté :
1) d’une grande stabilité, pour pouvoir assurer efficacement la communication avec plusieurs générations successives de lecteurs ;
2) d’une valeur reconnue par tous.
Seuls les « classiques » d’une part, les stéréotypes, les topoï et les clichés culturels d’autre part, remplissent ces deux conditions. Ils seront donc mis tout spécialement à contribution pour assurer une bonne signalisation de l’intention ironique, soit que les textes cités soient déjà des textes ironiques reconnus comme tels, soient qu’ils soient des textes sérieux qui seront là à titre de repoussoirs internes permettant aussi à l’écrivain de se situer par rapport à d’autres sources d’énonciation ( on ne se situe qu’en citant).[67]
Les scripteurs de notre corpus se situent très clairement comme dépositaires de tout l’héritage de la littérature populaire du XIXe siècle. Pour ce qui est de l’image de la Russie dans nos deux œuvres, ne sommes-nous pas dans une (ré)écriture ironique de tous les stéréotypes véhiculés par l’ensemble du corpus populaire (dont fait partie Jules Verne, au moins en terme de réception) ?
|
Extrait de Michel Strogoff |
Extrait de Rouletabille chez le tsar |
|
Alcide Jolivet et Harry Bount, journalistes partant pour Irkoutsk, sont victimes d’un accident de télègue qui s’est brisée en deux :
« Eh bien ! non ! décidément, c’est trop drôle ! ‑ Vous osez rire ! répondit d’un ton passablement aigre le citoyen du Royaume Uni. ‑ Certes oui, cher confrère, et de bon cœur, et c’est ce que j’ai de mieux à faire ! Je vous engage à en faire autant ! Parole d’honneur, c’est trop drôle, ça ne s’est jamais vu !…[…] Oui extraordinairement drôle ! Voilà qui n’arriverait certainement jamais en France ! ‑ Ni en Angleterre ! » répondit l’Anglais. (Michel Strogoff, LDP p 135)
|
[…] le petit char glisse sur la route déserte entre les bras noirs des sapins ! ... Rouletabille se soulève sur sa banquette, regarde : « mon dieu ! Mais c'est triste comme une cérémonie funèbre, ici ! » de petites isbas glacées, pas plus grandes que des tombeaux, jalonnent le chemin, et il n'y a de vivant dans le paysage que le bruit de cette course, que ces deux bêtes au poitrail fumant ! ... crac ! ... un brancard de cassé ! ... « quel pays ! » (à entendre Rouletabille on croirait qu'il n'y a qu'en Russie que les cochers cassent des brancards.) et ce fut un raccommodage difficile et sommaire, avec des cordes... et ce fut la marche lente et prudente après la course effrénée. En vain Rouletabille essayait de raisonner : « tu arriveras toujours bien pour le matin. Tu ne vas pas faire réveiller l'empereur en pleine nuit » ... son impatience ne connaissait plus la raison... « quel pays ! ... quel pays ! ... » après quelques petites aventures (ils versèrent une fois dans un ravin et ils eurent toutes les peines du monde à repêcher la malle) on arriva à Tsarskoïe-Selo à sept heures moins un quart. (RCT, p 404-405) |
Nos auteurs usent donc de ce mode de distanciation avec délectation. S’adressant fictivement à Gaston Leroux, Francis Lacassin déclarait :
Vous avez poussé les règles du jeu de ce genre décrié [le roman populaire] jusqu’au banco, et vous avez gagné. Cet humour latent que le roman populaire accumulait avec mauvaise conscience – outrances, emphases, redondances, naïvetés, effusions… -, vous l’avez extirpé des enfers du second degré pour le faire jaillir et régner en maître à la surface. Vous en avez joué avec allégresse jusqu’à vous livrer à des parodies du genre que vous illustrez jusqu’à vous pasticher vous-même.[68]
Enfin, l’autoglorification franco-française peut conduire à l’autodérision :
« Ce dont il s’agit dans [les romans policiers] n’est pas la reproduction fidèle de cette réalité que l’on appelle civilisation, mais bien plutôt, et dès le début, l’accentuation du caractère intellectualiste de cette réalité. Ils présentent au caractère civilisateur une glace déformante d’où le regarde fixement la caricature de sa propre monstruosité. »[69]
Tout un jeu d’allusions plus ou moins formalisées se trouve camouflé sous les textes. Les images du roman populaire – stéréotypées le plus souvent – sont réinvesties pour être distordues : les frontières du parodique, du plagiat et de l’ironie deviennent ténues. Indéniablement dans les textes de notre corpus les auteurs jouent sur les écarts entre le modèle du roman populaire et ce qu’ils produisent : le lecteur est-il face à des romans populaires ou à des parodies de romans populaires ?
Les textes de notre corpus puisent nombre d’éléments issus d’un intertexte très divers et de toutes natures : romans populaires, textes journalistiques, romans « classiques »… Un effet de distanciation permanent semble naître de ces emprunts multiformes et dans de multiples genres. Les auteurs revisitent des images déjà connues de la Russie jusqu’à la parodie. La représentation de la Russie est construite sur des images préexistantes et non sur le réel : ce qui induit des doutes sur la valeur de vérité que confèrent les auteurs aux images qu’ils (ré)utilisent. Ces images ne laissent pas de nous interroger sur la référence au réel. Les images de la Russie présentes dans les deux œuvres apparaissent comme des citations reprises, tronquées ou raillées par les auteurs. La description de la Russie dans les œuvres n’est-elle pas en fait la parodie de la description de la Russie telle qu’elle est donnée à lire aux lecteurs de la Belle Epoque ?
Notons que d’un côté Rouletabille chez le tsar s’appuie sur une documentation sérieuse réunie par Gaston Leroux mais tout est placé sous le signe du divertissement et manifestement une distance est prise vis-à-vis de l’aspect référentiel ce qui aboutit à un renoncement au sérieux par excès d’humour.
De l’autre, La Cravate de chanvre remet sérieusement en question l’équilibre réaliste et tend au burlesque (voir la figure de Nicolas II, sorte de bouffon) et au carnavalesque. Les figures dans le roman de Souvestre et Allain sont renversées : Fantômas devient le chef de la police, Juve est fait prisonnier,… Le lecteur se trouve donc face à une opération systématique de sape du sérieux.
L’ironie attaque ainsi les « grands classiques » du roman populaire.
Poussée à l’extrême, on pourrait peut-être aller jusqu’à dire que tout fait d’ironie tend au pastiche ou à la parodie : en effet, le plus efficace procédé pour disqualifier autrui consiste sans doute à le disqualifier dans son rapport au langage et à ses règles, en les dénudant dans leur aspect « mécanique » et répétitif, là où l’auteur croit justement avoir fait acte de style original. Car le pasticheur s’attaque non seulement au style, mais au principe même d’identité, à la relation même d’identification qui relie, dans la conscience commune, l’homme au style (le style c’est l’homme, l’homme c’est le style).[70]
L’ironie du texte contre ce texte lui-même existe : c’est l’aveu de l’ignorance de Matrena des exploits de Rouletabille :
- Madame, je vais vous dire. J'ai quelques bonnes affaires à mon actif sur lesquelles on lui a fait des rapports et puis, on lui permet de lire quelquefois les journaux, à votre empereur. Il avait entendu parler surtout (car on en a parlé dans le monde entier, madame) du mystère de la chambre jaune et du parfum de la dame en noir ...
Ici, Rouletabille regarda en-dessous la générale et conçut une grande mortification de ce que celle-ci exprimât, à ne s'y point tromper, sur sa bonne franche physionomie, l'ignorance absolue où elle était de ce mystère jaune et de ce parfum noir. (RCT, p 20)
C’est encore le commentaire de l’instance narrative sur le procédé utilisé par Fandor pour arrêter le transsibérien :
Quel était donc son projet ?
Quelle idée folle venait donc de s’emparer de son esprit ?
Jérôme Fandor était parfaitement raisonnable.
Il s’était tout simplement souvenu qu’en Amérique, des bandits avaient, certain jour, arrêté un train express en graissant les rails, précisément avec du savon noir. (CC, p 673)
Il est certain que toute personne raisonnable ne doute aucunement du caractère plausible de la méthode employée par Fandor !
Ainsi, tout dans les textes s’applique à en dire la fausseté en introduisant massivement l’humour en leur sein, en exagérant les effets et en recourant à la parodie voire à l’auto-parodie :
nous pensons en effet que la répétition et le ressassement inhérents à la production de masse sont susceptibles de pervertir l’esprit de sérieux, et d’introduire partout un coefficient ironique et parodique. Il est vrai qu’en ce domaine il est difficile de faire les parts respectives de la création et de l’effet de lecture.[71]
A force de caricaturer l’illusion référentielle et l’esprit vériste on finit par « parler faux », par parodier et peu importe qu’il s’agisse là d’un pur effet de lecture : les lecteurs connaissent nombre des romans populaires publiés à l’époque précédente, qui sont sans cesse réédités. La connivence se joue encore à ce niveau de lecture.
3.3. Dernières remarques sur la littérarité des œuvres :
Il ne s’agit pas au terme de cette étude de prouver la littérarité absolue des œuvres de notre corpus. D’une part, parce que le concept même de littérarité est extrêmement discuté et d’autre part parce que l’absolu ne semble décidément pas de mise dans les caractéristiques de ces œuvres. Tout indique la tension qui nourrit l’écriture (et certainement une partie de la lecture) de Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre : tension entre stéréotypes et originalité, tension idéologique, tension entre culture dominante des auteurs et culture dominée des consommateurs des textes, tension entre écriture et lecture. Nos œuvres tracent leur sillon entre deux pôles : la popularité et la littérarité.
3.3.1. Le régime constitutif de la littérature :
Le classement de ces textes se révèle difficile, comme dans un entre-deux, un intervalle (mais l’intervalle c’est aussi ce qui réunit deux rives). La littérature est souvent affaire de subjectivité et d’arbitraire. Il existe des instances de légitimation (l’Académie, l’école,…). Certains textes sont jugés littéraires comme par nature, d’autres accèdent à ce statut, d’autres encore le perdent[72]. Jugé comme relevant d’un régime bas, l’ensemble du roman populaire et policier se trouve exclu de La Littérature. Quelques indices de littérarité de nos œuvres donc pour répondre à cette exclusion.
Pour Gérard Genette :
Entrer dans la fiction, c’est sortir du champ ordinaire d’exercice du langage , marqué par les soucis de vérité ou de persuasion qui commandent les règles de la communication et la déontologie du discours[73].
La fictionnalité de nos œuvres n’est pas à démontrer, même les personnages ou les événements historiques sont fictionnalisés par les auteurs pour se mettre au service de l’intrigue. Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre ressortissent bien du domaine de la littérature :
Si une épopée, une tragédie, un sonnet ou un roman sont des œuvres littéraires, ce n’est pas en vertu d’une évaluation esthétique, fût-elle universelle, mais bien par un trait de nature, tel que la fictionnalité ou la forme poétique[74].
Si par littérarité il faut entendre « littérature légitime » (et légitimée), notons que le Dictionnaire encyclopédique de la littérature française propose un article sur Gaston Leroux (p 556-557) et un consacré à Fantômas (p 357-358)[75]. De même, le lecteur curieux trouvera un article Fantômas dans 100 personnages célèbres de la littérature[76]. Il semble donc bien que ces livres sortent progressivement de l’enfer littéraire auquel ils on été longtemps condamnés. Signalons enfin, dans la légitimation en cours, une double page dans un manuel de collège consacrée à Fantômas et la prescription régulière des deux premières aventures de Rouletabille (Le Mystère de la chambre jaune et Le Parfum de la dame en noir) dans les établissements scolaires du secondaire.
3.3.2. Les auteurs et la littérature :
Les auteurs Gaston Leroux, Pierre Souvestre et Marcel Allain possédaient un capital culturel important et ont tous fait des gammes littéraires avant de se tourner vers le roman populaire :
Pierre Souvestre, qui devait devenir l’un des deux-coauteurs du célèbre Fantômas, a commencé […] par des écrits ambitieux. Jeune avocat nourri de culture classique, il a publié d’abord des vers.[77]
Dans Les amours d’un prince dont une partie de l’intrigue est basée sur une escroquerie littéraire, certains vers cités comme écrits de la main de Fandor sont en fait de … Marcel Allain.
Gaston Leroux a commencé son travail dans les lettres par une pièce de théâtre, dont le succès fut plus que mitigé. Il a ensuite écrit des articles pour plusieurs revues littéraires, notamment Lutèce à laquelle collaboraient des auteurs comme Verlaine ou encore Laforgue.
Quand on consulte la bibliographie des auteurs, on peut trouver des contes (Pêle-Mêle, de Pierre Souvestre, publié sous le pseudonyme de Pierre de Breis, Imprimerie Danjard-Kop, 1894), des recueils de poèmes (En Badinant, Le Bras, 1895), des drames (Le Sol tremble ! par Pierre Souvestre et Marcel Allain, 1909),… Marcel Allain déclara beaucoup plus tard que l’écriture de Fantômas était un divertissement fort amusant à écrire.
3.3.3. Une littérature « moyenne » ?
Au terme de notre étude, quelques extraits de l’ouvrage de Dominique Rabaté, Le roman français depuis 1900 résonnent d’un écho particulier[78] :
La jeunesse des années 1880 ne croit plus au roman : Jules Renard comme le premier Barrès y voient une forme lourde, explicite, aux effets trop simples.(p 9)
Plusieurs critiques sont adressées au roman :
Les descriptions encombrent et étouffent le récit, tuant l’imagination.(p 9)
Le roman français semble ainsi incapable de surmonter sa « crise ». Dans trois de ses missions principales : faire voir le monde, éclairer les abîmes de l’âme, faire rêver d’aventures, il est surclassé par d’autres littérature européenne. (p 10)
Le roman doit donc se dépasser et changer de nature pour se générer comme genre :
L’expression même de « roman d’aventure » se trouve au centre des préoccupations tant de Marcel Schwob que de Jacques Rivière ,qui dirige avec Gide la Nouvelle Revue Française. Dans un article important de 1913 [l’année de la parution en volume des deux œuvres de notre corpus] qui porte précisément ce titre, Rivière appelle de ses vœux un roman nouveau, plus poétique et plus libre, capable de réinsuffler le goût du risque et de la découverte (p 10)
On voit en quoi la date de 1913 fait véritablement charnière dans l’histoire des lettres françaises : année de parution du début de A la recherche du temps perdu, du Grand Meaulnes, elle voit apparaître les premiers signes de ce renouvellement inespéré. (p 11)
Le traitement de l’espace selon une option réaliste semble devenu insatisfaisant, sclérosant :
Jacques Rivière prônait, dans un article de la NRF en 1913[79], un « roman d’aventure » : il appelait en fait à une libération de l’imaginaire, à l’exploration d’un espace plus ouvert au désir et au mystère. (p 24)
L’espace romanesque s’affranchit des contraintes réalistes du décor pour devenir lieu de l’enchantement et du mythe. (p 24)
A cette époque le statut du personnage romanesque, largement héritier du personnage balzacien, est remis en question, il ne s’agit plus d’entrée en concurrence avec l’état-civil :
Les personnages obéissent au même mouvement d’allègement, et ne requièrent plus nécessairement un état-civil complet. ( p 24)
Ce n’est pas seulement le personnage qui pose problème mais c’est l’ensemble de l’économie romanesque qui est victime de la « crise » :
La crise du roman naturaliste vient en partie de ce que le roman semble condamner ses personnages et son intrigue à un causalisme réducteur. Dans un récit, la succession des épisodes produit toujours un rapport de cause à effet de l’un à l’autre : ce qui vient après semble découler nécessairement de ce qui précède. Le roman du XIXe siècle a naturalisé ce rapport de contiguïté narrative, en multipliant les niveaux de dépendance psychologique (le caractère d’un personnage explique et dicte sa conduite), sociologique (l’appartenance à un groupe social prend le pas sur le type), réduisant avec Flaubert et Zola la part de hasard à la portion congrue. » (p 32)
Les œuvres de notre corpus, ce n’est pas innocent de le souligner, sont publiées en volume en 1913 comme le début de A la recherche du temps perdu de Marcel Proust ou Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier. Elles apportent également à leur manière des réponses à la crise du roman. Reprenons point par point les critiques adressées au roman du début du XXe siècle :
- certes les effets romanesques restent simples mais tout est placé sous le signe du soupçon : dans l’économie des œuvres tout le monde peut être soupçonné (c’est le ressort même du jeu policier), l’écriture elle-même se trouve sous l’emprise du soupçon : qui, quand, quoi ment au lecteur ?
Il s’agit toujours, qu’on le veuille ou non, d’une fiction, d’un texte qui ment perpétuellement, avec plus ou moins d’adresse, plus ou moins aussi de souci de faire croire qu’il dit vrai. Tout auteur est à l’égard de son public, lettré ou non, dans la position de l’Ulysse de Giono qui fait naître l’Odyssée de son seul verbe ? Les inventeurs de Fantômas, de Lupin ou de Rouletabille n’ont certainement pas moins d’imagination ni de richesse pour construire un réseau d’événements aventureux. Pourquoi donc seraient-ils tenus à l’écart de la « littérature française » ?[80]
- l’imagination est totalement libérée : la Russie n’est plus qu’une construction baroque fruit de l’imaginaire des auteurs. Le rêve règne en maître de tous et de tout. L’onirisme pousse vers la poésie et le plus sûr moyen d’accéder à l’écriture poétique est souvent de ne pas la rechercher. C’est en tout cas ce que les surréalistes ont décelé dans les romans populaires des Leroux, Leblanc et Souvestre-Allain :
La combinatoire narrative de ces romans est des plus complexes. C’est pourquoi ils charmeront parfois un public intellectuel, séduit par l’humour ou la poésie involontaires de ces stéréotypes et de ces invraisemblances se succédant à un rythme effréné. Les surréalistes, notamment, s’enthousiasmèrent pour cette littérature, où ils voyaient se manifester, sous l’effet d’une écriture quasi automatique, le langage de l’inconscient et la poésie « populaire ». Ainsi Desnos composa-t-il une Complainte de Fantômas sur une musique de Kurt Weil (première audition radiophonique, le 3 novembre 1933).[81]
- La Russie des œuvres de notre corpus acquiert une dimension mythique (comme Paris par ailleurs dans nombre de romans populaires) : ce n’est plus une géographie du réel mais du désir, les auteurs offrent au lecteur la satisfaction du désir de russité à travers les archétypes voulus comme russes par l’imaginaire collectif des récepteurs. L’espace de la Russie est mis au service du mystère : l’enquête dans Rouletabille chez le tsar, la poursuite dans La Cravate de chanvre créent leurs propres lieux mâtinés de russité. Si la Russie n’a pas forcément grand chose à voir avec la réalité c’est pour servir l’économie des œuvres.
- Les personnages sont souvent de purs actants. La psychologie est réduite à quelques traits dominants et pouvant expliquer les actes des personnages. En cela ils font preuve d’une certaine modernité :
le [roman policier archaïque], en réduisant la trop fameuse psychologie des profondeurs à des mouvements simples, à des motivations situés à fleur de personnage, se rapproche du nouveau roman ou plus exactement d’un certain behaviourisme.[82]
L’état civil est fortement remis en cause par nos auteurs : Juve n’est que Juve, jamais son prénom n’est révélé au cours des trente-deux épisodes de Fantômas. Le Maître de tous et de tout est l’Insaisissable, il n’a en fait aucune identité, il est « le Protée moderne ».
Le personnage est allégé non seulement dans sa psychologie ou son état-civil mais aussi dans ses caractéristiques : il est souvent réduit à quelques traits comme une vision iconique : l’assassin, le Russe, le tsar, le policier, la victime, le reporter,…
Evidemment la réponse proustienne est singulièrement différente de celle de Leroux ou de Souvestre-Allain (ces derniers n’ont d’ailleurs pas forcément conscience d’introduire des ruptures avec des schémas anciens, ni d’emprunter des voies dans lesquelles il seront suivis par les surréalistes ou le « nouveau roman »). Les œuvres conduisent au vacillement de la véracité à force de trop montrer la Russie telle que la France la connaît déjà. La déréalisation introduit une dimension onirique à la Russie qui nous est livrée par les œuvres nous sommes du côté de l’imaginaire, d’une Russie recréée à partir de différents textes du texte qui crée du texte n’est ce pas de la littérature ?
Quand on ne connaît, de la vie, que ce qui est raconté ou racontable, quand le roman se contente de copier le roman (ou le mélodrame), seule existe comme réalité une écriture qui continue de l’écriture et ainsi sans fin, c’est-à-dire un rêve éveillé dans lequel on baigne et dont aucun repère extra-textuel fiable, aucune réalité concrètement appréhendée ne permet de sortir. La fonction référentielle, prétendument exaltée, vacille. Une telle littérature supprime le réel comme autre.[83]
Car la littérature est du vacillement, le vacillement est une forme de modernité et le vacillement est aussi du baroque. Après l’épuisement des combinatoires du roman populaire au début du XXe siècle (ce pan du roman connaît aussi une crise), quelques auteurs comme Gustave Le Rouge, Maurice Leblanc, Gaston Leroux, Pierre Souvestre et Marcel Allain inventent quelque chose d’acrobatique. Le lecteur ébahi (ou carrément effondré devant tant de clichés et de redites peut-être) assiste à une ouverture du sens, une instrumentation de la multiplication, au sacre du jeu (aux sens mécanique et ludique). Dans ces œuvres, les auteurs montre les richesses de la langue. Et tout tremble : tremblement du sens : enchantement ou inquiétude face à l’idéologie et au fonctionnement des œuvres ? Face aussi à ces œuvres peut-être finalement parfaitement inclassables ? Le lecteur est-il face au flou ou à la frénésie de la langue ? L’excès d’émotions mis en scène dans les œuvres empêche d’être juste, brouille le regard. Car il faut bien en convenir : nous sommes du côté de l’irrégulier, du biscornu, de l’a-normal : du stéréotype poussé à ses extrêmes naît une autre dimension, de ce qui semble le plus banal de la Russie s’épanche un onirisme, un lyrisme, un enchantement.
Le jugement sur la valeur a souvent été injuste. Un exemple : Il neigeait ; la reprise de cette courte phrase déclarative au début de nombreux paragraphes dans La Cravate de chanvre est manifestement un clin d’œil non pas directement au poème de Victor Hugo « L’Expiation » mais au savoir scolaire des lecteurs.
C’est aussi une scansion dans le texte, un leitmotiv comme le lecteur en trouve souvent dans la saga fantômassienne.
En poésie il s’agit d’un refrain, d’une anaphore ; dans le domaine de la critique traditionnelle du roman populaire on en fait un manque d’imagination, une simple technique pour écrire vite et beaucoup, voire d’une paresse manifeste des auteurs.
Pourtant, et les surréalistes ne s’y étaient pas trompés, c’est avant tout un procédé d’amplification rythmique. Dans l’activité d’écriture ou de production du texte les auteurs ont utilisé l’oral, les Fantômas sont des textes dictés. Ils ont forcément dû être sensibles au rythme poétique du texte. Bien loin d’être signes de la paresse des auteurs, les reprises anaphoriques témoignent de la dimension poétique de la geste fantômassienne.
Pour notre part, nous soutenons que cette littérature dite « populaire » ( nous ne nous hasarderons pas à généraliser notre affirmation à l’ensemble de la littérature dite « paralittéraire ») entraîne le lecteur dans le domaine du trouble littéraire, vers la littérature. Les enjeux se révèlent bien plus complexes que pourrait le laisser croire une lecture naïve – est-elle d’ailleurs possible ? - . Elle s’affirme comme intertextuelle, ludique, distanciée, ironique, parodique férocement hostile à l’esprit de sérieux, exigeant du lecteur une participation active. Elle joue autant avec les références qu’avec le langage – et même la typographie dans le cas de Leroux. Son énonciation même est une dénonciation du langage et de ses illusions – des idées reçues et des stéréotypes, de la vraisemblance et des images.
Finalement, peut-être que ces œuvres ont souffert de leur « manque de sérieux » en privilégiant le plaisir sur la réalité, la rapidité d’écriture sur le travail, le fantasme et l’imaginaire sur le vérisme :
[Voici] ceux qui, comme Gaston Leroux ou Allain et Souvestre par exemple, annoncent un Roussel et le futur OU-LI-PO. Voici ceux qui abominent l’esprit de Sérieux, ceux qui prennent la Dérision et la Fête comme un moteur de leur production, ceux qui jouent et invitent à jouer. Ou ceux, très nombreux, qui, dans un registre différent, pensent que l’écriture a moins à faire avec la Vérité qu’avec l’Imaginaire et les Fantasmes.[84]
Nous ne sommes peut-être pas face à des monuments littéraires mais les traces de littérarité sont évidentes. Alors faut-il classer les œuvres de notre corpus dans un entre-deux, hors de l’enfer littéraire certainement, pas encore dans le sanctuaire des grandes œuvres mais sur la frontière, en position de médiation entre « grande littérature » et « littérature de gare » :
Car il convient, à mon sens, de briser une fois pour toutes le dialogue stérile culture populaire – culture d’élite : on l’a tenté dans le cadre de la rencontre sur le thème « Intermédiaires culturels », ces personnages qui naviguent entre les deux cultures, agents de communication entre deux mondes. Non point pour introduire une troisième strate – solution paresseuse et compromis artificiel -, mais pour réintroduire une lecture beaucoup plus dynamique, faite d’échanges réciproques.[85]
Dans notre introduction, nous citions les critères de littérarité avancés par G. Molinié[86]. Nous voudrions rapprocher de ces critères l’analyse de Jean-Claude Vareille sur le roman populaire français :
On dira donc que nous n’avons abouti qu’à donner une nouvelle définition de la littérarité. Soit. Mais elle est plus ou moins pure ; elle comporte des gradations. Nul ne conteste à Balzac la qualité de romancier ; mais ses romans désignent aussi une réalité épaisse, résistante, qui n’est pas romanesque. Ceux de beaucoup de feuilletonistes également, à des degrés divers évidemment, qui n’ignore pas le vérisme ou la tendance naturaliste. Mais, de par la répétition, la redondance et le ressassement, tout ce qui est raconté ayant déjà peu ou prou raconté, il arrive un point (chez Féval, Ponson du Terrail, Leblanc, Leroux, Allain et Souvestre) où seul existe le mythe créé et véhiculé par le texte, où seul donc existe le texte qui devient référent ultime et seul.[87]
Le lecteur apparaît comme la figure centrale du système de la littérature populaire. Les effets de lecture peuvent être nombreux. Dans ces textes ludiques et intertextuels, le mot de la fin (littéraire) doit, pour Marcel Allain, revenir au lecteur :
Je ne crois pas qu’il y ait la grande et la petite littérature, chaque littérature étant la grande pour chaque lecteur au moment où il est plongé dans son livre.[88]
Dans son analyse du modèle paralittéraire Daniel Couégnas affirme ce que ne peut être la paralittérature :
Tout texte s’éloigne du modèle paralittéraire dès lors qu’il présente un certains nombre de traits « repoussoirs », d’éléments d’incompatibilité :
- l’affirmation de sa nature langagière, de l’opacité et de l’arbitraire des mots qui le constituent ;
- l’aveu, voire la mise en scène, de sa nature fictionnelle ;
- le souci d’une certaine objectivité ou polyphonie idéologique, les marques du dialogisme.[89]
Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre ne sont-ils pas précisément ce qu’ils ne devraient pas être : entachés de littérature car autorisant à la fois un mode de lecture littéraire ou un mode de lecture paralittéraire ?
Retour au sommaire de cette maîtrise.
[1] Nous utilisons les termes stéréotype, cliché et poncif dans les acceptions suivantes : stéréotype : idée toute faite qui se révèle à la fois banale et simpliste ; cliché : expression ou image devenue banale pour avoir été trop souvent employée ; poncif : thème ou forme d’expression d’une grande banalité.
[2] Jean-Marc Moura, Lire l’exotisme, op. cit., p 182.
[3] Alain-Michel Boyer, « Le contrat de lecture », op. cit., p 96.
[4] Alain-Michel Boyer, La Paralittérature, Que sais-je ?, PUF, 1992, p 103-104.
[5] Uri Eisenzweig, Le Récit impossible, op. cit., p 200.
[6] Ibid.
[7] Ibid., p 195.
[8] Michel Nathan, Splendeurs et misères du roman populaire, op. cit., p 135.
[9] Hubert Juin, « Pour éveiller nos joies, un beau crime est bien fort » in Europe n° 590-591, op. cit.
[10] C’est nous qui soulignons.
[11] C’est nous qui soulignons.
[12] C’est nous qui soulignons.
[13] A ce stade de notre parcours dans les œuvres, nous serions tenté de noter : tout à coup de théâtre !
[14] C’est nous qui soulignons.
[15] Jean-Claude Vareille, L'Homme masqué, le justicier et le détective, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1989, p 151.
[16] Ibid. p 151.
[17] Ibid. p 150.
[18] Jean-Claude Vareille , Le Roman populaire français,… op. cit., p 177
[19] Roger Caillois, Les Jeux et les hommes, Folio essais, 1996, p 105.
[20] Francis Lacassin, « Introduction », Les Aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille, reporter, Bouquins, ed. Robert Laffont, Tome I, p 3.
[21] Anne-Marie Thiesse, op. cit., p 148.
[22] Les stéréotypes sur la Russie que développent les œuvres de notre corpus restent encore d’une grande stabilité dans l’imaginaire collectif de la France au début du XXIe siècle.
[23] Robert Frank, op. cit., p 20.
[24] Jean-Marc Moura, Lire l'Exotisme, op. cit., p 106.
[25] A.J. Greimas, Du sens II, Seuil, 1983, Le savoir et le croire, p 124.
[26] Albert Malet et Jules Isaac, Histoire de France et notions d'histoire générale de 1852 à 1920 , Librairie Hachette, Enseignement primaire supérieur, nouveaux programmes de 1920, p 182.
[27] Ibid., p 179.
[28] Ibid., p 179.
[29] F. Schrader et L. Gallouédec, Géographie de l’Europe, Classe de Quatrième, 3ème édition revue, Librairie Hachette et Cie, 1907.
[30] Ruth Amossy et Anne Herschberg-Pierrot, Stéréoytopes et clichés, langue, discours, société, Nathan université, p 36.
[31] Robert Frank, op. cit., p 20.
[32] Jean-Claude Vareille, L’Homme masqué, le Justicier et le Détective, op. cit., p 118 (c’est l’auteur qui souligne).
[33] Ibid, p 119 ( c’est l’auteur qui souligne).
[34] « La Douma » recueilli dans L’Agonie de la Russie Blanche, Le Serpent à plumes, 1998, p 309. (c’est l’auteur qui souligne)
[35] Tolstoï, Maître et serviteur, in La Mort d’Ivan Illitch, Le livre de poche classique, 1976, p 105.
[36] A-M Thiesse, op cit., p 36.
[37] Roger Caillois, Les Jeux et les hommes, op. cit., p 97.
[38] Gaston Leroux, L’Agonie de la Russie blanche, op. cit., p 219.
[39] Ibid., p 219-220.
[40] Ibid., p 219.
[41] Alfu, Gaston Leroux, Parcours d’une œuvre, op. cit., p 37.
[42] Isabelle Husson-Casta, op. cit., p 73.
[43] Uri Eisenzweig, Le Récit impossible, op. cit., p 194-195.
[44] « Anthologie en quelques pages », La Tour de Feu, op. cit., p 94.
[45] A-M. Boyer, La Paralittérature ,op. cit., p 98-99.
[46] Voir notre Partie III, 2.1.3
[47] « Laissons donc l’exhaustivité à ceux qui s’en contentent » T. Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Seuil, 1970, p 8.
[48] Capitaine Danrit, Ordre du tsar, Ed. Petit Journal, 1905. (Notamment cité dans l’exposition Michel Strogoff, L’imaginaire, Amiens, 2004.)
[49] Jean-Claude Vareille, Le Roman populaire français…,op. cit., p 207.
[50] Ibid., p 212.
[51] Au XIXe siècle des ouvriers ont brisé leur outil de travail, suivant le modèle de l’écossais Ludd.
[52] Roger Caillois, Les Jeux et les hommes, op. cit..
[53] Ibid. p 61.
[54] cf. supra Première partie, 1.2.2.2. L’enfermement des personnages
[55] Roger Caillois, Les Jeux et les hommes, op. cit., p 67.
[56] Jean-Claude Vareille, L’Homme masqué, op. cit., p 162.
[57] Ibid., p 8.
[58] Daniel Couégnas, Introduction à la paralittérature, op. cit., p 66-67.
[59] Alain-Michel Boyer, La Paralittérature, op. cit., p 110.
[60] Daniel Couégnas, Introduction à la Paralittérature, op. cit., p 141.
[61] A-M Thiesse, op. cit., p 158.
[62] Ibid., p 225.
[63] Ibid., p 226-227
[64] Ibid.
[65] Ibid.
[66] Expression utilisée dans Jacques Dubois, Le Roman policier ou la modernité, Le Texte à l'œuvre, Nathan, 1992, p 161.
[67] Philippe Hamon , L’Ironie littéraire, essai sur les formes de l’écriture oblique, Hachette supérieur, 1996, p 25.
[68] Francis Lacassin, « Gaston Leroux ou les mille et une nuits d’un exclu du Matin », A la recherche de l’empire caché, Julliard, 1991, p 64
[69] Serge Kracauer, Le Roman policier, Petite bibliothèque Payot, 2001.
[70] Philippe Hamon, L’Ironie littéraire…, op. cit., p 26.
[71] Jean-Claude. Vareille, L’Homme masqué…, op. cit., p 170
[72] Que dire du destin littéraire d’Eugène Sue, rival de Balzac à son époque, puis rangé sous l’étiquette de « romancier populaire » et depuis quelques années redécouvert comme auteur littéraire
[73] Genette, Fiction et diction, Seuil, collection poétique, 1991, p 19.
[74] Ibid., p 29.
[75] Laffont-Bompiani (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la littérature française, Editions R. Laffont, 1999
[76] Christian Romain, 100 personnages célèbres de la littérature, op. cit., p 131-136.
[77] Anne-Marie Thiesse, op. cit., p 223.
[78] Dominique Rabaté, Le roman français depuis 1900, QSJ ?, PUF, 1998.
[79] Trois articles en fait.
[80] Jean-Paul Colin, La Belle époque du roman policier français, op. cit., p 218.
[81] Anne-Marie Thiesse, op. cit., p 159-160.
[82] Jean-Paul Colin, La Belle époque du roman policier français, op. cit., p 220.
[83] Jean-Claude Vareille, Le Roman populaire français…, op. cit., p 179.
[84] Ibid., p 20.
[85] Michel Vovelle, Idéologies et mentalités, Gallimard, « Folio histoire », 1982, p 132.
[86] cf G. Molinié, Versants, n°18, 1990, p26-27: 1- "Le discours littéraire est son propre système sémiotique"; 2- "Il est son propre référent" ; 3- "Il est l'acte de désignation de l'idée de ce référent". cité par Anne-Laure Lartigue, op. cit., p 109.
[87] Jean-Claude Vareille, Le Roman populaire français, op. cit., p 179.
[88] Cité par Jean-Paul Colin in « Fantômas à la Sorbonne », La Tour de Feu, op. cit., p 103.
[89] Daniel Couégnas, Introduction à la paralittérature, op. cit., p 182.