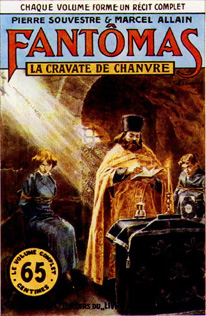
Philippe Ethuin
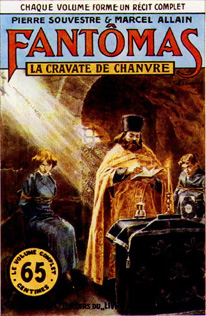
4. Problématique et méthodologie
Première Partie: La mise en place de l'univers russe.
Deuxième partie: L'idéologie dans les oeuvres.
Troisème partie: L'écriture de la Russie.
Retour au sommaire de cette maîtrise.
« Je ne crois pas à ce terme à la mode, « l'évasion ». Je crois à « l'invasion ». Je crois que, au lieu de s'évader par une œuvre, on est envahi par elle. Ce qui est beau, c'est d'être envahi, habité, inquiété, obsédé, dérangé par une œuvre. »
Jean Cocteau
« - Quel pays ! Quel pays ! Caramba ! ... fit l'artiste espagnole. »
Rouletabille chez le tsar, p 243.
S'aventurer sur les terres de la littérature populaire c'est entrer dans un domaine immense par la production mais tenu en marge par la culture officielle et les institutions littéraires. Quelques numéros de revues littéraires (Europe par exemple a consacré des numéros au roman-feuilleton et à des auteurs populaires[1]), certaines publications entièrement tournées vers ce domaine, Tapis-franc, Le Rocambole... , des thèses universitaires, des colloques savants, différents ouvrages constituent le maillage critique de la littérature populaire. Depuis plusieurs années, à coups de sondages dans l'immense production populaire, l'institution universitaire étudie de plus en plus les questions attachées à la littérature populaire, colloques et publications se multiplient, des centres d'études se mettent en place et constituent des équipes de recherches, C.I.E.R.E.C. à l'Université de Saint-Étienne, Centre de Recherches sur les Littératures Populaires de l'Université de Limoges, etc. La littérature populaire, depuis la décade fondatrice de Cerisy en 1967[2], est devenue, marginalement encore sans doute, un sujet d'études à part entière.
Notre travail porte sur un aspect particulier : l'image de la Russie dans Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre, deux œuvres appartenant à la littérature populaire à la Belle Epoque.
Le champ d'études tout d'abord sera limité à l'image de la Russie, sans s'interdire de franchir parfois ses frontières. Ce choix tient à deux raisons : la Russie est relativement importante dans le conscient et l'inconscient collectifs avant la première guerre mondiale, l'amitié franco-russe se manifeste de diverses façons: l'exportation de capitaux français à partir de 1888, l’alliance franco-russe (1891 : accord politique, 1892 : convention militaire) est ratifiée en 1893. Elle lie étroitement les deux pays. La France devient l’une des principales sources de capitaux importés (surtout par les emprunts d’Etat et des investissements industriels). En 1896, la pose de la première pierre du Pont Alexandre III à Paris symbolise l'alliance entre les deux pays. En 1907, la Triple Entente est conclue entre la France, la Russie et la Grande Bretagne. Tout ceci joue indéniablement sur l'imaginaire collectif qui voit périodiquement les faits et gestes du tsar et de sa famille rapportés dans les journaux français. De plus, la Russie a une importance littéraire évidente dans le domaine qui nous intéresse, Michel Strogoff, Rocambole et quelques autres ont traversé ces terres, introduisant encore plus fortement cette thématique dans les romans français.
La littérature populaire ensuite est certainement celle qui retranscrit le plus fidèlement l'évolution des mentalités, il ne s'agit pas ici seulement d'un postulat, en effet l'auteur populaire se doit d'être à l'écoute de son public, de ses aspirations, de ses rêves, de ses fantasmes. L'image de la Russie livrée par le roman populaire doit à celle que les Français se font de l'empire tsariste.
La délimitation historique choisie enfin est celle du passage du XIXe au XXe siècle dans le domaine des lettres, la Belle Epoque est une charnière composée des séquelles, des restes du XIXe siècle et qui porte en elle les germes du XXe siècle, de la construction de notre modernité. Le roman « littéraire » vit une crise au moment même où il triomphe. Ainsi Jules Renard « comme beaucoup de ses contemporains, exprime une lassitude ironique à l'égard des grandes machines romanesques à la Balzac. « Toutefois, écrit-il, je pense que ce genre de roman est mort, du moins pour les hommes d'un grand talent. C'est du trompe-l’œil » (Journal, p. 50).[3] » La crise du roman commencée vers 1890 ouvre de larges champs lectoriaux aux romanciers populaires vers lesquels se tourne une partie du public « littéraire » qui n'entend rien aux querelles de chapelles et qui s'éloigne du « roman de recherche ». La Belle Epoque est aussi la période pendant laquelle se vend le plus de romans populaires, une sorte d’âge d’or. Arthème Fayard, Taillandier, Pierre Lafitte ont tous des collections populaires. Atteignant des sommets de tirages, le roman populaire connaît là, dans le même temps, la fin d'une époque : après la guerre 1914-1918, plus rien ne sera comme avant.
Le pacte de lecture du roman populaire repose sur le divertissement du lecteur, son arrachement à sa vie quotidienne et l'évasion pour trouver un moment d'oubli. Si l'action du roman populaire de la Belle Epoque reste fortement concentrée en France, l'exotisme fait recette : pour s’en tenir à quelques exemples, le lecteur de la série des Fantômas l’a suivi au Natal en Afrique du Sud (La Fille de Fantômas), en Espagne (Le Mariage de Fantômas) ou au Mexique (La Série rouge) et Rouletabille voyage en Europe Centrale (Le Château noir, Rouletabille chez les Bohémiens). De plus les œuvres de Loti et de ses imitateurs connaissent de véritables succès d’édition. Vers 1910, apparaissent en outre les premiers westerns sous forme de fascicules qui ouvrent l’ailleurs vers le Mexique et le Far West. Enfin, la littérature coloniale produit nombre d’œuvres populaires à l’exotisme exacerbé[4]. L’exotisme des romans populaires permet d'extraire le lecteur de son quotidien et non de lui expliquer un monde qu'il connaît « mais de lui présenter des régions inconnues et lointaines. »[5] : il est divertissant car dépaysant.
L’exotisme russe n’est pas né dans la littérature populaire. Il existe depuis plusieurs siècles une tradition du voyage en Russie. En évoquant l’exotisme russe dans la littérature française, Moura note que :
La Russie, lointaine et mystérieuse, attire […] de nombreux écrivains-voyageurs. Depuis Diderot, qui visite les « Contrées barbares et glaciales du Nord » - Lettre à Sophie Volland, 3 octobre 1762 - , les auteurs, tels Théophile Gautier (Voyage en Russie, 1866), Balzac (parti retrouver Madame Hanska en 1843) – Lettre sur Kiew, 1847 – ou Dumas - Impressions de voyage en Russie, 1865-1866 – contribuent à élaborer une image de la Russie aux thèmes récurrents, pour ne pas dire stéréotypés : s’y mêlent préjugés pour ou contre le tsarisme, immensité stupéfiante des paysages, apparences médiévales du pays, et deux caractéristiques mentales dominantes, l’âme russe, mélancolique, et le mysticisme. Ces clichés passeront dans nombre de romans du temps, des Prisonniers du Caucase et Prasconie ou la jeune Sibérienne (1815) de Xavier de Maistre au Maître d’armes (1840-1841) d’Alexandre Dumas et au fameux Michel Strogoff (1876) de Jules Verne. Le pouvoir tsariste, la cruauté tartare, les hordes de loups et d’ours prises dans des tempêtes de neige font en effet de l’exotisme russe l’ingrédient de choix d’un romanesque exacerbé.[6]
Les auteurs populaires sont indéniablement héritiers de cette tradition, de par leur culture classique et leur immersion dans l’imaginaire lettré de leur temps. Tout le XIXe siècle est traversé de représentations de la Russie, les campagnes militaires menées par les différents gouvernements révolutionnaires puis par le Premier Empire ont ouverts à la découverte par des centaines de milliers de Français des pays européens. La campagne de Russie a eu un impact important, par le nombre de soldats engagés et par le caractère tragique de sa fin, sur l’imaginaire du début du XIXe siècle, puis tout au long du siècle a été servie par les plus grands auteurs ; comment ne pas penser à la première partie de L’Expiation de Victor Hugo ?
De plus, immense pays, terre de toutes les aventures et de tous les contrastes, porteuse d'espoirs de richesse, si européenne et si lointaine, la Russie tsariste a fasciné, comme beaucoup de Français, les auteurs populaires. Le texte littéraire reproduit et prolonge l'imaginaire collectif dont il est issu. Le roman populaire est un produit de son époque, révélateur des aspirations, des fantasmes et de l'univers conceptuel de son environnement lectoral. La Russie au centre d'une certaine actualité ne peut donc que susciter l'intérêt des romanciers populaires.
Pour autant, le roman populaire n'attend pas le début du XXe siècle, comme le rappelle Jean-Marc Moura, pour plonger ses lecteurs dans les vastes steppes caucasiennes, les intrigues à la cour du tsar et le froid sibérien. Les Aventures de Rocambole de Ponson du Terrail, publiées vers 1854, commencent en Russie pendant la débâcle de Grande Armée :
C'était en 1812. La Grande-Armée effectuait sa retraite, laissant derrière elle Moscou et le Kremlin en flammes, et la moitié de ses bataillons dans les flots glacés de la Bérésina[7]
Jules Verne fait longuement traverser à Michel Strogoff la Sibérie pour accomplir sa mission, présentant les obstacles successifs : les rigueurs climatiques, les manœuvres, les embûches et les pièges du traître Ogareff. L’image de la Russie dans l’imaginaire collectif doit beaucoup à ce roman vernien.
Gaston Leroux naît à Paris le 6 mai 1868. Il passe sa jeunesse en Normandie. Excellent élève, il obtient son baccalauréat de lettres à Caen en 1886. Il s'établit à Paris pour y faire son droit. Pendant ses années estudiantines il fréquente les milieux littéraires. Il végète pendant une dizaine d’années comme avocat stagiaire avant de se lancer dans le journalisme. Il entre au journal Le Matin pour lequel il tient différentes chroniques. En 1897, il écrit une pièce avec son frère Joseph – c’est le premier témoignage de son activité littéraire même s’il l’a souvent omis ou enjolivé. Le Turc au Mans est joué à la Gaité-Montparnasse[8]. Elle est publiée sous les noms de Gaston Larive et Joseph Leroux. C’est un échec malgré ce qu’en dit Leroux. Le 5 décembre 1897, Le Matin commence la publication de L’Homme de la nuit roman feuilleton d’aventure, le premier connu de Gaston Leroux sous la signature de Gaston-Georges Larive. Leroux devra attendre six ans pour qu’un nouveau feuilleton de sa production soit publié par Le Matin, en effet c’est seulement le 4 octobre 1903 que le feuilleton-concours Le Chercheur d’or signé Gaston Leroux paraît. Il sera repris, allégé des passages donnant des indices pour la découverte des trésors, en 1904 en volume sous le titre La Double vie de Théophraste Longuet. Le Mystère de la chambre jaune, première des aventures de Joseph Rouletabille paraît en 1907, ce roman de détection est devenu un classique des mystères de chambre close. Puis il publie Le Parfum de la dame en noir (1908), Rouletabille chez le tsar (1913), Le Château noir (1916),… A côté des romans policiers, Gaston Leroux écrit des romans populaires et d’aventures fantastiques (Un Homme dans la nuit, 1901, Le Roi mystère, 1902, Le Fantôme de l’Opéra, 1910, Le Fauteuil hanté, 1912, Balaoo, 1912). Il est aussi l’auteur de la saga de Chéri-Bibi. Gaston Leroux décède à 59 ans le 15 avril 1927 à Nice.
Moins connus sont les auteurs de Fantômas, Pierre Souvestre et Marcel Allain. Un bref point biographique s’impose car ils ont été écrasés par leur personnage Fantômas. Si le nom de Sir Arthur Conan Doyle est inséparable de Sherlock Holmes, Fantômas est bien plus vivant que ses deux auteurs dans la mémoire des lecteurs. Tout le monde connaît le génie du crime, bien peu ceux qui lui ont donné vie.
Né le premier juin 1874 (la même année qu’Arsène Lupin ! se plaisent à rappeler ses biographes[9]), dans le Finistère, à Plomelin au château de Keraval, Pierre Wilhelm Daniel Souvestre est le fils d'un préfet qui a donné sa démission pour s'installer à Paris. Pierre Souvestre fait ses études secondaires au lycée Janson-de-Sailly puis entre à la faculté de droit pour obtenir en 1894 sa licence. Même s'il se destine à la carrière d'avocat, au moins dans un premier temps, il n'est inscrit au barreau de Paris qu'entre 1894 et 1898 et en 1904-1905. Sa carrière mondaine est bien trop chargée pour lui permettre de plaider. Selon Marcel Allain son seul défaut était son goût immodéré pour les décorations. Il collabore à de nombreux journaux dans toutes sortes de rubriques, aussi bien sur l’automobile (c’est l’une de ses passions communes avec Marcel Allain) que sur les spectacles ou l’actualité. Dans le même temps il publie de nombreux ouvrages, là encore sur des thèmes assez éclectiques, tant de fiction que documentaires.
Marcel Allain naît à Paris le 15 septembre 1885 dans une famille bourgeoise. Son père possédait à la fois un diplôme d’avocat et un diplôme de Docteur en médecine. Son grand père quant à lui était agrégé de l’Université. Tout comme pour Pierre Souvestre, les études de Marcel Allain se déroulent au lycée Janson-de-Sailly. Il obtient aisément son baccalauréat lettres-philosophie en 1904. La force de travail qu’il développera plus tard ne semble pas s’exprimer totalement dans le cadre scolaire. « Son livret scolaire apprécie : « a d’extraordinaires facilités ce qui ne le conduit pas à une application continue » »[10]. Très tôt il commence à voyager – au besoin en fuguant. Il s’inscrit à la Faculté de droit de Paris et obtient en 1907 sa licence. Ses années estudiantines l’ont amenées à fréquenter les milieux littéraires et artistiques. Il rencontre notamment Henriette Sergy, grande collectionneuse de gravures du XVIIIe. Il rêve d’écrire mais ses parents sont loin d’en être d’accord. Pour gagner sa vie – aucune trace d’une inscription au barreau selon Francis Lacassin – il se fait vendeur d’automobiles – son autre grande passion.
Marcel Allain rencontre Pierre Souvestre et lui sert dans un premier temps de « nègre » - officiellement il est son secrétaire - Il entre comme chroniqueur sportif à L’Auto, le quotidien d’Henri Desgranges (créateur du Tour de France). Avec Pierre Souvestre, il écrit un roman-feuilleton, qui occupe un « rez-de-chaussée » publicitaire pour lequel « Michelin » a rompu le contrat suite à une malheureuse coquille[11]. C’est Le Rour, grand roman sportif. Leur imagination étant féconde, dans le même temps, ils publient Le Four, parodie du précédent, dans le journal Le Vélo, concurrent de L’Auto. Henri Desgranges trouve d’ailleurs les auteurs du Four bien meilleurs que ceux du Rour ! Devant le succès rencontré, Arthème Fayard commande un grand roman policier en plusieurs volumes : Fantômas commence sa carrière de Maître de l’Effroi. Trente-deux ouvrages sont écrits conjointement par Pierre Souvestre et Marcel Allain. Après la disparition de Pierre Souvestre, juste avant la Première Guerre Mondiale , Marcel Allain poursuit sa prolifique carrière produisant seul plus de quatre cents livres entre 1914 et 1963 dont douze nouvelles aventures de Fantômas.
Les auteurs, Gaston Leroux, Pierre Souvestre et Marcel Allain, ont en commun leurs études de droit, le métier de journaliste et une fréquentation assidue du milieu littéraire et mondain. Ils cherchent une reconnaissance sociale à travers la littérature - Maurice Leblanc se voulait lui aussi un continuateur, non sans un certain talent, des naturalistes et de Maupassant -, leur métier de journaliste étant surtout un pis-aller frustrant pour eux. En 1925, dans une interview pour Les Nouvelles Littéraires Leroux déclare :
Je ne voulais pas me borner à être journaliste, même célèbre, et je rêvais depuis l’enfance d’être un des premiers littérateurs de ce temps, d’appartenir à la grande élite.[12]
Leroux, Souvestre et Allain sont issus de milieux sociaux qui n’ont rien de populaires. Ils ont été formés comme une bonne part de l’élite de leur temps, ils possèdent un bagage culturel important et sont empreints de culture classique. Par leur formation et leur statut social, ils se situent bien loin de leur lectorat populaire.
Gaston Leroux connaît la Russie. Ses deux premiers recueils d'articles publiés, Sur mon chemin en 1901, puis Les Héros de Chemulpo en 1904, sont consacrés tout ou en partie à la Russie. Le premier est assez composite, témoignage de la diversité d'activités de Gaston Leroux, le second est constitué d'articles concernant la guerre russo-japonaise et notamment l'attaque de Port-Arthur. Enfin, il a été reporter en Russie pendant un an, en 1905-1906, en tant qu'envoyé à Saint-Pétersbourg pour le journal Le Matin. En 1928, sa veuve publie L'Agonie de la Russie Blanche, recueil des articles écrits de Saint-Pétersbourg entre le 15 mars 1905 et le 10 mars 1906 en pleine période d'agitation révolutionnaire.
En revanche les auteurs de Fantômas ne connaissent pas la Russie directement, ils n'y ont ni séjourné ni voyagé, leur Russie est purement « imaginaire ». De plus, le travail documentaire de Pierre Souvestre et Marcel Allain semble bien mince; les auteurs doivent produire un livre de 420 pages, soit quinze à dix-huit mille lignes, par mois ce qui laisse peu de temps pour effectuer ce travail. La base de documentation est très incomplète, partielle voire partiale et pour certains domaines quasi-inexistante. L'air du temps, quelques coupures de journaux, et peut-être même Rouletabille chez le tsar, ont suffi à la construction de l'arrière-plan russe de La Cravate de chanvre.
Si la Russie n'est lieu de l'action que dans ces épisodes de Rouletabille et Fantômas, des Russes ont déjà fait des apparitions au cours des aventures précédentes: citons notamment pour le cycle Rouletabille le prince Galitch dans Le Parfum de la dame en noir[13] et pour le cycle des Fantômas Sonia Danidoff ( Fantômas[14], Le Mort qui tue[15], Le Policier apache[16], L'Arrestation de Fantômas[17], Le Train perdu[18]), des nihilistes qui tiennent une réunion secrète dans une librairie parisienne (L'Agent secret[19]), le comte Saratov, le prince Nikita, à la suite de la perte du Skobeleff commandé par Ivan Ivanovitch (La Main coupée[20] et L'Arrestation de Fantômas) ou encore le générale Karkine et la nihiliste Natacha dans L'Hôtel du crime[21].
Fortement présents dans le premier tiers des aventures de Fantômas, les Russes disparaissent de l'épisode XII à XX puis XXII à XXIX. La Cravate de chanvre marque leur réapparition. Le volume suivant de Fantômas, intitulé La Fin de Fantômas, le dernier pour ce qui est de la collaboration entre Pierre Souvestre et Marcel Allain, reprend le personnage de Nicolas II, traité sous un tout autre jour, se promenant seul dans Paris, et voit Juve retrouver le collier de l’impératrice.
D'autres œuvres de Gaston Leroux se déroulent en Russie ou ont pour personnage des Russes, citons ainsi la nouvelle Baïouchki Baïou publiée en 1907 et qui se déroule à Moscou en pleine effervescence révolutionnaire, Les Ténébreuses (1924) dont l'intrigue se passe pendant la période prérévolutionnaire et qui narre les derniers moments du tsarisme ou encore Pouloulou, inédit jusqu'en 1990 mais dont la date de production est estimée par Francis Lacassin à 1914. L'expérience de la Russie acquise au cours de son séjour journalistique a donc été fortement réinvestie dans son œuvre romanesque par Gaston Leroux.
3.1.1. Rouletabille chez le tsar
Rouletabille chez le tsar est paru dans le supplément littéraire de L'Illustration du 3 août au 19 octobre 1912. Les éditions Pierre Lafitte reprennent le texte en 1913 sous forme de volume. Depuis plusieurs rééditions ont vu le jour: dans la collection du Livre de Poche sous le numéro 858 (1962, plusieurs rééditions) et enfin dans la collection Bouquins. Ecrit comme un roman feuilleton, il en possède bon nombre de caractéristiques, il est devenu livre à part entière grâce à son succès.
Dans ce troisième volet des aventures extraordinaires de Joseph Rouletabille, reporter, le journaliste est appelé au secours du général Trébassof, fidèle serviteur du tsar, menacé de mort par les nihilistes. Le chef de la police tsariste, Koupriane, soupçonne Natacha, la fille du général, d’être membre des nihilistes et d’avoir formé le projet de le tuer car il est responsable du massacre d’étudiants. Rouletabille est intégré au cercle familier des Trébassof. Il mène l’enquête en allant souvent à l’encontre des ordres de Koupriane. Plusieurs tentatives d’attentats contre la vie du général ont lieu : Rouletabille les déjoue toutes. Un guet-apens est organisé dans lequel tombe Michel, amoureux supposé de Natacha (surtout intéressé par sa fortune). L’innocence de Natacha est plus que jamais incertaine : n’est-elle pas complice de Michel ? Surtout qu’un nouvel attentat – une tentative d’empoisonnement - a lieu. Natacha est arrêtée et s’apprête à être exilé en Sibérie. Rouletabille, après avoir été enlevé par les nihilistes qui l’accusent d’avoir fait tuer l’un des leurs – mais Michel est traître autant au tsar qu’aux nihilistes – arrive finalement à prouver l’innocence de Natacha : l’empoisonnement a été mis en scène par Matrena, la femme du général, pour éliminer définitivement la menace que représentait Natacha en l’éloignant de la datcha. La fille du général a effectivement contracté un accord avec les nihilistes mais dans le but de sauver la vie de son père : la fortune dont elle doit hériter sera celle des nihilistes si le général meurt de sa belle mort. Rouletabille invite le tsar à accepter et taire cet accord, si l’empereur sait faire preuve de progrès et de pitié les nihilistes n’auront plus de raison d’être.
3.1.2. La Cravate de chanvre
La Cravate de chanvre est le trente-et-unième épisode de la série des Fantômas. L’ouvrage paraît le 20 août 1913 aux éditions Fayard dans la collection « Le Livre populaire ». Son cheminement éditorial est à l’image de celui de l’ensemble de la geste fantômassienne, marqué par les trahisons du texte (texte abrégé voire réécrit, titre modifié pour qu’y apparaisse le nom de Fantômas). En 1934, il est réédité sous le titre Le Domestique de Fantômas avec une couverture photographique copiant le dessin original de Gino Starace. Puis plus rien avant la réédition dans la collection Bouquins en 1989.
Il est toujours difficile de résumer une œuvre dans laquelle les rebondissements sont multiples, contradictoires et jubilatoires sans sombrer dans le ridicule. S’agissant d’une œuvre de divertissement, le sourire vient souvent aux lèvres du lecteur du résumé[22], résumé qui ne peut rendre compte de tout le plaisir et toute la saveur du texte, des rebondissements, usurpations d’identité multiples, situations cocasses,… Tentons-le néanmoins.
Fantômas a usurpé, après l’avoir assassiné, l’identité de Boris Prokoff, chef de la police secrète du tsar. Avec la latitude que lui laisse cette nouvelle fonction, il entend bien s’emparer du collier de l’impératrice. Hélène, fille de Fantômas et femme de Jérôme Fandor, est en Russie après avoir récupéré l’étui d’or contenant le poison destiné à tuer le tsar, elle cherche à déjouer le complot nihiliste. Toujours à la poursuite de Fantômas, le journaliste Fandor parvient à découvrir sa nouvelle identité et se fait engager à son service comme domestique, mal lui en a pris, il est reconnu et condamné à la pendaison. Les nihilistes voyant en lui un des leurs font échapper le journaliste puis comprenant qu’il ne partage pas leur idéologie le condamnent, au cours d’une parodie de procès à laquelle assiste Hélène sous l’identité d’Olga, nihiliste, à prendre la place d’un bagnard en Sibérie. Il parvient une fois de plus à échapper à une mort certaine (rien ne vaut le savon noir pour arrêter le transsibérien lancé à pleine vitesse !). Juve, appelé en Russie par à peu près tout le monde (le tsar, les nihilistes, la duchesse Iékatérina et Fandor) tente de déjouer les plans de Fantômas. Hélène est démasquée comme fausse nihiliste. Fandor et elle sont condamnés à la pendaison (par les nihilistes cette fois !). Juve qui a découvert la cachette des révolutionnaires fait tout pour retarder l’exécution. Il parvient bien sûr à les faire libérer. Rendant compte de ses activités au tsar, après avoir fait gracier ses amis condamnés cette fois-ci par Nicolas II, il s’aperçoit qu’une fois de plus Fantômas l’a berné (le collier que Juve rend à l’empereur est un faux) et lui a échappé. La poursuite continue…
3.2. Justification du corpus
3.2.1. Premières remarques sur la valeur littéraire des œuvres
Les deux œuvres choisies ne sont pas les plus lues, ni les plus célèbres, et peut-être pas non plus celles qui ont les plus grandes qualités « littéraires » dans la production des auteurs. Elles ne font pas non plus partie de la littérature légitimée par les institutions culturelles mais de la para-, infra-, sous- littérature selon le jugement que l'on porte sur elle, nous nous limiterons pour l'instant à l'appellation générique de « littérature populaire ». Dans la littérature de consommation, de masse, les notions de valeur littéraire ou les concepts de littérarité semblent peu appropriés :
En regard de ces critères de littérarité, Fantômas laisse perplexe. Certes, la perception des trois composantes définitoires de la littérarité[23] est graduelle, relative et libre, mais peut-on penser la valeur d'art d'un texte qui a pour vocation d'être lu vite, une seule fois et par le plus grand nombre de lecteurs possibles?[24]
Pour Gaston Leroux, Pierre Souvestre et Marcel Allain (et leurs éditeurs) le projet global est simple : répondre au désir du plus grand nombre. Lecture de masse, Marcel Allain dira, non sans humour, que le tirage des Fantômas a dépassé celui de la Bible, destinée à la consommation du plus grand nombre, ces œuvres arrivent à un moment historique qui a son imaginaire collectif et qui a besoin de repères et d'appuis. Rouletabille chez le tsar et La Cravate de chanvre participent de et à cet horizon conceptuel qui connaît ses limites et ses fantasmes. L'image de la Russie dans les œuvres de notre corpus est aussi à l'image que s'en fait la société française des années 1912-1913.
3.2.2. Entre homogénéité et hétérogénéité
Les deux œuvres du corpus ont une forte proximité chronologique, la première, Rouletabille chez le tsar, est publiée en feuilleton en 1912, la seconde, La Cravate de chanvre, en 1913, se situant dans une étroite synchronie, dix mois séparant leur publication respective. Ces deux œuvres sont le fruit d'une époque, clairement délimitée, la « Belle Epoque ». Homogènes au plan historique, les œuvres de notre corpus ont une parenté générique revendiquée, toutes deux intégrées dans le genre policier et reçues comme telles. Enfin les deux œuvres font chacune partie d'un cycle : celui de Rouletabille, dont c'est ici le troisième épisode ; et de Fantômas, ici le trente et unième épisode. A cette triple homogénéité répond une triple hétérogénéité. Dans le mode de publication tout d'abord: Gaston Leroux a écrit selon le format du feuilleton alors que Pierre Souvestre et Marcel Allain répondent aux exigences de la série. Dans la vitesse de production ensuite, les auteurs de Fantômas sont tenus de livrer un volume par mois, selon les termes du contrat passé avec l'éditeur, à Arthème Fayard, la résultante étant une écriture quasi-automatique, qui a enthousiasmé les surréalistes, d'autant plus que Pierre Souvestre et Marcel Allain ont deux autres séries, patriotiques celles ci, à écrire selon les mêmes format et procédé: Naz-en-l'air à partir d'octobre 1912 et Titi-le-Moblot à partir de novembre 1913, alors que Gaston Leroux n'a pas publié de Rouletabille depuis Le Parfum de la dame en noir en 1909, soit quatre ans auparavant. Son retour, à travers le texte fictionnel, sur la Russie sept ans après y avoir séjourné est indice du temps laissé au mûrissement de l'œuvre. Dans le traitement de l'intrigue criminelle enfin, les tentatives de déjouer le complot dont est victime le général Trébassof et l'enquête pour en démasquer l'instigateur est au centre de la narration pour Rouletabille, La Cravate de chanvre fait preuve d'une certaine dispersion thématique avec des crimes, des séparations douloureuses, des situations de mise en péril puis de sauvetage des personnages principaux,... ce qui crée un réseau de narrations imbriquées utilisant tous les éléments du roman populaire ( mystère, drame familial, pathos des situations,…) : à la clarté leroussienne répond l'entremêlement fantômassien.
4. Problématique et méthodologie
Les auteurs en choisissant comme décor la Russie transmettent des informations aux lecteurs (fonction référentielle), ces informations ne sont pas « objectives », il y a derrière l’image de la Russie un discours sur l’empire tsariste. Dans une première partie, nous envisagerons l’ancrage référentiel : quelles sont les informations livrées à la lecture sur les lieux, les personnages, le quotidien russes, bref sur ce qui fait l’exotisme russe de ces œuvres. Ensuite nous tenterons de démonter les mécanismes idéologiques que sous-tendent les éléments de notre corpus. Enfin nous chercherons à déterminer comment cette Russie des romans est construite, écrite par les auteurs.
Nous nous proposons de travailler sur les représentations romanesques populaires de l'Autre et de l'Ailleurs russes autour de quelques grandes problématiques : quelles sont les images sensibles et symboliques qui ambitionnent la restitution de la vérité russe ? Quelles représentations le roman construit-il de cette « étrangeté »/« altérité ». Au seuil de cette étude il nous faut définir ce qu'est l'altérité : elle « ne se résume nullement [...] à l'étrangeté d'autrui. Elle s'atteste dans toutes les expériences de passivité qui affectent une identité[25] ».
Il ne s’agit pas, dans cette étude, de valider ou d’invalider une représentation, ni d’en vérifier l’authenticité mais d’en comprendre et en dévoiler les mécanismes.
L'étude de l'image de la Russie relève « de ce que la critique littéraire comparatiste nomme l'imagologie littéraire. Jargon ? Cette étude des image de l'étranger dans une œuvre ou une littérature n'a pourtant pas d'autre nom - si ce n'est, parfois, le non moins laid « imagerie culturelle »[26]. » Nous nous situerons quelque part dans ce domaine de la critique littéraire. Nous tenterons d'éviter l'écueil d'une évaluation esthétique prématurée car nous sommes clairement dans le domaine souvent nommé « paralittéraire ». Nous ne chercherons donc pas l'irréductible singularité de chacune des œuvres de notre corpus – qui se placent dans une esthétique du semblable plus que dans une esthétique de l’originalité - mais nous nous intéresserons à l'étude « des phénomènes fondamentaux engageant les notions d'identité et d'altérité, d'images de soi et de l'autre, à cette zone profonde des lettres, en somme, qu'est le réseau des symboles par lesquels les imaginaires culturels se conçoivent, se rejoignent, se distinguent.[27] ». Pour cela, il nous faudra à plusieurs reprises replacer les œuvres dans leur contexte social, culturel, politique, historique, en un mot dans leur contemporanéité car toute « recréation de l'étranger en littérature est d'abord la réinterprétation singulière des grands symboles que la société a forgés sur celui-ci. C'est par la rencontre d'une expérience - appréhension, au double sens de saisir et de craindre, et attention -, d'une sensibilité créatrice - où jouent souvenir et imagination -, et des figures que l'imaginaire social a par avance dessinées de l'étranger, que se crée non pas bien sûr la "réalité" de l'étranger, mais une image où les grands schèmes collectifs sont perturbés par une compétence narrative inédite.[28] »
Première Partie: La mise en place de l'univers russe.
Deuxième partie: L'idéologie dans les oeuvres.
Troisème partie: L'écriture de la Russie.
Retour au sommaire de cette maîtrise.
[1] Numéro 590-591 sur Fantômas, numéro 626-627 sur Gaston Leroux.
[2] Dont les actes ont été publiés: Arnaud Noël, Tortel Jean et Francis Lacassin Francis (dir.). Entretiens sur la paralittérature, Plon, 1970.
[3] Michel Raimond, Le roman, Armand Colin, collection Cursus, 1996, p 23.
[4] Voir sur ce sujet : Alain Ruscio, Littérature, chansons et colonies in Pascal Blancard et Sandrine Lemaire (dir.), Culture coloniale. La France conquise par son Empire, 1871-1931, Autrement, 2002.
[5] Michel Raimond, Le Roman, op. cit., p 33.
[6] Jean-Marc Moura, Lire l’exotisme, Dunod, 1992, p 71.
[7] Ponson du Terrail, Rocambole, ed. Librairie Arthème Fayard, collection Le livre populaire, 1948, p 7
[8] Alfu, « Le faux départ littéraire de Gaston Leroux », Tapis Franc n° p 199 ?
[9] Par exemple Jean-Paul Colin in Dictionnaire de la littérature française, Larousse-Bordas, 1996, p 28.
[10] Cité in Fantômas? C'est Marcel Allain, La Tour de feu, n°87-88, décembre 1965, p 126.
[11] Les pneus Michelin ont été nommés les pneus Machin.
[12] Cité par Alfu in « Le faux départ littéraire de Gaston Leroux », op. cit..
[13] Gaston Leroux, Le Parfum de la dame en noir, 1908.
[14] Pierre Souvestre et Marcel Allain, Fantômas, I, Arthème Fayard, 1911.
[15] Pierre Souvestre et Marcel Allain, Le Mort qui tue, III, Arthème Fayard, 1911.
[16] Pierre Souvestre et Marcel Allain, Le Policier apache, VI, Arthème Fayard, 1911.
[17] Pierre Souvestre et Marcel Allain, L'Arrestation de Fantômas, XI, Arthème Fayard, 1911.
[18] Pierre Souvestre et Marcel Allain, Le Train perdu, XXI, Arthème Fayard, 1912.
[19] Pierre Souvestre et Marcel Allain, L'Agent secret, IV, Arthème Fayard, 1911.
[20] Pierre Souvestre et Marcel Allain, La Main coupée, X, Arthème Fayard, 1911.
[21] Pierre Souvestre et Marcel Allain, L'Hôtel du crime, XXX, Arthème Fayard, 1913.
[22] A ce propos, notons qu’il existait dans les publications en livraison des œuvres populaires des résumés des épisodes précédents totalement délirants, parfois hilarants et surréalistes, nous pensons notamment à ceux produits par, semble-t-il, une secrétaire de Léon Sazie pour la série des Zigomar, voir Philippe Mellot, Les Maîtres du mystère, de Nick Carter à Sherlock Holmes, 1907-1914, éditions Michèle Trinckvel, 1997, p 91.
[23] cf G. Molinié, Versants, n°18, 1990, p26-27: 1- "Le discours littéraire est son propre système sémiotique"; 2- "Il est son propre référent" ; 3- "Il est l'acte de désignation de l'idée de ce référent". cité par Anne-Laure Lartigue, De la littérarité chez Fantômas in Nouvelle Revue des études fantômassiennes, n°1, Editions Joëlle Losfeld, 1993, p 109.
[24] Ibid.
[25] Jean-Marc Moura, L'image du tiers monde dans le roman français contemporain, PUF, Ecriture, 1992, p 8.
[26] Ibid., p 10.
[27] Ibid.
[28] Ibid, p 11.