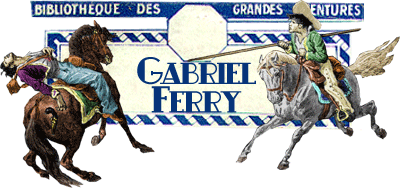
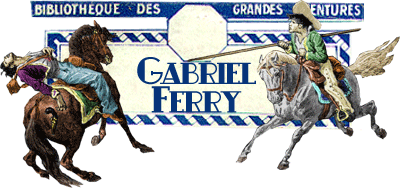
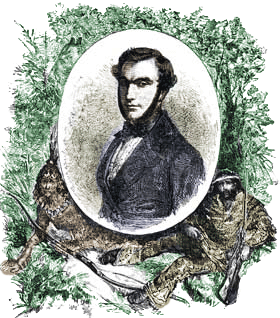
1809-1852
Où trouver les oeuvres de l'auteur?
George Sand sur Gabriel Ferry.
S'il est avec Gustave Aimard l'autre grande référence du récit de l'Ouest à la française, Gabriel Ferry (de son vrai nom Louis de Bellemare) a vu son nom s'effacer peu à peu des mémoires, comme ont disparu la plupart des autres écrivains français de l'Ouest, Lucien Biart, Paul Duplessis ou le plus tardif Albert Bonneau. Il a pourtant longtemps joui d'une réputation d'écrivain plus prestigieuse qu'Aimard. Loin des facilités de ce dernier (qui paraît s'être énormément inspiré de lui), Gabriel Ferry s'efforce de peindre les paysages exotiques lointains, à une époque où l'Amérique inspire encore les récits de voyages. C'est d'ailleurs comme écrivain-voyageur, narrant dans de brèves nouvelles ses souvenirs, qu'il débute dans le monde des lettres.
Né à Grenoble en 1809, Gabriel Ferry se rend en effet au Mexique en 1830 pour affaires commerciales. Il reste pendant 10 ans dans ce pays, avant de retourner en France en 1840. Ce voyage le marque profondément, et va lui servir de source pour la plupart de ses écrits. Gabriel Ferry s'est en effet rendu dans ce pays à une époque privilégiée, celle qui suit de peu la guerre d'Indépendance mexicaine, et qui est marquée par une série de luttes pour le pouvoir, et par les fameux affrontements entre le Mexique et les Etats-Unis. C'est une période de trouble et de révolutions susceptible de nourrir les rêveries romanesques. N'oublions pas que les différents conflits mexicains vont nourrir l'imaginaire de bien des auteurs de récits de l'Ouest: ceux du Capitaine Mayne Reid, ceux de Gustave Aimard, ceux encore de Carson McCulley, dans le cycle des aventures de Zorro.
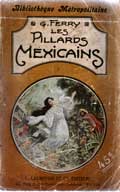 Mais contrairement aux autres écrivains que nous avons cités, Ferry a d'abord
cherché à proposer des scènes de la sauvagerie, récits exotiques (plus ou
moins) authentiques, comme c'était la mode à
l'époque. Il a publié ces portraits et scènes dans la prestigieuse
Revue des deux mondes (par exemple "Perrico el Zagarate" en 1847 ou "Une
Campagne de chasse dans la Californie et l'océan pacifique" en 1849). S'appuyant
sur ses connaissances du pays, et extrapolant à partir d'anecdotes qu'il a
entendu conter, il privilégie le cadre du Nord du Mexique et du
Sonora, comme le fera quelques décennies plus tard
Gustave Aimard, développant une véritable
mythologie du Sud des Etats-Unis, qui restera longtemps en France le modèle
privilégié de représentation de l'Ouest, et nourrira les rêves de conquêtes
français sous Napoléon III et durant les tentatives aventureuses de
Raousset-Boulbon. Dans la littérature française, l'Amérique va être pendant plus
d'un demi-siècle celle inventée par Ferry, avant d'être balayée par l'imaginaire
plus puissant du cinéma, ce dont témoignera plus que tout autre l'auteur de la
série des Catamount, Albert Bonneau.
Mais contrairement aux autres écrivains que nous avons cités, Ferry a d'abord
cherché à proposer des scènes de la sauvagerie, récits exotiques (plus ou
moins) authentiques, comme c'était la mode à
l'époque. Il a publié ces portraits et scènes dans la prestigieuse
Revue des deux mondes (par exemple "Perrico el Zagarate" en 1847 ou "Une
Campagne de chasse dans la Californie et l'océan pacifique" en 1849). S'appuyant
sur ses connaissances du pays, et extrapolant à partir d'anecdotes qu'il a
entendu conter, il privilégie le cadre du Nord du Mexique et du
Sonora, comme le fera quelques décennies plus tard
Gustave Aimard, développant une véritable
mythologie du Sud des Etats-Unis, qui restera longtemps en France le modèle
privilégié de représentation de l'Ouest, et nourrira les rêves de conquêtes
français sous Napoléon III et durant les tentatives aventureuses de
Raousset-Boulbon. Dans la littérature française, l'Amérique va être pendant plus
d'un demi-siècle celle inventée par Ferry, avant d'être balayée par l'imaginaire
plus puissant du cinéma, ce dont témoignera plus que tout autre l'auteur de la
série des Catamount, Albert Bonneau.
Si Gabriel Ferry a inventé en grande partie la mythologie d'une région, c'est Gustave Aimard qui l'a popularisée, au sens où il l'a ouverte à un large public, mais aussi au sens où il l'a simplifiée, la transformant en quelques vignettes accessibles et récurrentes. Le lien est en effet fort entre les deux auteurs: il semble que la plupart des types qu'exploite Aimard dans ses romans pour en faire héros et bandits soient en réalité empruntés aux romans et portraits de Gabriel Ferry: Bois Brûlés, Gambucinos et autres Rastreadores ont en effet été définis par Ferry bien avant que Gustave Aimard n'en fasse les figures centrales de son oeuvre prolixe. Et que dire encore du "Chercheur de traces" qui donne son titre à l'un des romans de l'auteur, et qui rappelle les Chercheurs de pistes, Trouveurs de sentiers et autres Rôdeurs de frontières qu'évoquera Aimard?
Mais s'il est évident que Ferry a fourni à Aimard une source d'inspiration essentielle, il existe également de grandes différences entre les deux auteurs. Aimard se rapporte à la tradition d'un roman-feuilleton exalté et primitif, dans la forme comme dans les thèmes. La structure, rudimentaire, mise sur les rebondissements nombreux et sur l'effet produit par la violence (celle des sentiments et celle que l'on fait subir à son adversaire); en revanche, la représentation de l'espace est rudimentaire et stéréotypée. Le désert est moins un arrière-plan particulier qu'un non-espace dans lequel se croisent sans cesse quelques individus, toujours les mêmes - Aimard substitue d'ailleurs sans mal une forêt ou une prairie au désert, sans que la trame n'en soit modifiée. Sans être un réaliste, Gabriel Ferry s'efforce quant à lui d'offrir une représentation plus fidèle de l'univers qu'il dépeint. Cette fidélité s'inscrit cependant dans la tradition romantique de l'exotisme et du sublime, avec cette idée que les régions démesurées de l'Amérique sont les plus à même de faire surgir les passions les plus folles. Dès lors, le récit de voyage et les souvenirs de voyageur cèdent vite le pas au romanesque le plus débridé. Pour Ferry, le Mexique, c'est aussi l'Espagne et la Méditerranée passionnée dans une version primitive retrouvée, et une telle lecture du paysage explique en partie l'écart qui existe entre l'Amérique qu'il nous peint et celle à laquelle nous sommes aujourd'hui habitués. Le coureur des bois n'est pas un cow boy, même s'il partage avec lui le refus de se fixer. C'est un sang mêlé, mi-Canadien, mi-Indien, c'est-à-dire un homme qui se situe entre notre monde (la vieille Europe) et celui des "sauvages". Il est chargé de faire la passerelle, et de nous guider vers ces régions lointaines, dont il est aussi l'une des curiosités. A la fois cicérone et objet d'une curiosité exotique, médiateur entre l'aventure et la découverte du monde, le coureur des bois illustre la position de Ferry dans sa relation au lecteur, mais celle d'autres auteurs de sa génération Möllhausen, Gerstäcker ou, quelques années plus tard, Benedict-Henry Revoil.
 En ce sens, Gabriel Ferry n'est pas un simple épigone de Fenimore Cooper.
Certes, ses représentations de l'Amérique, sa façon de présenter parfois les
peintures géograhiques comme une sorte d'alter ego spatial des peintures
historiques, sa tendance à retrouver
dans ses coureurs des bois le personnage de Bas de Cuir, ou encore le discours exalté sur
la nature sauvage de l'Amérique que l'on rencontre chez lui, tout cela montre que l'auteur avait lu son
prédécesseur américain, même s'il avait choisi de déplacer la trame de ses
récits considérablement au Sud. Car, malgré ses protestations d'être avant tout
un peintre
de la nature, Ferry reste essentiellement un auteur romanesque, dont les intrigues
n'hésitent pas à emprunter aux ficelles du feuilleton, ou aux trouvailles de ses
aînés et de ses pairs.
En ce sens, Gabriel Ferry n'est pas un simple épigone de Fenimore Cooper.
Certes, ses représentations de l'Amérique, sa façon de présenter parfois les
peintures géograhiques comme une sorte d'alter ego spatial des peintures
historiques, sa tendance à retrouver
dans ses coureurs des bois le personnage de Bas de Cuir, ou encore le discours exalté sur
la nature sauvage de l'Amérique que l'on rencontre chez lui, tout cela montre que l'auteur avait lu son
prédécesseur américain, même s'il avait choisi de déplacer la trame de ses
récits considérablement au Sud. Car, malgré ses protestations d'être avant tout
un peintre
de la nature, Ferry reste essentiellement un auteur romanesque, dont les intrigues
n'hésitent pas à emprunter aux ficelles du feuilleton, ou aux trouvailles de ses
aînés et de ses pairs.
L'oeuvre de Gabriel Ferry, peu abondante, traduit ces hésitations entre plusieurs modes d'écriture qui furent ceux de toute une génération d'auteurs - entre récit romanesque et document, entre souvenirs et fiction. Les premiers récits, en particulier les nouvelles publiées dans La revue des deux mondes et rassemblées en volumes par la suite, insistent sur la couleur locale et la peinture frappante, évoquant pêcheurs de perles et types locaux; quant à la représentation des bandits (qui, en rappelant leurs homologues méditerranéens, prouvent une fois de plus que le Mexique est une sorte d'Espagne du Grand Siècle transposée de nos jours), elle joue sur la curiosité et l'inquiétude à distance. Les romans plus tardifs, Costal l'Indien et Le Coureur des bois, vont s'inscrire dans une tradition plus proche des feuilletons exotiques qui commençaient à l'époque à connaître le succès, succès qui allait s'accroître tout au long du siècle: ils sont pleins de rebondissements, d'enlèvements et de coups de théâtre; mais ils prétendent aussi (c'est en particulier le cas du Coureur des bois) peindre la société et l'histoire des révolutions et des luttes qui ont animé le Mexique.
Ces éléments font de Gabriel Ferry une étape fondamentale dans l'histoire du roman d'aventures exotiques: ils témoignent de l'amorce vers une forme plus populaire de ce type d'oeuvres, mais aussi de la constitution de stéréotypes qui deviendront centraux pour tout le récit de l'Ouest européen, enfin d'une généalogie littéraire plus étonnante, celle qui conduit, en un sens, de Chateaubriand à Gustave Aimard.
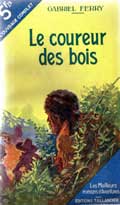 Voici les principales
oeuvres de Gabriel Ferry. Il y en a peut-être d'autres, et toutes n'ont
peut-être pas été réunies en volumes. Si vous possédez d'autres informations
bibliographiques, n'hésitez pas à me
contacter.
Voici les principales
oeuvres de Gabriel Ferry. Il y en a peut-être d'autres, et toutes n'ont
peut-être pas été réunies en volumes. Si vous possédez d'autres informations
bibliographiques, n'hésitez pas à me
contacter.
- Le licencié Don Tadeo Cristobal, 1849.
- Le coureur des bois, 1850.
- Cabecillas y Guerilleros. Scènes de la vie militaire au Mexique, 1851.
- Impressions de voyages et aventures dans le Mexique, la Haute Californie et les régions de l'or, 1851.
- Costal l'Indien, roman historique, scènes de la Guerre de l'indépendance du Mexique, 1852.
- La Chasse aux Cosaques, 1853.
- Scènes de la vie mexicaine, 1855.
- Tancrède de Chateaubrun, 1855.
- Le Capitaine Pallavidas, 1856.
Il existe peu d'études consacrées à Gabriel Ferry. On citera cependant les suivantes:
- Revue Désiré, n° 27, 1970.
- Revue Désiré, n° 28, 1970.
- M. Letourneux, "Le Mexique oublié de Gabriel Ferry", Les Lettres françaises, L'Humanité, 26 juillet 2005.
- G. Sand, "Gabriel Ferry", Préface des Révolutions du Mexique de Gabriel Ferry, 1863 ; repris dans Souvenirs de 1848 (lire le texte ci-dessous).
- M. Soriano et R. Mathé, article "Gabriel Ferry", Guide de littérature pour la jeunesse.
- M. Topin, "Gabriel Ferry", Romanciers contemporains, 1880.
- S. Venayre, "Le moment mexicain dans l’histoire française de l’aventure (1840-1860)", HSAL, n° 7, 1998.
Où trouver les oeuvres de l'auteur?
Gabriel Ferry n'est plus édité depuis longtemps en français. Pis, la plupart des rééditions qu'on trouve sont tronquées, réécrites, simplifiées, et ce, depuis le XIXè siècle. Il faut donc aborder l'oeuvre avec prudence.
Vous trouverez également des adresses de bouquinistes spécialisés dans la littérature populaire sur la page d'adresses.
Dans le cas d'une recherche d'un ouvrage plus rare, le plus simple est de tenter une recherche sur abebooks.fr, principal fournisseur de livres d'occasion.
On peut télécharger en mode image (faible qualité) un très grand nombre d'oeuvres de l'auteur (parfois fort rares) sur le site de la Bibliothèque nationale: Bibliothèque Nationale de France (nécessite Acrobat Reader). Les principales oeuvres de l'auteur, parmi lesquelles:
- Le coureur des bois.
- Costal l'Indien.
George Sand sur Gabriel Ferry.
 Gabriel Ferry naquit à Grenoble en 1809 ; son
père, le baron Ferry de Bellemare,
était engagé dans des affaires
commerciales
avec le nouveau monde ; après avoir achevé d'excellentes études au collège de
Versailles, Gabriel Ferry fut envoyé à Mexico dans la maison de commerce de son
père.
Gabriel Ferry naquit à Grenoble en 1809 ; son
père, le baron Ferry de Bellemare,
était engagé dans des affaires
commerciales
avec le nouveau monde ; après avoir achevé d'excellentes études au collège de
Versailles, Gabriel Ferry fut envoyé à Mexico dans la maison de commerce de son
père.
Mais le jeune homme fut bientôt emporté par l'ardeur de connaître et de posséder en artiste ce monde si bizarre, si pittoresque et si révoltant, cette civilisation qu'il a lui-même qualifiée de douteuse, et dont il a décrit les drames burlesques ou terribles avec tant de verve, de couleur et d'exactitude.
Il voulut parcourir cette vaste contrée tout entière et pénétrer même dans l'immense désert qui la sépare des États-Unis. Une affaire importante que son père avait nouée avec la Californie, alors presque entièrement sauvage, lui permit de traverser la Sonora ; de voir ensuite en passant les quelques huttes qui devaient être, vingt ans plus tard, la ville de San Francisco ; de pénétrer dans le désert, de revenir sur ses pas à travers les dangers de tout genre de ces routes mal hantées ; d'explorer une partie du littoral ; enfin de consacrer quatorze mois à une promenade à cheval de quatorze cents lieues.
Acteur ou témoin oculaire de toutes les aventures qu'il a racontées, plus tard il se piquait de n'avoir presque rien inventé et de devoir plus à la fidélité de sa mémoire qu'à la fécondité de son imagination. Cette double faculté était en lui pourtant, et ses riches observations se rattachent généralement au fil conducteur d'une fiction ingénieuse. Il écrit bien, il est sobre, rapide et coloré. Il a de l'humour, il voit vite et comprend tout. Observateur exact, il ne doit pas être considéré seulement comme un artiste ; ses récits ont une sérieuse valeur ; l'histoire des moeurs peut en faire largement son profit. Conteur attachant, voyageur véridique, la popularité ne lui a pas fait défaut, et c'est justice.
Plus tard, Gabriel Ferry vit l'Espagne.
Il n'écrivit que durant les cinq dernières années de sa vie. Son début fut très remarqué et très apprécié dans la Revue des Deux Mondes 2. Il ne songeait pas encore à faire des romans, il esquissa d'une main ferme les événements et les personnalités historiques qui l'avaient frappé et qu'il avait été à même de bien étudier. Il écrivit les Scènes de la vie sauvage au Mexique, celles de la vie sociale, et celles de la vie militaire. Ses souvenirs prirent alors la forme du roman. Le Coureur des bois, son oeuvre capitale, Costal l'Indien, Les Squatters, etc., eurent un grand retentissement, et captivèrent toutes les classes de lecteurs.
Le roman de moeurs contemporaines, le roman historique le tentèrent aussi Tancrède de Châteaubrun, sa Chasse aux Cosaques, témoignèrent de la souplesse de son talent.
 II n'écrivait pourtant qu'à ses moments perdus, car il était homme d'action
avant tout, et son esprit aventureux et intrépide rêvait toujours les
expéditions lointaines. Il avait acheté une charge de courtier d'assurances
maritimes, dont il se démit pour devenir directeur d'une compagnie créée dans le
même but. En 1851, le gouvernement français lui confia la mission d'aller
recevoir à San Francisco les nombreux émigrants que la fièvre de l'or entassait
sans prévoyance et sans ressources surles rivages californiens.
C'était une mission honorable, délicate, presque héroïque. Les difficultés et
les périls qu'elle comportait stimulèrent le généreux explorateur.
II n'écrivait pourtant qu'à ses moments perdus, car il était homme d'action
avant tout, et son esprit aventureux et intrépide rêvait toujours les
expéditions lointaines. Il avait acheté une charge de courtier d'assurances
maritimes, dont il se démit pour devenir directeur d'une compagnie créée dans le
même but. En 1851, le gouvernement français lui confia la mission d'aller
recevoir à San Francisco les nombreux émigrants que la fièvre de l'or entassait
sans prévoyance et sans ressources surles rivages californiens.
C'était une mission honorable, délicate, presque héroïque. Les difficultés et
les périls qu'elle comportait stimulèrent le généreux explorateur.
Il partit, hélas ! pour ne plus jamais aborder !
Avant de s'embarquer, il écrivait à son jeune fils la touchante lettre que voici :
Southampton, le 1er janvier 1852.
« Je t'ai promis hier de t'écrire, mon enfant chéri, et je tiens ma parole en essayant de le faire le plus lisiblement possible.
« Qu'as tu pensé, mon cher enfant, quand tu as vu que ton papa était parti sans te dire qu'il n'allait plus revenir ?
« C'est la première fois que je t'ai trompé, pauvre cher petit, et ce sera la dernière car, si je l'ai fait, c'était pour te ménager.
« Songe à ce que j'ai dû souffrir les derniers jours quand je voyais chacun de ces jours s'écouler et que je me disais : je n'ai plus que cinq jours, plus que quatre jours, plus que trois, et enfin quand je me suis dit lundi : ceci est le dernier jour et je vais embrasser mes pauvres enfants pour la dernière fois de bien longtemps.
J'ai gardé cet affreux crève-coeur pour moi seul et je n'ai pas voulu vous le faire partager.
« Je te dirai que je suis parti sans M. B. qui n'a dû partir que mercredi. J'étais seul dans mon wagon et c'est seul que j'ai traversé 70 lieues de glaces et de neige, et l'aspect de cette nature lugubre joint à ma solitude n'était pas fait pour dissiper ma mélancolie.
« Je n'ai pu manger de toute la journée, quand je me suis trouvé seul, loin de vous, après avoir traversé la mer le soir même.
« Comme j'étais triste, bon Dieu ! je n'ai pu qu'à peine prendre une tasse dé thé avec du pain et du beurre.
« J'ai passé la nuit à Douvres en Angleterre, et le matin à six heures je suis parti pour Londres où je n'ai pu rester que dix minutes, puis à deux heures je suis arrivé ici.
« J'écris à ta mère pour que le 10 elle porte ses lettres chez M. Marzion. II y en aura une de toi, cher enfant, j'y compte bien, et ne va pas faire le paresseux.
« Te voilà donc, cher petit, par l’absence de ton père, le chef de la famille en qualité d'aîné, ne donne à ta maman que des sujets de satisfaction, et en faisant ton bonheur tu feras le sien propre; Dieu veut ainsi que du bien naisse toujours le bien et que celui qui rend les autres heureux le soit aussi par cela même.....
« ..... Adieu, mon enfant chéri, je t’embrasse avec une tendresse infinie.
« Ton père, G. F. »
Le 2 janvier 1852, il prenait passage à bord de l'Amazone, magnifique paquebot de la compagnie anglaise.
Quarante-huit heures après, on venait à peine de quitter les côtes d'Angleterre que l'incendie envahissait le navire. Deux chaloupes où l'on se précipita pêle-mêle furent submergées ; une troisième ne contint plus que vingt passage mais Gabriel Ferry était pas !
Il avait prévu et constaté le sort des deux premières embarcations, il ne s’était point hâté de profiter de la dernière chance de salut, et quand cette barque fut pleine, il répondit à ce qui le pressaient de prendre place
« - Mourir pour mourir, j'aime autant rester ici ! »
 Il prit ce parti avec une tranquillité extraordinaire peut-être avec le
sentiment secret d'un héroïque dévouement. On le lui a attribué. Sa fermeté
d'âme durant les angoisses drame de l'incendie a autorisé ses compagnons à le
penser et à le dire, car cette mort terrible et noble est
déjà
passée à l'état de légende.
Il prit ce parti avec une tranquillité extraordinaire peut-être avec le
sentiment secret d'un héroïque dévouement. On le lui a attribué. Sa fermeté
d'âme durant les angoisses drame de l'incendie a autorisé ses compagnons à le
penser et à le dire, car cette mort terrible et noble est
déjà
passée à l'état de légende.
La chaloupe qui portait les derniers débris de l'équipage et qui errait au hasard dans les ténèbres sur une mer houleuse entendit vers cinq heures du matin une explosion formidable. C'était l'Amazone qui sautait avec le reste de ses passagers !
Gabriel Ferry, plus égoïste ou moins stoïque, eût pu être sauvé, car la barque fut rencontrée, et les passagers reçus au bout de quelques heures, par une galiote hollandaise.
Georges Sand.