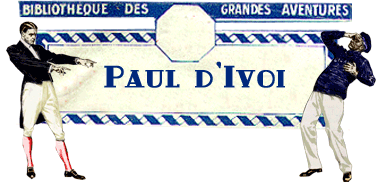
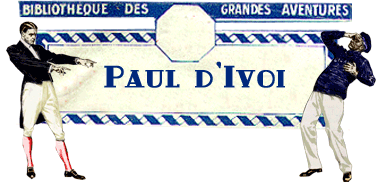

Bibliographie (première partie) et biographie.
Présentation des "Voyages excentriques".
Bibliographie (suite), et présentation de l'oeuvre.
Où trouver les oeuvres de Paul d'Ivoi?
Bibliographie
(première partie) et biographie.
Né en 1856 et mort en 1915, Paul d’Ivoi, de son vrai nom Paul Deleutre, est issu d’une famille d’écrivains signant de père en fils sous le nom de d’Ivoi (Edouard Deleutre, son grand-père, a collaboré sous le nom de Paul d’Ivoi à de nombreux journaux, son père, Charles Deleutre, qui signait soit Paul d’Ivoi, soit Charles de Leutre, a publié un Précis de l’histoire de l’Art).
Paul d’Ivoi fait ses débuts comme journaliste à Paris-journal puis au Figaro, avant de devenir critique littéraire au Globe. Il restera toute sa vie, avec Louis Boussenard, l’un des piliers du Journal des voyages.
|
Le diamant d'Osiris (ici, dans une édition Tallandier des années 50) est d'abord paru sous le nom du Cousin de Lavarède. |
Ses premiers romans-feuilletons sont un peu oubliés : on citera, pour mémoire, Le capitaine Jean (publié dans le Rappel), La femme au diadème rouge (dans Le soleil), Olympia et Cie (dans L’éclair). C’est avec Les cinq sous de Lavarède, écrit en collaboration avec Léon Chabrillat et paru en 1894 dans Le petit journal, et premier de ses « voyages excentriques », que Paul d’Ivoi connaît la célébrité. Suivront, au rythme d’un ouvrage par an, Le sergent Simplet (1895), Le cousin de Lavarède (1895, réédité chez Tallandier sous le titre Le diamant d’Osiris), Jean Fanfare (1897), Le corsaire Triplex (1898), Le capitaine Nilia (1898), Le docteur Mystère (1899), Cigale en Chine (1901), Massiliague de Marseille (1902), Les semeurs de glace (1903), Le serment de Daalia (1904), Millionnaire malgré lui (1905), Miss Mousqueterr (1907), Le maître du drapeau bleu (1907), Judd Allan, roi des « lads » (1909), La course au radium (1910), L’aéroplane fantôme (1910), Le message du Mikado (1912), Les voleurs de foudre (1912), Match de milliardaires (paru d'abord sous le titre de L'évadé malgré lui, 1913-14) et Les dompteurs de l’or (1914) : nombre de ces récits seront publiés sous des titres différents, parfois (comme souvent chez Tallandier), scindés en plusieurs volumes.
Présentation des "Voyages excentriques".
|
Même format, même type d'illustration mettant en valeur les transports modernes et le dépaysement, même couverture dorée: l'édition Boivin imite en tos points les collections Hetzel des oeuvres de Jules Verne. |
Dans cette série populaire, publiée chez Boivin et Cie et destinée à la jeunesse, Paul d’Ivoi exploite la veine des « voyages extraordinaires » dont Jules Verne avait assuré le succès. Le nom même de sa série, « voyages excentriques », et la forme des ouvrages cartonnés de Boivin, est un décalque de la collection des œuvres de Verne. L’aéroplane fantôme rappelle par bien des côtés Robur le conquérant, Le corsaire Triplex est une sorte de Nemo patriote, le véhicule du Docteur mystère fait penser à celui de La maison à vapeur, les tours du monde loufoques des héros, Les cinq sous de Lavarède, Match de milliardaires, font songer au Testament d’un excentrique, et le lien des Cinq sous avec Le tour du monde en quatre-vingts jours est évident : dans les deux cas, le héros part à l'aventure dans des conditions difficiles (cinq sous ou un temps limité), dans les deux cas, une série de contraintes donne au récit l'aspect d'une course contre la montre (qui s'achève in extremis); la réécriture va jusqu'à introduire un équivalent à Fix, le détective du Tour du monde, en la personne de l'odieux Bouvreuil; et l'on trouve, chez Sir Murlyton, qui accompagne Lavarède, bien des points communs avec Philéas Fogg.
Dans le style, on retrouve encore bien des points communs avec cet auteur : l’un comme l’autre cherchent à instruire en distrayant ; l’un comme l’autre proposent, à travers les aventures de leur(s) héros, une découverte du monde et de ses curiosités ; l’un comme l’autre osent des inventions extraordinaires, les extrapolations et l’ancrage dans le plus grande modernité (Le Corsaire Triplex décrit non seulement un sous-marin, mais aussi des téléphones (I ch.11) et un cinématographe (II ch.11) et Le Bolide de Lavarède ou La Course au radium (1909) se consacrent aux aventures automobiles de leurs héros). Comme chez Verne (Maître du monde, L’éternel Adam), cette fascination pour la modernité est souvent mêlée d'angoisse: des aéronefs sèment la mort par des nuages réfrigérants (Les Dompteurs de l'or, 1913) dans Les Semeurs de glace, on manipule le climat, et dans L'Aéroplane fantôme, les Allemands menacent de dérober les plans précieux d'un aéroplane révolutionnaire, capable de semer la mort sur son passage.
Mais on a souvent l’impression que, si Jules Verne s’adresse au bons élèves, Paul d’Ivoi ne s’acquitte de sa mission pédagogique et éducative que bon gré mal gré. Le monde devient l’occasion d’anecdotes amusantes plutôt que de leçons, les plaisanteries sont souvent d’assez mauvais goût, et l’imagination ne demande qu’à s’envoler : dans Les cinq sous de Lavarède, le héros voyage en cercueil (ce qu’Hergé, dans Les cigares du Pharaon, saura réexploiter – lui qui, sans doute grand lecteur de romans d'aventures, dans Le temple du soleil, s’inspirait d’un autre auteur de romans d'aventures, Rider Haggard, lors de l’épisode de l’éclipse, et dont on a pu montrer récemment combien il avait subi l’influence de Jules Verne), les armes employées sont aussi bien futuristes (le Vultur des Dompteurs de l’or) que fantastiques (les pouvoirs brahmaniques du Docteur Mystère), et les tours du monde sont autrement plus loufoques que ceux de Verne (Lavarède doit voyager avec cinq sous et Jaspers Flack, dans Match de milliardaires, procède à un véritable tour du monde des prisons).
Bibliographie (suite), et présentation de l'oeuvre.
Outre sa série des « voyages excentriques », d’Ivoi s’est illustré dans un certain nombre de récits patriotiques, écrits avec le colonel Royet : Les briseurs d’épée (1903-1905), Le capitaine Matraque (1906), l’espion d’Alsace (1906). Cette veine patriotique apparaît encore dans les quelques récits historiques qu’il écrira sous le pseudonyme de Paul Eric : Les cinquante (1815), l’île d’Elbe et Waterloo (collection « les romans de l’Histoire », Courbet, 1904) ou La mort de l’Aigle (1814) (idem, 1901). Mais elle apparaît encore à travers le discours colonial et les réflexions cocardières qui traversent ses « voyages excentriques » : les Anglais des Cinq sous de Lavarède, pourtant relativement épargnés, possèdent les tares auxquelles on les associait à l’époque (principes, inflexibilité et puritanisme),partout, les Américains sont de grossiers matérialistes, les Allemands sont des brutes, sans compter les malheureuses populations des colonies qui sont présentées le plus souvent comme stupides et pleutres, et parfois gratuitement cruelles (l’étude de son ouvrage en livraisons Les Juifs à travers les âges nous en dirait sans doute un peu plus sur le racisme de Paul d’Ivoi – malheureusement, nous n’en possédons pas de copie). Cette lecture raciste du monde n’est pas propre à Paul d’Ivoi. On la retrouve sans grand changement dans tout le roman d’aventures exotiques et coloniales à la française : chez Verne (on oublie ainsi trop souvent que dans Les enfants du capitaine Grant on s’interroge très
|
Portant pour toute légende "L'Inde", cette illustration du Cousin Simplet montre le caractère essentiellement théâtral (donc raciste) de l'imaginaire exotique dans l'oeuvre de Paul d'Ivoi. |
sérieusement pour savoir si les Aborigènes sont des hommes ou des singes), chez Jacolliot ou chez André Laurie ; et d’autres auteurs, tels Louis Noir ou le capitaine Danrit, tenaient à l’époque des discours autrement plus racistes encore. Il est difficile de savoir avec précision dans quelle mesure ces auteurs ont exploité la forme du roman d'aventures coloniales pour faire passer leur idéologie, et dans quelle mesure cette forme, parce qu’elle implique une vision manichéenne et stéréotypée du monde, a favorisé l’émergence de réflexions racistes partagées par toutes les classes de la société de l’époque. Autrement dit, choisissait-on d’écrire des roman d'aventures coloniales parce qu’on était raciste ou le cadre et la forme du récit laisse-t-elle paraître une vision du monde partagée par tous à l’époque ? Une telle question est essentielle à qui veut étudier Paul d’Ivoi et l’ensemble des auteurs de romans d'aventures coloniales de façon équitable. La réponse semble varier au cas par cas et requérir une lecture attentive des textes et d’autres écrits de l’époque (presse, discours politiques, romans exotiques, etc.). Chez Paul d’Ivoi, le discours raciste semble s'expliquer par une vision de carton pâte du monde : il ne semble jamais tout à fait dupe des aventures de ses personnages ; leurs rencontres sont improbables et participent d’une mécanique abstraite et manichéenne – ici le stéréotype raciste se confond avec la tendance de la littérature populaire à user de types littéraires.
Le projet de Paul d'Ivoi est doublement nationaliste. D'abord, les récits sont souvent cocardiers, et à la limite du bellicisme: les ennemis sont inévitablement soit des Allemand, soit des Anglais qui menacent les intérêts français. Mais les œuvres de Paul d'Ivoi sont également cocardières parce qu'elles témoignent d'une volonté de créer un roman d'aventures à la française capable de concurrencer le roman d'aventures britannique qui règne en maître à l'époque. Il ressemble en cela aux œuvres de Jules Verne, de Jacolliot ou d’Alfred Assollant. Il prend pour modèle l' "esprit français" ou l' "esprit parisien", tels qu'on les imaginait à l'époque. Le héros, dont l'incarnation est Lavarède (qui réapparaît dans de nombreuses œuvres), est gouailleur, farceur, débrouillard, un peu joli cœur; il ne recule devant aucune malhonnêteté pour parvenir à ses fins, même si son sens de la justice est indéfectible. Lavarède donne une bonne idée de l'image que les Français avaient d'eux-mêmes. Et le récit est dans la même veine: l'auteur n'a pas l'air de prendre au sérieux les péripéties qu'il nous raconte, et donne au récit un ton assez proche du boulevard (on doit à Paul d’Ivoi un certain nombre de pièces de théâtre, d’inspiration boulevardière : Le mari de ma femme (1887), La pie au nid (1887) ou Le tigre de la rue Tronchet (1888). En 1902, il donnera une version théâtrale des Cinq sous de Lavarède). Ses œuvres restent savoureuses, malgré le caractère agaçant du nationalisme, malgré la longueur de certains épisodes, malgré de nombreux poncifs et stéréotypes, parce que la jubilation qu'on devine dans la plume de l'auteur n'a pas vieilli.
Les œuvres de Paul d’Ivoi ont connu un succès continu au cours du XXème siècle, et ce, jusqu’à une période très récente : après Furne et Boivin, Combet et Cie publie à son tour la série complète des « Voyages excentriques », puis Tallandier la réédite constamment, dans des éditions bon marché jusqu’aux années 60. Enfin, J’ai Lu procède, au début des années 80 à ma publication de toute la série, sans doute pour concurrencer le succès des Jules Verne en Livre de Poche.
Le cinéma proposera plusieurs versions des Cinq sous de Lavarède, parmi lesquelles une version muette de 1927 par Maurice Champreux et une version parlante de 1939, par Maurice Cammage.
Paul d’Ivoi semble lui-même avoir participé à quelques projets cinématographiques, comme Les Enfants d'Edouard (1910, dirigé par Henri Andréani), d’après Casimir Delavigne, dont il signa l’adaptation.
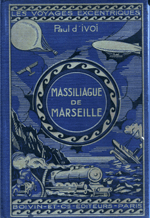
L'une des éditions Boivin des oeuvres de Paul d'Ivoi. |
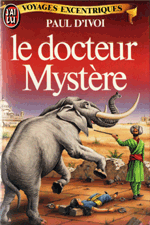
Si elle est comme les autres épuisée, l'édition J'ai Lu des oeuvres d'Ivoi est certainement la plus accessible aujourd'hui. |

L'édition Combet représente, avec la version de poche des éditions Boivin, la transition entre les collections luxueuses de chez Boivin et les éditions populaires de chez Tallandier |
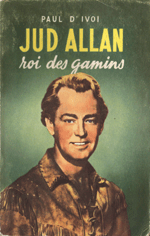
Cette édition, sans doute la dernière de chez Tallandier, témoigne du vieillissement d'un certain vocabulaire: le "roi des lads" est devenu "roi des gamins" ! |
Où trouver les oeuvres de Paul d'Ivoi?
Il n'y a plus actuellement d'oeuvre de Paul d'Ivoi accessible en librairie.
On trouve des ouvrages sur abebooks.fr, site de livres d'occasion.
On peut télécharger en mode image (faible qualité) Les cinq sous de Lavarède sur le site de la Bibliothèque nationale: Bibliothèque Nationale de France (nécessite Acrobat Reader). Les ouvrages accessibles en ligne sont les suivants:
- Les cinq sous de Lavarède.
- Les grands explorateurs, La Mission Marchand.
Vous trouverez également des adresses de bouquinistes spécialisés dans la littérature populaire sur ma page d'adresses.