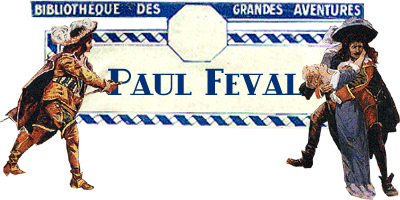
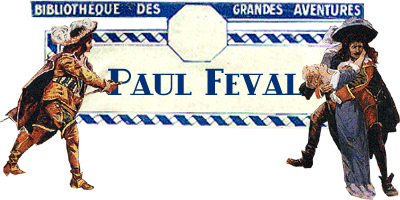

1817-1887
Lire les premiers chapitres du Cavalier Fortune.
Où trouver les oeuvres de l'auteur?
 Paul Féval est l’un des grands romanciers populaires du
premier XIXè siècle. Il s’est illustré dans la plupart des genres à succès de
l’époque : roman de cape et d’épée (Le Bossu,
Le cavalier Fortune, Le Capitaine fantôme),
mystère urbain (avec son adaptation des Mystères de Londres de Reynolds),
récits bretons (en particulier dans ses derniers livres, comme La Belle
étoile ou La Première aventure de Corentin Quimper) ou le récit
fantastique (La Vampire ou Le Chevalier Ténèbre). Aux côtés
d’Alexandre Dumas et d’Eugène Sue, Paul Féval est l’un des maîtres du roman
feuilleton de la première génération. Il ne verra son étoile ternir qu’à partir
des années 1860-1870, dépassé par Ponson du Terrail puis par la vogue montante
du roman d’aventures géographiques. A côté du Bossu, œuvre la plus
fameuse de l’auteur chez les amateurs de récits d’aventures et de cape et
d’épée, on lui doit d’autres œuvres qui ont eu une grande influence sur
l’imaginaire du roman d’aventures populaires, comme les Habits noirs,
vaste fresque urbaine qui n’est pas sans rappeler Les mystères de Paris
d’Eugène Sue.
Paul Féval est l’un des grands romanciers populaires du
premier XIXè siècle. Il s’est illustré dans la plupart des genres à succès de
l’époque : roman de cape et d’épée (Le Bossu,
Le cavalier Fortune, Le Capitaine fantôme),
mystère urbain (avec son adaptation des Mystères de Londres de Reynolds),
récits bretons (en particulier dans ses derniers livres, comme La Belle
étoile ou La Première aventure de Corentin Quimper) ou le récit
fantastique (La Vampire ou Le Chevalier Ténèbre). Aux côtés
d’Alexandre Dumas et d’Eugène Sue, Paul Féval est l’un des maîtres du roman
feuilleton de la première génération. Il ne verra son étoile ternir qu’à partir
des années 1860-1870, dépassé par Ponson du Terrail puis par la vogue montante
du roman d’aventures géographiques. A côté du Bossu, œuvre la plus
fameuse de l’auteur chez les amateurs de récits d’aventures et de cape et
d’épée, on lui doit d’autres œuvres qui ont eu une grande influence sur
l’imaginaire du roman d’aventures populaires, comme les Habits noirs,
vaste fresque urbaine qui n’est pas sans rappeler Les mystères de Paris
d’Eugène Sue.
Paul Féval est né en 1816, à Rennes, où il passe les premières années de sa vie. La région va jouer un rôle dans son imaginaire, puisque l’auteur va par la suite régulièrement s’inspirer de la culture et du folklore bretons dans de nombreuses œuvres. Il passe une licence de Droit, s’apprête à embrasser la carrière d’avocat, mais après un échec dans ce domaine (qui n’est pas sans rappeler le destin d’une figure postérieure du récit de cape et d’épée, le britannique Stanley Weyman), il quitte la région pour Paris, dans l’espoir de réussir dans les lettres.
Après des débuts littéraires difficiles (« Un duel sous
l’eau », sa première nouvelle,
 paraît en 1837), il connaît le succès avec Le
Club des phoques, roman se déroulant à Saint Malo (paru dans La Revue de
Paris), et surtout, à partir de 1843, avec la réécriture des
Mystères de Londres de Reynolds. Dans ses propres
Mystères de Londres, Paul Féval ne suit que très lointainement le modèle
britannique. En réalité, il publie, sous le nom de Francis Trolopp, sa propre
fresque des bas-fonds londoniens. On y devine l’influence des Mystères de
Paris d’Eugène Sue, qui est paru en feuilleton à partir de 1842. Il y a dans
les deux œuvres une même volonté de peindre les différentes couches de la
société, une même représentation d’un espace urbain opposant la surface d’un
monde connu des lecteurs, et la réalité de ce même espace, exotique et
inquiétante, comme dans Le Juif Errant (plus que dans Les Mystères de
Paris) la société apparaît dirigée par des puissances occultes, toutes
puissantes parce qu’elles sont cachées. Chez Paul Féval, il s’agit de la Grande
Famille de Londres, société du crime à laquelle appartient le personnage
principal, le marquis Rio-Santo. Rio-Santo lui-même, en dandy fashionable
qui masque son identité véritable, n’est pas sans évoquer le Prince Rodolphe,
héros des Mystères de Paris de Sue, même si, plus ambigu que ce dernier,
il préfigure également Edmond Dantes (Le Comte de Monte Cristo de
Dumas
ne paraît que deux ans plus tard). Autour de la vengeance de l’Irlandais Fergus
(sous les traits de Rio Santos), c’est un portrait à charge de l’Angleterre qui
est proposé. Reste que, si l’on retrouve l’influence de
Sue, Féval paraît
privilégier l’aventure au détriment du discours social (ce discours qui
deviendra bientôt chez Sue un véritable discours socialiste). Féval reprendra à
plusieurs reprises le motif de l’opposition entre l’Angleterre et l’Irlande, par
exemple dans La quittance de minuit. Ce roman de la vengeance est
également un roman du crime et de la machination, thèmes privilégiés de Paul
Féval qui feront de lui à plus d'un titre l'un des précurseurs du roman
policier. Il exploitera le filon du roman criminel durant toute sa première
carrière littéraire (celle précédant sa conversion), aussi bien dans ses romans
de mystères urbains
(voir Les Habits Noirs), que dans les romans de moeurs (souvent fondés
sur des machinations (Jean Diable,1862, La Tache rouge, 1870, Le
Dernier vivant, 1872) ou dans les romans historiques (Le Bossu est un
roman de la vengeance, et Le Mari embaumé, 1866, un roman de meurtre et
de fausse mort se déroulant au XVIIè siècle). Il se moquera de cette veine
florissante du roman-feuilleton dans un bref récit parodique, La Fabrique de
crime, 1866.
paraît en 1837), il connaît le succès avec Le
Club des phoques, roman se déroulant à Saint Malo (paru dans La Revue de
Paris), et surtout, à partir de 1843, avec la réécriture des
Mystères de Londres de Reynolds. Dans ses propres
Mystères de Londres, Paul Féval ne suit que très lointainement le modèle
britannique. En réalité, il publie, sous le nom de Francis Trolopp, sa propre
fresque des bas-fonds londoniens. On y devine l’influence des Mystères de
Paris d’Eugène Sue, qui est paru en feuilleton à partir de 1842. Il y a dans
les deux œuvres une même volonté de peindre les différentes couches de la
société, une même représentation d’un espace urbain opposant la surface d’un
monde connu des lecteurs, et la réalité de ce même espace, exotique et
inquiétante, comme dans Le Juif Errant (plus que dans Les Mystères de
Paris) la société apparaît dirigée par des puissances occultes, toutes
puissantes parce qu’elles sont cachées. Chez Paul Féval, il s’agit de la Grande
Famille de Londres, société du crime à laquelle appartient le personnage
principal, le marquis Rio-Santo. Rio-Santo lui-même, en dandy fashionable
qui masque son identité véritable, n’est pas sans évoquer le Prince Rodolphe,
héros des Mystères de Paris de Sue, même si, plus ambigu que ce dernier,
il préfigure également Edmond Dantes (Le Comte de Monte Cristo de
Dumas
ne paraît que deux ans plus tard). Autour de la vengeance de l’Irlandais Fergus
(sous les traits de Rio Santos), c’est un portrait à charge de l’Angleterre qui
est proposé. Reste que, si l’on retrouve l’influence de
Sue, Féval paraît
privilégier l’aventure au détriment du discours social (ce discours qui
deviendra bientôt chez Sue un véritable discours socialiste). Féval reprendra à
plusieurs reprises le motif de l’opposition entre l’Angleterre et l’Irlande, par
exemple dans La quittance de minuit. Ce roman de la vengeance est
également un roman du crime et de la machination, thèmes privilégiés de Paul
Féval qui feront de lui à plus d'un titre l'un des précurseurs du roman
policier. Il exploitera le filon du roman criminel durant toute sa première
carrière littéraire (celle précédant sa conversion), aussi bien dans ses romans
de mystères urbains
(voir Les Habits Noirs), que dans les romans de moeurs (souvent fondés
sur des machinations (Jean Diable,1862, La Tache rouge, 1870, Le
Dernier vivant, 1872) ou dans les romans historiques (Le Bossu est un
roman de la vengeance, et Le Mari embaumé, 1866, un roman de meurtre et
de fausse mort se déroulant au XVIIè siècle). Il se moquera de cette veine
florissante du roman-feuilleton dans un bref récit parodique, La Fabrique de
crime, 1866.
Si Les Mystères de Londres connaissent un succès d’estime, ils installent surtout l’auteur dans la société des lettres. Ce seront Les Amours de Paris, second feuilleton de Féval, qui le consacreront comme auteur populaire de premier plan. Cette seconde œuvre s’inscrit également dans la tradition des mystères urbains tels que les a inventés Eugène Sue (et le titre est une reprise des Mystères de Paris), même si l’auteur délaisse un peu plus encore, par rapport à son prédécesseur, la peinture de la société au profit des intrigues privées. Grâce à ce second roman, Féval devient, à partir de cette date, l’une des figures centrales de la littérature populaire. Un roman comme Le Fils du Diable (1846), œuvre qui s’inscrit nettement dans la tradition du romantisme noir, va encore accroître son succès.
Comme Dumas et Sue, Féval est désormais riche. Comme eux, il s’affiche dans le monde. Son succès va s’accroître régulièrement, mais condamner l’auteur à rester un feuilletoniste, un écrivain méprisé de l’élite. Dès la fin des années 1840, le feuilleton est attaqué par les gens de plume (à commencer par Sainte Beuve) et les hommes politiques. S’il n’est pas leur cible privilégié (on attaque plus volontiers Balzac, Dumas et Sue), Féval se voit, plus encore que ces trois auteurs mieux reconnus, cantonné dans la littérature de divertissement. Il varie certes les sujets, mais le fond et la forme de l’intrigue restent feuilletonesques, avec de très nombreux rebondissement, un rythme de l’action et de la narration très enlevé, et une écriture qui ne renie pas les effets de pathos et la tonalité épique.
 Parmi les genres privilégiés par l’auteur, il faut citer au
premier chef les romans de mœurs, qui insistent sur un sentimentalisme qui
multiplie les évocations de cœurs maltraités dans l’adversité (Alizia Pauli,
1848, Une pêcheresse, 1848). A côté de ces œuvres, l’auteur propose une
série de romans sociaux qui, à défaut d’engager une véritable réflexion sur
l’époque, tentent souvent d’exploiter le thème, déjà central dans Les
Mystères de Londres, des relations entre Grande-Bretagne et Irlande (La
quittance de minuit, 1846, Les ouvriers de Londres, 1848), tout en
s’inscrivant résolument dans la perspective du récit de mystère urbain (La
quittance de minuit décrit les agissements d’une société secrète, les
Molly Maguires, Le fils du Diable est un récit de justicier, Les
amours de Paris, 1845, retrouve le thème des échanges d’identités, et toutes
ces œuvres prétendent décrire le visage caché de la société contemporaine).
Enfin, Féval développe ses récits bretons, dont certains sont restés fameux.
Le loup blanc (1843), publié régulièrement dans des éditions de jeunesse
jusqu’aux années 1980, décrit une Bretagne mythique, peuplée de Bretons
courageux et au grand cœur (ceux-là même que l’on retrouvera, dans une
perspective politique, au cœur du dispositif des Mystères du peuple de
Sue), en lutte, par le biais de bandes mystérieuses vivant dans les forêts,
contre l’autorité française. Viendra La fontaine aux perles (roman
historique paru en1845), Le mendiant noir (1846, roman de mœurs et de
vengeance), et surtout La Fée des Grèves, sans doute le plus connu des
récits bretons de Féval, roman historique qui se déroule en 1450 et mêle
histoire et folklore.
Parmi les genres privilégiés par l’auteur, il faut citer au
premier chef les romans de mœurs, qui insistent sur un sentimentalisme qui
multiplie les évocations de cœurs maltraités dans l’adversité (Alizia Pauli,
1848, Une pêcheresse, 1848). A côté de ces œuvres, l’auteur propose une
série de romans sociaux qui, à défaut d’engager une véritable réflexion sur
l’époque, tentent souvent d’exploiter le thème, déjà central dans Les
Mystères de Londres, des relations entre Grande-Bretagne et Irlande (La
quittance de minuit, 1846, Les ouvriers de Londres, 1848), tout en
s’inscrivant résolument dans la perspective du récit de mystère urbain (La
quittance de minuit décrit les agissements d’une société secrète, les
Molly Maguires, Le fils du Diable est un récit de justicier, Les
amours de Paris, 1845, retrouve le thème des échanges d’identités, et toutes
ces œuvres prétendent décrire le visage caché de la société contemporaine).
Enfin, Féval développe ses récits bretons, dont certains sont restés fameux.
Le loup blanc (1843), publié régulièrement dans des éditions de jeunesse
jusqu’aux années 1980, décrit une Bretagne mythique, peuplée de Bretons
courageux et au grand cœur (ceux-là même que l’on retrouvera, dans une
perspective politique, au cœur du dispositif des Mystères du peuple de
Sue), en lutte, par le biais de bandes mystérieuses vivant dans les forêts,
contre l’autorité française. Viendra La fontaine aux perles (roman
historique paru en1845), Le mendiant noir (1846, roman de mœurs et de
vengeance), et surtout La Fée des Grèves, sans doute le plus connu des
récits bretons de Féval, roman historique qui se déroule en 1450 et mêle
histoire et folklore.
 La tentative de
Féval, dans les années 1850,
d’échapper au carcan du feuilleton et d’offrir, avec Le tueur de tigres
(1853), une peinture de la société, est vouée à l’échec : elle ne correspond pas
à l’image que le peuple et l’élite culturelle se font de l’auteur. C’est donc
dans le feuilleton que Féval doit connaître la consécration, et cette
consécration, c’est Le Bossu qui l’apportera en 1857.
Ce récit, quintessence du roman de cape et d’épée, occultera par la suite la
plupart des autres œuvres de ce prolifique romancier populaire, reléguant loin
derrière Les Habits noirs, Le loup blanc ou Les mystères de
Londres – pour ne citer que ses œuvres les plus fameuses. C’est en effet,
bien plus que les romans de Dumas dont il s’inspire en partie, le premier roman
de cape et d’épée qu’écrit ici Féval, au sens où il donne la première place à
l’aventure, et laisse l’Histoire à l’arrière-plan (là où
Dumas reste
généralement, et même dans Les Trois mousquetaires, un romancier de
l’Histoire). Peu de figures historiques sont présentes dans cette œuvre, le
personnage central est lui-même un personnage fictif, et l’intrigue, si elle met
en jeu les conséquences des manœuvres économiques de Law, en reste
essentiellement à des développements privés. Certes, le roman donne une peinture
intéressante de l’atmosphère délétère de la France du régent Philippe d’Orléans.
Mais c’est une France revue par le feuilleton, faite d’intrigues et de stupre.
Les scandales de l’époque deviennent machinations, et l’ambiance est à l’orgie
et à la perversité. Alors que la description de l’Espagne cède au goût de la
couleur locale, la ville de Paris du XVIIIè siècle ressemble fort à celle des
mystères urbains du XIXè siècle, avec ses repères de voyous et ses travers
honteux des classes dirigeantes. Enfin, ce monde corrompu permet à Féval
d’opposer deux univers : celui de l’Histoire, de la société et de la loi d’une
part, inefficace et soumis à toutes les manigances, et celui du courage et des
valeurs chevaleresques déclinantes à l’époque (mais chaque époque du roman
d’aventures historiques ne décrit-elle pas le déclin des valeurs
chevaleresques ?) incarné par Lagardère et le duc de Nevers. Dès lors, dans ce
monde livré au chaos et au mal, l’aventure advient pour purger les travers de la
société ; querelle personnelle et oppositions « historiques » se confondent dans
la logique du feuilleton. Car si Lagardère participe aux spéculations
financières de Law sous le costume du bossu, il ne le fait pas comme acteur de
l’Histoire, mais pour perdre ses adversaires personnels grâce à de savants
calculs. L’Histoire sert d’arrière-plan à la vengeance privée de Lagardère
contre les anciens meurtriers de Nevers. Ses ennemis ne sont d’ailleurs pas des
personnages historiques, mais de diaboliques adversaires tirés de l’arrière-plan
de l’Histoire (le Prince de Gonzague) ou de la fiction (son âme damnée, M. de
Peyrolles). Mais c’est la logique narrative surtout qui échappe à l’Histoire
pour lui substituer les stéréotypes de l’aventure : déguisements, machinations,
reconnaissances, vengeance, duels, héros protégeant l’orpheline et éveil à
l’amour, autant d’éléments qui nous inscrivent dans la tradition du roman
d’aventures feuilletonesque.
La tentative de
Féval, dans les années 1850,
d’échapper au carcan du feuilleton et d’offrir, avec Le tueur de tigres
(1853), une peinture de la société, est vouée à l’échec : elle ne correspond pas
à l’image que le peuple et l’élite culturelle se font de l’auteur. C’est donc
dans le feuilleton que Féval doit connaître la consécration, et cette
consécration, c’est Le Bossu qui l’apportera en 1857.
Ce récit, quintessence du roman de cape et d’épée, occultera par la suite la
plupart des autres œuvres de ce prolifique romancier populaire, reléguant loin
derrière Les Habits noirs, Le loup blanc ou Les mystères de
Londres – pour ne citer que ses œuvres les plus fameuses. C’est en effet,
bien plus que les romans de Dumas dont il s’inspire en partie, le premier roman
de cape et d’épée qu’écrit ici Féval, au sens où il donne la première place à
l’aventure, et laisse l’Histoire à l’arrière-plan (là où
Dumas reste
généralement, et même dans Les Trois mousquetaires, un romancier de
l’Histoire). Peu de figures historiques sont présentes dans cette œuvre, le
personnage central est lui-même un personnage fictif, et l’intrigue, si elle met
en jeu les conséquences des manœuvres économiques de Law, en reste
essentiellement à des développements privés. Certes, le roman donne une peinture
intéressante de l’atmosphère délétère de la France du régent Philippe d’Orléans.
Mais c’est une France revue par le feuilleton, faite d’intrigues et de stupre.
Les scandales de l’époque deviennent machinations, et l’ambiance est à l’orgie
et à la perversité. Alors que la description de l’Espagne cède au goût de la
couleur locale, la ville de Paris du XVIIIè siècle ressemble fort à celle des
mystères urbains du XIXè siècle, avec ses repères de voyous et ses travers
honteux des classes dirigeantes. Enfin, ce monde corrompu permet à Féval
d’opposer deux univers : celui de l’Histoire, de la société et de la loi d’une
part, inefficace et soumis à toutes les manigances, et celui du courage et des
valeurs chevaleresques déclinantes à l’époque (mais chaque époque du roman
d’aventures historiques ne décrit-elle pas le déclin des valeurs
chevaleresques ?) incarné par Lagardère et le duc de Nevers. Dès lors, dans ce
monde livré au chaos et au mal, l’aventure advient pour purger les travers de la
société ; querelle personnelle et oppositions « historiques » se confondent dans
la logique du feuilleton. Car si Lagardère participe aux spéculations
financières de Law sous le costume du bossu, il ne le fait pas comme acteur de
l’Histoire, mais pour perdre ses adversaires personnels grâce à de savants
calculs. L’Histoire sert d’arrière-plan à la vengeance privée de Lagardère
contre les anciens meurtriers de Nevers. Ses ennemis ne sont d’ailleurs pas des
personnages historiques, mais de diaboliques adversaires tirés de l’arrière-plan
de l’Histoire (le Prince de Gonzague) ou de la fiction (son âme damnée, M. de
Peyrolles). Mais c’est la logique narrative surtout qui échappe à l’Histoire
pour lui substituer les stéréotypes de l’aventure : déguisements, machinations,
reconnaissances, vengeance, duels, héros protégeant l’orpheline et éveil à
l’amour, autant d’éléments qui nous inscrivent dans la tradition du roman
d’aventures feuilletonesque.
 Dans Le Bossu, Féval est en réalité plus proche
d’Amédée Achard ou d’Emmanuel Gonzalès que d’Alexandre
Dumas, même si sa
peinture de l’époque est assez soignée, et ne se contente pas, comme chez les
auteurs qui le suivront (à commencer par son fils) de reprendre les conventions
définies par Dumas dans ses grands cycles. Ce sera moins vrai des romans
historiques postérieurs de l’auteur. Les Compagnons du silence (1857),
récit se déroulant en Italie au XVIIIè siècle, cède à la mode des bandits
napolitains, retrouvant les conspirations et les sociétés secrètes chères à
Féval ; Le Roi des gueux profite du goût pour l’Espagne et pour la
couleur locale, et rappelle par moment, par accident certainement, certaines
pages de Fernández y González. Ces romans laissent une place plus superficielle
à l’Histoire, réduite à quelques images conventionnelles, mais c’est au profit
de l’aventure et des rebondissements, qui font la séduction des œuvres.
Dans Le Bossu, Féval est en réalité plus proche
d’Amédée Achard ou d’Emmanuel Gonzalès que d’Alexandre
Dumas, même si sa
peinture de l’époque est assez soignée, et ne se contente pas, comme chez les
auteurs qui le suivront (à commencer par son fils) de reprendre les conventions
définies par Dumas dans ses grands cycles. Ce sera moins vrai des romans
historiques postérieurs de l’auteur. Les Compagnons du silence (1857),
récit se déroulant en Italie au XVIIIè siècle, cède à la mode des bandits
napolitains, retrouvant les conspirations et les sociétés secrètes chères à
Féval ; Le Roi des gueux profite du goût pour l’Espagne et pour la
couleur locale, et rappelle par moment, par accident certainement, certaines
pages de Fernández y González. Ces romans laissent une place plus superficielle
à l’Histoire, réduite à quelques images conventionnelles, mais c’est au profit
de l’aventure et des rebondissements, qui font la séduction des œuvres.
Malgré le succès du Bossu et des récits de mystères
urbains, la veine la plus importante de Féval, par le nombre des œuvres plutôt
que par le succès auprès du public, reste à l’époque celle du récit de mœurs,
avec des textes comme Le Roman de minuit (1859) ou Annette Laïs
(1863).Ce ne sera pourtant pas de ce côté que Féval rencontrera son autre grand
succès d’avant sa conversion, mais dans une autre œuvre dans la tradition des
mystères urbains, Les Habits noirs, œuvre
monumentale en huit épisodes décrivant la lutte du héros contre une autre
société secrète, celle des Habits Noirs. Dans ce
 long cycle romanesque, Féval
retrouve en partie l’inspiration des Mystères de Londres, même s’il la
mâtine d’aventure feuilletonesque plus fidèle à la mode de l’époque. Dès lors,
si le cycle s’inscrit naturellement dans la tradition des mystères urbains, la
peinture sociale s’est totalement effacée au profit des péripéties : nous sommes
plus proches du Rocambole de Ponson du Terrail que de La Comédie
humaine de Balzac. Il y a cependant, comme chez Balzac et
Sue, de l’ambition
totalisante dans cette œuvre qui, à travers sa multitude de portraits venus de
toutes les classes de la société, offre une vision fantastique et fantasmée de
l’époque comme surent seuls le faire les grands feuilletonistes. La différence
vient de ce que, contrairement à Sue et à Balzac, cette vision ne s’accompagne
guère de conception du monde, sociale ou idéologique ; simplement, si le roman
finit par se saisir de la société tout entière, c’est que l’appétit dévorateur
de l’auteur paraît avoir toujours besoin de nouvelle matière pour nourrir son
récit, au point d’embrasser bientôt tout le paysage parisien. Mais, comme chez
Ponson du Terrail, c’est la multiplication des aventures, les multiples
ramifications du récit, engageant constamment de nouvelles intrigues parallèles,
qui crée l’intérêt de l’œuvre : les changements d’identité, reconnaissances et
coups de théâtre sont multiple dans cette œuvre foisonnante dont on aurait peine
à résumer les péripéties. Ce qui fascine dans cette œuvre, c’est la place
centrale qu’elle donne à l’univers du crime, représentant inlassablement, au fil
des chapitres, les agissements d’une bande de malfaiteurs aux pouvoirs infinis,
avec une fascination dont avaient fait preuve jusqu’alors fort peu de récits. On
pense déjà à certains récits de criminels, fort éloignés des bandits bien aimés
(Mandrin, Cartouche ou, en Grande-Bretagne, les personnages d’Ainsworth), mais
annonçant déjà les récits de génies du crime, tel le Fantômas de
Pierre Souvestre et Marcel Allain, le diabolique docteur Mabuse ou la bande de la Main
Noire (la Mano Nera) contre laquelle luttera le héros de fascicules allemands
Petrosino. L'inspiration des Habits noirs est enfin souvent proche du
fantastique, et Féval retrouve fréquemment dans son récit cette autre veine qui
l'a rendu fameux avec des romans comme Le Chevalier Ténèbre (1860) ou
La Ville vampire (1874).
long cycle romanesque, Féval
retrouve en partie l’inspiration des Mystères de Londres, même s’il la
mâtine d’aventure feuilletonesque plus fidèle à la mode de l’époque. Dès lors,
si le cycle s’inscrit naturellement dans la tradition des mystères urbains, la
peinture sociale s’est totalement effacée au profit des péripéties : nous sommes
plus proches du Rocambole de Ponson du Terrail que de La Comédie
humaine de Balzac. Il y a cependant, comme chez Balzac et
Sue, de l’ambition
totalisante dans cette œuvre qui, à travers sa multitude de portraits venus de
toutes les classes de la société, offre une vision fantastique et fantasmée de
l’époque comme surent seuls le faire les grands feuilletonistes. La différence
vient de ce que, contrairement à Sue et à Balzac, cette vision ne s’accompagne
guère de conception du monde, sociale ou idéologique ; simplement, si le roman
finit par se saisir de la société tout entière, c’est que l’appétit dévorateur
de l’auteur paraît avoir toujours besoin de nouvelle matière pour nourrir son
récit, au point d’embrasser bientôt tout le paysage parisien. Mais, comme chez
Ponson du Terrail, c’est la multiplication des aventures, les multiples
ramifications du récit, engageant constamment de nouvelles intrigues parallèles,
qui crée l’intérêt de l’œuvre : les changements d’identité, reconnaissances et
coups de théâtre sont multiple dans cette œuvre foisonnante dont on aurait peine
à résumer les péripéties. Ce qui fascine dans cette œuvre, c’est la place
centrale qu’elle donne à l’univers du crime, représentant inlassablement, au fil
des chapitres, les agissements d’une bande de malfaiteurs aux pouvoirs infinis,
avec une fascination dont avaient fait preuve jusqu’alors fort peu de récits. On
pense déjà à certains récits de criminels, fort éloignés des bandits bien aimés
(Mandrin, Cartouche ou, en Grande-Bretagne, les personnages d’Ainsworth), mais
annonçant déjà les récits de génies du crime, tel le Fantômas de
Pierre Souvestre et Marcel Allain, le diabolique docteur Mabuse ou la bande de la Main
Noire (la Mano Nera) contre laquelle luttera le héros de fascicules allemands
Petrosino. L'inspiration des Habits noirs est enfin souvent proche du
fantastique, et Féval retrouve fréquemment dans son récit cette autre veine qui
l'a rendu fameux avec des romans comme Le Chevalier Ténèbre (1860) ou
La Ville vampire (1874).
 Œuvre majeure de Paul Féval, Les Habits noirs sera
aussi l’un de ses derniers grands romans-feuilletons traditionnels de l’auteur.
En faisant le choix d’une rigoureuse conversion à la suite de revers de fortune,
Féval mettra un terme à ce cycle pour lui préférer des œuvres d’un tout autre
type. C’est en 1875 que ce produit cette conversion, bouleversement profond dans
l’existence de cet homme, qui se traduira par un changement radical de sa
production littéraire. Jusqu’alors, Féval était conservateur et fervent
pratiquant. Désormais, il se veut l’un des serviteurs actifs de l’église,
combattant avec zèle pour son rayonnement. Dès lors, une bonne part des écrits
de Féval visent à défendre l’église et à faire le portrait de ses plus grands
serviteurs : Jésuites ! apparaît ainsi comme une apologie de la
congrégation si souvent attaquée dans le roman populaire (à commencer par
Eugène
Sue dans Le Juif errant et Les Mystères du peuple). Quant
aux Merveilles du mont Saint Michel, il reprend dans une perspective
religieuse et édifiante le style et les thèmes des récits bretons de l’auteur.
Plus généralement, une grande partie de la production littéraire de l’auteur est
consacrée à la publication des tracts religieux destinés au public des
paroisses. Il réécrira également ses œuvres antérieures pour les accorder avec
les dogmes de l’église. L’œuvre de l’auteur n’a alors plus grand-chose à voir
avec l’esthétique du roman d'aventures.
Œuvre majeure de Paul Féval, Les Habits noirs sera
aussi l’un de ses derniers grands romans-feuilletons traditionnels de l’auteur.
En faisant le choix d’une rigoureuse conversion à la suite de revers de fortune,
Féval mettra un terme à ce cycle pour lui préférer des œuvres d’un tout autre
type. C’est en 1875 que ce produit cette conversion, bouleversement profond dans
l’existence de cet homme, qui se traduira par un changement radical de sa
production littéraire. Jusqu’alors, Féval était conservateur et fervent
pratiquant. Désormais, il se veut l’un des serviteurs actifs de l’église,
combattant avec zèle pour son rayonnement. Dès lors, une bonne part des écrits
de Féval visent à défendre l’église et à faire le portrait de ses plus grands
serviteurs : Jésuites ! apparaît ainsi comme une apologie de la
congrégation si souvent attaquée dans le roman populaire (à commencer par
Eugène
Sue dans Le Juif errant et Les Mystères du peuple). Quant
aux Merveilles du mont Saint Michel, il reprend dans une perspective
religieuse et édifiante le style et les thèmes des récits bretons de l’auteur.
Plus généralement, une grande partie de la production littéraire de l’auteur est
consacrée à la publication des tracts religieux destinés au public des
paroisses. Il réécrira également ses œuvres antérieures pour les accorder avec
les dogmes de l’église. L’œuvre de l’auteur n’a alors plus grand-chose à voir
avec l’esthétique du roman d'aventures.
 Le flambeau de l'oeuvre ne s'est pas totalement éteint pour
autant. Il sera repris par Paul Féval fils, qui saura exploiter le filon ouvert
par son père (mais aussi celui de Dumas, puisqu'on lui doit d'Artagnan contre
Cyrano), dans une série de nouvelles aventures de Lagardère et de sa
famille: il écrira ainsi La jeunesse du Bossu (1934), Cocardasse et
Passepoil (1909), Les Chevauchées de Lagardère (1909), Le Fils de
Lagardère (1893, avec A. d'Orsay), Les Jumeaux de Nevers (1895, avec
A. d'Orsay), Mademoiselle de Lagardère (1929), La petite fille du
Bossu (1931). Il exploitera également la veine des mystères urbains anglais
avec Les Bandits de Londres.
Le flambeau de l'oeuvre ne s'est pas totalement éteint pour
autant. Il sera repris par Paul Féval fils, qui saura exploiter le filon ouvert
par son père (mais aussi celui de Dumas, puisqu'on lui doit d'Artagnan contre
Cyrano), dans une série de nouvelles aventures de Lagardère et de sa
famille: il écrira ainsi La jeunesse du Bossu (1934), Cocardasse et
Passepoil (1909), Les Chevauchées de Lagardère (1909), Le Fils de
Lagardère (1893, avec A. d'Orsay), Les Jumeaux de Nevers (1895, avec
A. d'Orsay), Mademoiselle de Lagardère (1929), La petite fille du
Bossu (1931). Il exploitera également la veine des mystères urbains anglais
avec Les Bandits de Londres.
Nous proposons ici les principaux ouvrages de Paul Féval
pouvant être rapportés de près ou de loin à l'esthétique du roman d'aventures.
Le Capitaine Spartacus, 1843.
Les Chevaliers du Firmament, 1843.
Le Loup Blanc, 1843.
Les Mystères de Londres, 1843-44.
Les aventures d'un émigré, 1844.
Les Amours de Paris, 1845.
La Quittance de minuit, 1846.
Le Fils du diable, 1846.
Le Château de Croïat, 1848.
Les Belles de nuit, 1849-1850.
La fée des Grèves, 1850.
Beau démon, 1850.
Le capitaine Simon, 1851.
La louve, 1855-56.
L'homme de fer, 1855-56.
Les couteaux d'or, 1856.
Le Bossu, 1857.
Les Compagnons du silence, 1857-58.
Le roi des gueux, 1859.
Le Capitaine fantôme, 1862.
Les Habits noirs, 1863-75.
La Cavalière, 1865-66.
Le Cavalier Fortune, 1868: Lire les premiers chapitres.
Le quai de la ferraille, 1869.
Le Chevalier de Keramour, 1873.
Les cinq, 1875.
La première aventure de Corentin Quimper, 1876.
Cahiers de l'imaginaire, "Paul Féval, n° 10, 1983.
Collectif, Paul Féval, romancier populaire, Presses Universitaires de Rennes, "Interférences", 1992.
V. Frigerio, "Paul Féval, feuilletonniste et martyr", Les fils de Monte Cristo, Limoges, PULIM, 2002.
J.-P. Galvan, Paul Féval, Parcours d'une oeuvre, Paris, Encrage, 2000.
J.-P. Galvan: "Paul Féval, romancier populaire et homme de lettres", Tapis Franc, n° 5, 1992.
F. Lacassin, Préface aux Habits Noirs, vol. I, Bouquins, Laffont, 1987.
Maîtrise en ligne consacrée au Bossu.
Page proposant une présentation de l'auteur et une bibliographie.
Brève présentation en anglais de La ville vampire.
Où trouver les oeuvres de l'auteur?
Paul Féval est mieux loti que la plupart des romanciers populaires, et les oeuvres accessibles en librairie restent relativement nombreuses. On trouve Le Bossu en poche (par exemple chez GF, dans une édition réalisée par Hélène Constans) ou dans la collection Omnibus (accompagnées des principales suites de Paul Féval fils), et la série des Habits noirs dans la collection Bouquins Robert Laffont (deux volumes); Phébus a réédité Les compagnons du silence et Les Mystères de Londres. Le loup blanc est encore disponible chez Albin Michel. On trouve encore plusieurs romans fantastiques (La ville vampire, Les chevalier Ténèbre) dans la Petite Bibliothèque Ombre, ainsi que plusieurs romans bretons (comme La fée des Grèves) chez des éditeurs régionaux.
Pour les autres romans, qui n'ont parfois jamais été réédités depuis leur première parution, on est obligé de se fier aux librairies spécialisées (voir la page consacrée à ce sujet). On peut également se rendre sur l'un ou l'autre des sites de vente d'ouvrages d'occasion, dont le plus efficace est très certainement abebooks.fr.
Par ailleurs, on notera, pour ceux qui possèdent des connexions rapides, que le site de Gallica offre en ligne un très grand nombre d'ouvrages de Paul Féval, souvent parmi les plus rares et les plus difficiles à trouver.