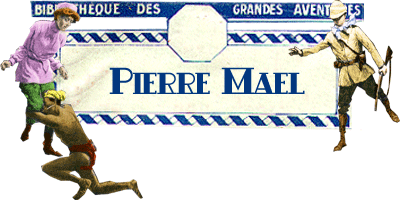
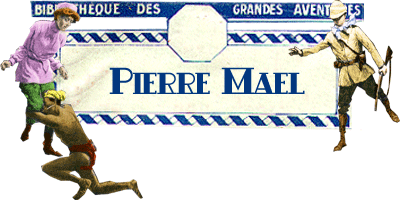

Où trouver les romans de Pierre Maël?
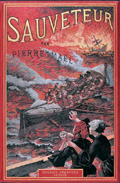 Le
nom de Pierre Maël est associé à une forme toute particulière de littérature,
celle des livres d’étrennes et des livres de prix. On retrouve souvent, dans les
greniers, ou sur les étagères d’un brocanteur, les forts volumes rouges aux
dorures passées de cet auteur, et l’on sourit à la lecture des titres
programmatiques : Seulette, Petit ange, Fleur de France, ou
encore, dans un registre plus aventureux, Terre des fauves, Une
Française au Pôle Nord ou La roche qui tue. Les ouvrages sont
nombreux, preuve de la prolixité de l’auteur. Il faut dire que Pierre Maël
n’était pas un, mais deux auteurs : Charles Vincent et Charles Causse (père
d'un autre auteur de romans d'aventures,
Jean d'Agraives). Le
premier est né en 1851 à Nudjuffgur, dans les Indes françaises (comme beaucoup
d’auteurs de romans
d'aventures géographiques, de Jacolliot
à Kipling en passant par Rider
Haggard, il a donc connu les colonies), et mort en 1920 ; le second est né
en 1862 et mort en 1904. Les deux auteurs sont légitimistes et catholiques
fervents, et se sont rencontrés au Journal des débats. Ils vont
s’associer pour écrire une série de récits, Charles Causse occupant le devant du
terrain et portant seul aux yeux du public le nom de Pierre Maël, et Charles
Vincent travaillant dans l’ombre, probablement peu mécontent de ne pas avoir à
associer son nom à des ouvrages pour la jeunesse, lui qui caressait d’autres
ambitions littéraires. Les premiers récits ne paraissent pas s’être
exclusivement destinés aux plus petits. Les publications parues chez Ollendorff
(Solitude, Femme d’artiste, Ce qu’elle voulait, etc.)
s’inscrivent plutôt dans la tradition du roman de mœurs populaire, celui de
Xavier de Montépin ou de Jules Mary, récits à protagoniste féminin aux accents
mélodramatiques : rien de suprenant dès lors à ce que certains de ces titres
aient été réédités chez Tallandier dans sa collection du National Rouge.
Le
nom de Pierre Maël est associé à une forme toute particulière de littérature,
celle des livres d’étrennes et des livres de prix. On retrouve souvent, dans les
greniers, ou sur les étagères d’un brocanteur, les forts volumes rouges aux
dorures passées de cet auteur, et l’on sourit à la lecture des titres
programmatiques : Seulette, Petit ange, Fleur de France, ou
encore, dans un registre plus aventureux, Terre des fauves, Une
Française au Pôle Nord ou La roche qui tue. Les ouvrages sont
nombreux, preuve de la prolixité de l’auteur. Il faut dire que Pierre Maël
n’était pas un, mais deux auteurs : Charles Vincent et Charles Causse (père
d'un autre auteur de romans d'aventures,
Jean d'Agraives). Le
premier est né en 1851 à Nudjuffgur, dans les Indes françaises (comme beaucoup
d’auteurs de romans
d'aventures géographiques, de Jacolliot
à Kipling en passant par Rider
Haggard, il a donc connu les colonies), et mort en 1920 ; le second est né
en 1862 et mort en 1904. Les deux auteurs sont légitimistes et catholiques
fervents, et se sont rencontrés au Journal des débats. Ils vont
s’associer pour écrire une série de récits, Charles Causse occupant le devant du
terrain et portant seul aux yeux du public le nom de Pierre Maël, et Charles
Vincent travaillant dans l’ombre, probablement peu mécontent de ne pas avoir à
associer son nom à des ouvrages pour la jeunesse, lui qui caressait d’autres
ambitions littéraires. Les premiers récits ne paraissent pas s’être
exclusivement destinés aux plus petits. Les publications parues chez Ollendorff
(Solitude, Femme d’artiste, Ce qu’elle voulait, etc.)
s’inscrivent plutôt dans la tradition du roman de mœurs populaire, celui de
Xavier de Montépin ou de Jules Mary, récits à protagoniste féminin aux accents
mélodramatiques : rien de suprenant dès lors à ce que certains de ces titres
aient été réédités chez Tallandier dans sa collection du National Rouge.
Par la suite, pourtant, les auteurs se spécialiseront dans les récits pour la jeunesse. Dans ce domaine, la plupart des ouvrages peuvent être regroupés en deux ensembles, qui correspondent à une simple division par sexe : pour les filles, les romans du foyer, très marqués par une morale chrétienne et par les valeurs familiales (mais en réalité, tributaires, dans leur structure et leurs thèmes, du mélodrame), pour les garçons, les romans d’aventures patriotiques ventant les vertus de courage et de sacrifice. Le succès des auteurs est considérable. Le nom de Pierre Maël est l’un des plus fameux de la littérature de jeunesse au début du XXe siècle. Le caractère bien-pensant des œuvres associé à une véritable verve romanesque, séduit autant les parents et les éducateurs que les jeunes lecteurs. Hachette fait de Pierre Maël l’un de ses auteurs-phares, mais il n’est pas le seul : le nom de l’écrivain se retrouve chez Flammarion, Hatier, Mame… bref, chez la plupart des grands éditeurs pour la jeunesse. Charles Causse, en habile tacticien, sait faire la publicité de l’auteur et le rendre indispensable à tout bon catalogue d’étrennes. S’il est probable qu’il tenait moins la plume que Vincent, le rôle de Causse est en effet considérable. C’est lui qui fait exister l’auteur, c’est lui également qui porte son succès. De fait, à la mort de Charles Causse, Charles Vincent, qui a manifestement décidé d’abandonner progressivement la littérature de jeunesse, propose encore une série de titres publiés sous le nom de Pierre Maël avec un rythme et un succès moindre.
Hachette continue à publier les œuvres de l’auteur dans des versions tronquées et écourtées jusque dans les années 1950 (et avec une ultime tentative dans les années 1970). Mais l’œuvre de Pierre Maël ne survivra pas vraiment à la grande époque des livres de prix. Après la seconde guerre mondiale, la littérature de jeunesse, comme la littérature populaire, a changé : le discours moral et l’évocation d’enfants idéaux tend à refluer au profit d’une peinture plus fidèle du monde de l’enfance, la pédagogie et les livres du devoir laissent place à une littérature plus ludique, dans laquelle on prend davantage en compte le plaisir de l’enfant au détriment des devoirs du futur adulte. Quant à la vision de la femme (et donc celle des obligations de la jeune fille) elle s’émancipe des images contraignantes de la mère et de l’épouse, et la seconde guerre mondiale en laissant l’Europe exsangue, a mis un terme au patriotisme et aux expansionnismes. Enfin, si Pierre Maël disparaît au cours des années 1950, c’est que la décolonisation achève ce qu’avaient déjà amorcé les bouleversements des mœurs : c’est le monde de l’écrivain – ses valeurs, sa vision de l’enfant et de la patrie – qui s’éteint.
 Les œuvres
de cet auteur (de ces auteurs) participent donc d’un système plus large, celui
de la pédagogie et des valeurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe
siècle, et ne peuvent être saisies indépendamment de ce système. Elles mettent
en jeu une certaine idée de l’enfance, pensée moins comme un âge particulier
avec ses préoccupations et ses intérêts, que comme une dynamique orientée vers
l’âge adulte. Dans cette perspective, le travail des parents et des éducateurs
reviendra à bien préparer l’enfant à ses devoirs futurs, et les œuvres pour la
jeunesse s’intègrent dans ce programme. Cela se traduit par la transmission d’un
contenu spécifique (mais dont la nature varie d’un auteur à l’autre) que l’on
cherche à faire accepter à l’enfant en le rendant plaisant. C’est très largement
le rôle dévolu à l’aventure chez les auteurs pour la jeunesse et ce, de façon
massive jusqu’à la première guerre mondiale, de Jules Verne à
Paul d’Ivoi, en passant par
Louis Boussenard, le
Capitaine Danrit ou encore
Arnould Galopin (dont l’évolution de
l’œuvre témoigne de l’épuisement progressif de cette nécessité d’éduquer). Une
telle présentation est caricaturale, on le sait. Dans les mécanismes de
l’écriture, l’aventure est autant support du savoir que l’inverse : une page
scientifique engage la rêverie romanesque comme une aventure peut être adossée à
un paragraphe savant. Enfin, d’un auteur à l’autre, les relations entre contenu
éducatif et narration romanesque varient (quand on peut même les distinguer
clairement), lors même que la nature même de ces contenus est très différente
d’un auteur à l’autre. Ainsi, là où Verne investit surtout le savoir positif, là
où Boussenard justifie l’aventure par
des notations géographiques, là où le projet de
Danrit porte sur la formation militaire, les Maël investissent le terrain de
la morale – dans le cas des romans d'aventures, d’une morale patriotique. Si la
chose est manifeste pour les ouvrages destinés aux filles (dont les récits se
présentent explicitement comme une leçon), elle est un peu moins visible chez
les garçons. Mais c’est en partie parce que la nécessaire efficacité du roman
d'aventures ne permet guère de longs développements édifiants. En contrepartie,
la dynamique du récit permet de faire passer les idées par la seule logique de
l’aventure : grand ou petit, le héros de romans d'aventures doit faire preuve de
courage, d’abnégation et de force morale pour venir à bout de ses adversaires,
et sa victoire finale est aussi le triomphe de ses valeurs. Nul besoin dès lors
d’offrir un discours développé pour faire passer ces valeurs – et c’est
probablement ce qui rend les romans d'aventures pour la jeunesse de cette époque
moins illisibles que les récits pour fillettes.
Les œuvres
de cet auteur (de ces auteurs) participent donc d’un système plus large, celui
de la pédagogie et des valeurs de la fin du XIXe siècle et du début du XXe
siècle, et ne peuvent être saisies indépendamment de ce système. Elles mettent
en jeu une certaine idée de l’enfance, pensée moins comme un âge particulier
avec ses préoccupations et ses intérêts, que comme une dynamique orientée vers
l’âge adulte. Dans cette perspective, le travail des parents et des éducateurs
reviendra à bien préparer l’enfant à ses devoirs futurs, et les œuvres pour la
jeunesse s’intègrent dans ce programme. Cela se traduit par la transmission d’un
contenu spécifique (mais dont la nature varie d’un auteur à l’autre) que l’on
cherche à faire accepter à l’enfant en le rendant plaisant. C’est très largement
le rôle dévolu à l’aventure chez les auteurs pour la jeunesse et ce, de façon
massive jusqu’à la première guerre mondiale, de Jules Verne à
Paul d’Ivoi, en passant par
Louis Boussenard, le
Capitaine Danrit ou encore
Arnould Galopin (dont l’évolution de
l’œuvre témoigne de l’épuisement progressif de cette nécessité d’éduquer). Une
telle présentation est caricaturale, on le sait. Dans les mécanismes de
l’écriture, l’aventure est autant support du savoir que l’inverse : une page
scientifique engage la rêverie romanesque comme une aventure peut être adossée à
un paragraphe savant. Enfin, d’un auteur à l’autre, les relations entre contenu
éducatif et narration romanesque varient (quand on peut même les distinguer
clairement), lors même que la nature même de ces contenus est très différente
d’un auteur à l’autre. Ainsi, là où Verne investit surtout le savoir positif, là
où Boussenard justifie l’aventure par
des notations géographiques, là où le projet de
Danrit porte sur la formation militaire, les Maël investissent le terrain de
la morale – dans le cas des romans d'aventures, d’une morale patriotique. Si la
chose est manifeste pour les ouvrages destinés aux filles (dont les récits se
présentent explicitement comme une leçon), elle est un peu moins visible chez
les garçons. Mais c’est en partie parce que la nécessaire efficacité du roman
d'aventures ne permet guère de longs développements édifiants. En contrepartie,
la dynamique du récit permet de faire passer les idées par la seule logique de
l’aventure : grand ou petit, le héros de romans d'aventures doit faire preuve de
courage, d’abnégation et de force morale pour venir à bout de ses adversaires,
et sa victoire finale est aussi le triomphe de ses valeurs. Nul besoin dès lors
d’offrir un discours développé pour faire passer ces valeurs – et c’est
probablement ce qui rend les romans d'aventures pour la jeunesse de cette époque
moins illisibles que les récits pour fillettes.
Reste que la seule
évocation des titres des ouvrages permet d’évoquer un champ des valeurs :
Sauveteur, La filleule de Du Guesclin, Un mousse de Surcouf,
Terre d’héroïsme… C’est bien un ensemble cohérent qui se dessine dans les
romans pour garçons : celui du sacrifice, de l’abnégation, et du don de soi à la
patrie, dont rendent compte les gestes héroïques et les lignées prestigieuses.
Le motif de la guerre est omniprésent chez les auteurs, bien plus par exemple
que chez Louis Boussenard, pour qui
l’aventure est affaire de goût (Friquet, Friquette et tant d’autres ne sont pas
tant animés par l’amour de la patrie que par le plaisir du voyage, de la chasse…
et plus généralement de l’aventure romanesque). A y regarder de près, on est en
effet frappé par la proportion de ouvrages qui mettent en scène la guerre : non
seulement les récits prennent la plupart du temps un conflit pour arrière fond –
combats contre les Anglais (Un mousse de Surcouf, La Roche qui tue)
affrontements coloniaux (L’Alcyone, Le Talisman, Terre des
fauves…), guerre entre Russes et Japonais (Blanche contre Jaunes qui
se nourrit aussi de l’imaginaire du péril jaune)… mais les héros eux-mêmes sont
de jeunes officiers en service (Le Torpilleur 29, L’Alcyone),
renvoyant à une sorte d’aristocratie patriote dans un pays toujours prêt au
combat. C’est donc d’une aventure embrigadée qu’il s’agit. Mais elle est fort
éloignée des récits bellicistes du Capitaine
Danrit. Le sous-texte idéologique est moins explicite ici, et son expression
est moins virulente ; cette euphémisation des idées et de leur expression paraît
accompagner une euphémisation plus générale de la violence. A une époque où le
roman d'aventures ne répugne pas à l’évocation de la barbarie dans des visions
souvent crues, on est surpris de la rencontrer si peu dans les récits de Maël.
On est loin en tout cas des scènes de massacres qu’affectionne
Danrit ou des joyeuses exterminations de
bêtes ou de cannibales auxquels se livrent les héros de
Boussenard. Il n’y a pas chez
l’auteur de libération des pulsions qui caractérise bien des écrivains qui lui
sont contemporains. Et ce refus du relâchement se traduit plus généralement par
une gravité qui distingue également Pierre Maël des pochades que se permet Jules
Verne entre deux leçons, ou des farces de mauvais goût que préparent les héros
de Paul d’Ivoi et de
Boussenard contre les autochtones.
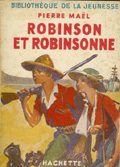
Tout se passe comme si Pierre Maël adoptait le moule du roman d'aventures en père de famille conscient de ses responsabilités : les héros sont raisonnables, leurs sentiments sont élevés, à tel point que de tels qualificatifs semblent désigner non plus le caractères des protagonistes ou l’intrigue que l’écriture des auteurs elle-même. Il y a une curieuse gravité chez Pierre Maël, fort éloignée de celle des autres romans d’aventures à la française. Et il a beau aborder la plupart des thèmes du roman d'aventures (aventures coloniales avec Terre des fauves, Robinsonnades avec Robinson et Robinsonne, voyages extraordinaires avec Une Française au Pôle Nord, aventures historiques avec La-Roche-Qui-Tue et surtout « romans de mœurs maritimes », récits maritimes à cadre breton, avec L’Alcyone et tant d’autres – les deux écrivains avaient des racines bretonnes), il ne se départit jamais de ce sérieux qui en fait, entre tous, un auteur recommandable.
C’est peut-être ce qui explique que les romans de Pierre Maël qui ont connu le succès le plus durable soient ceux qui ont paru chez Hachette et non chez les éditeurs plus populaires. Le sérieux de l’un cadrait avec la gravité de l’autre. Maël est probablement l’un des écrivains qui répondaient le mieux à l’idéal du livre de prix : celui d’une littérature dont le caractère plaisant (après tout, c’est une récompense) doit pouvoir cacher les velléités éducatives. Mais cet atout est aussi une limite qui explique en partie que l’auteur n’ait pas bien vieilli. Avec le déclin de l’industrie du livre de prix et d’étrennes, certains spécialistes de ces ouvrages voient leurs livres survivre sous d’autres formes : Louis Boussenard trouve une seconde vie populaire, grâce à son humour, sa désinvolture et au rythme de ses intrigues (et Tallandier saura couper les passages didactiques pour insister sur le plaisir que recherche le lecteur populaire), et la façon dont le discours scientifique se traduit par une plongées dans l’imaginaire archétypal permet à Jules Verne d’échapper au carcan éducatif. Mais Pierre Maël reste un auteur marqué par ce modèle éditorial. De fait, il est possible que sa survivance en Bibliothèque Verte ait été permise par son statut d’auteur de transmission, les parents offrant à leurs enfants les livres que leurs propres parents leur avaient offert autrefois (Caroline et Martine bénéficient aujourd’hui encore de ce type de consommation nostalgique).
Il ne faut pas cependant sous-estimer l’attrait de ces œuvres. Si Pierre Maël n’était qu’un auteur de livres de prix parmi d’autres, il n’aurait pas plus survécu que la litanie des auteurs secondaires publiés par le Musée des familles. Cela tient d’abord à cette propension qu’il a à faire glisser la gravité du récit vers les accents du mélodrame. Il y a beaucoup de larmes et de sentiments chez l’auteur, et les enjeux ne sont pas, comme chez d’autres, désamorcés par le plaisir d’un romanesque aux accents surtout ludiques. Cet dramatisation de l’aventure devait probablement impressionner les jeunes lecteurs, comme devait les frapper cette tendance à moraliser à outrance l’action : ce qui rend important l’enjeu, ce n’est pas tant qu’il comporte du danger (c’est le cas dans tous les récits d’aventures), mais c’est bien plutôt qu’il a une portée morale qui paraît le transcender. L’aventure perd de sa part d’anecdote que renforce encore l’humour des autres auteurs et le caractère échevelé des aventures qu’ils proposent. Ce n’est pas le cas chez les Maël, qui cherchent à donner une intensité plus grande à l’événement en le rapportant à des enjeux dramatiques certes souvent stéréotypés (les liens avec la famille ou l’amour d’une jeune fille sont des traits récurrents de cette dramatisation). L’identification du lecteur aux personnages retrouve alors ce plaisir – qu’il est difficile de saisir aujourd’hui – de la bonne action, qui possède une longue généalogie, des récits moraux aux exempla en passant par les « pages de gloire » et la Légende Dorée. C’est de ce côté que se reconquiert la cohésion de l’œuvre de l’auteur, entre romans pour petites filles et romans pour garçons. Surtout, ce que nous montrent les récits de Pierre Maël, c’est que la logique manichéenne du roman d'aventures, son organisation autour d’un héros solaire, son caractère souvent initiatique, tous ces traits et d’autres encore, rapprochent le genre, à côté du modèle souvent évoqué des récits épiques, de la généalogie de l’exemplum profane et sacré.
Où trouver les oeuvres de l'auteur?
 Les romans de Pierre
Maël ne sont plus édités de nos jours. L'auteur ayant connu un succès
considérable par le passé, certaines de ses oeuvres (en particulier celles
éditées par Hachette) sont assez faciles à trouver chez les bouquinistes et les
libraires d'occasion (en particulier chez les libraires spécialisés en
littérature de jeunesse - voir ma page
adresses). On trouve
ainsi un grand nombre de titres sur abebooks.fr,
mais les titres sont rares.
Les romans de Pierre
Maël ne sont plus édités de nos jours. L'auteur ayant connu un succès
considérable par le passé, certaines de ses oeuvres (en particulier celles
éditées par Hachette) sont assez faciles à trouver chez les bouquinistes et les
libraires d'occasion (en particulier chez les libraires spécialisés en
littérature de jeunesse - voir ma page
adresses). On trouve
ainsi un grand nombre de titres sur abebooks.fr,
mais les titres sont rares.
On peut télécharger en mode image (faible qualité) plusieurs romans de l'auteur sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale: (nécessite Acrobat Reader).
Où trouver les romans de Pierre Maël?